Le renouveau de l’autogestion révèle une idée surprenante : loin d’être obsolète, elle est essentielle dans les débats contemporains sur les formes organisationnelles. Cette recherche met en lumière comment les principes d’autogestion, tels que la participation et la responsabilisation, peuvent transformer notre compréhension des structures organisationnelles modernes.
Le renouveau de la pensée autogestionnaire comme système organisationnel alternatif ?
Ainsi, l’idée autogestionnaire, loin d’être morte (comme pourrait le laisser penser son absence patente dans les débats contemporains), semble être en réalité une idée pertinente et d’une vigoureuse actualité dans les nouvelles théories organisationnelles comme dans le contexte sociétal actuel.
Son apparente désuétude ne serait liée qu’au phénomène naturel du « cycle de vie des mots ». En effet, pour Frédéric Cépède « si nous appliquons cette hypothèse du cycle de vie des mots à l’autogestion, nous pouvons considérer qu’après avoir connu la marginalité puis le succès dans les années 70, l’autogestion comme mot a vécu ensuite la phase de banalisation qui accompagne le succès et prépare la décadence puis l’oubli. Mais l’autogestion comme source de vitalité souterraine, comme attente d’une démocratie toujours plus radicale et participative reste, elle,
280 ROSANVALLON, Pierre. Op. Cit. (1976).
281 GEORGI, Frank. Les rocardiens : pour une culture politique autogestionnaire. In L’autogestion, la dernière utopie ? Sous la direction de Frank Georgi, publication de la Sorbonne, 2003.
féconde et rien n’interdit de penser que le mot puisse connaître dès lors une nouvelle jeunesse dans un avenir plus ou moins proche »282.
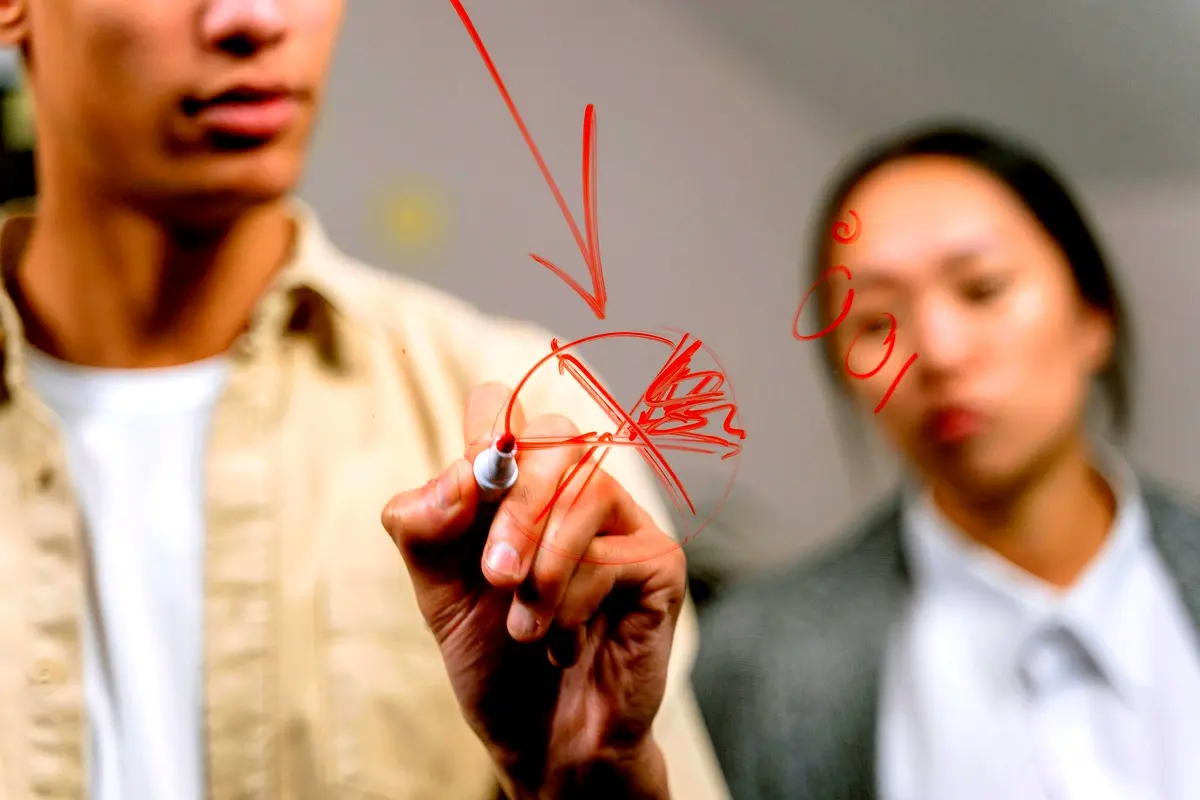
Ainsi, si le mot « autogestion » est bien mort, l’idée que ce terme incarne, et notamment l’ « image » de l’organisation dont il est porteur, reste toujours, voire de plus en plus, pertinente. L’idée autogestionnaire semble ainsi refleurir derrière de nouveaux vocables et de nouvelles thématiques. Michel Trebitsch se demande ainsi si l’idée autogestionnaire ne « renaît[rait] pas aujourd’hui dans la notion de « citoyenneté » ou de « nouvelle citoyenneté ».
L’autogestion est aujourd’hui métisse de décentralisation, d’autonomie culturelle, de refus du politique, de contournement du national »283. Frank Georgi constate lui aussi que « l’autogestion n’est pas morte et sa prospérité peut se lire aujourd’hui dans les mouvements contemporains en faveur d’une autre mondialisation essayant d’articuler les échelles de la démocratie, du local au global, nécessitant un haut niveau d’auto régulation »284.
Ainsi, pour Pierre Rosanvallon « l’autogestion n’est pas une doctrine du XIX°, elle est la fille du XXI° siècle. Son projet et sa méthode accompagnent la rupture que nous indique la science contemporaine »285.
C’est également l’idée que semblent défendre Michael Hart et Antonio Négri en constatant l’émergence d’une nouvelle forme organisationnelle globale qui offrirait « de nouvelles possibilités aux forces de libération »286. A la société de contrôle, qui a succédé à la société disciplinaire, se substitut ainsi une nouvelle société qu’ils nomment « postmoderne (…) dans laquelle les mécanismes de maîtrise se font toujours plus « démocratiques », toujours plus immanents au champ social, diffusés dans le cerveau et le corps des citoyens ».
Ces auteurs situent le lieu d’émergence de cette nouvelle forme macro-organisationnelle au sein de l’entreprise car c’est le lieu « où naissent les résistances et les solutions de remplacement les plus efficaces au pouvoir de l’Empire ». En effet, l’activité productive des entreprises contemporaines semble actuellement subir de profonds bouleversements qui les amèneraient sur les chemins de l’autogestion : « la révolution de l’accumulation informationnelle requiert un énorme bond en avant vers une plus grande socialisation de la production. Cette socialisation grandissante est un processus qui fait assurément bénéficier le capital d’une productivité accrue, mais qui pointe aussi, au-delà de l’ère du capital, vers un
282 CEPEDE, Frédéric. L’autogestion dans la propagande socialiste, 1968-1980. In L’autogestion, la dernière utopie ? Sous la direction de Frank Georgi, publication de la Sorbonne, 2003
283 TREBITSCH, Michel. Henri Lefebvre et l’autogestion. In L’autogestion, la dernière utopie ? Sous la direction de Frank Georgi, publication de la Sorbonne, 2003
284 GEORGI, Frank. Les rocardiens : pour une culture politique autogestionnaire. In L’autogestion, la dernière utopie ? Sous la direction de Frank Georgi. Publication de la Sorbonne, 2003
285 ROSANVALLON, Pierre. L’âge de l’autogestion. Edition du Seuil, 1976
286 HARDT, Michael et NEGRI, Antonio. Empire. Exils, 2000
nouveau mode social de production ». L’entreprise devient ainsi le lieu où s’exprime l’ « exigence politique de la multitude : le droit à la réappropriation (…) Dans ce contexte, la réappropriation signifie avoir le libre accès (et le contrôle sur) la connaissance, l’information, la communication et les affects, parce que ce sont quelques uns des moyens premiers de la production biopolitique. Le droit de réappropriation est réellement le droit de la multitude à l’autocontrôle et l’autoproduction autonome ».
L’intégration de l’idée autogestionnaire par le système organisationnel dominant ?
Dans une perspective beaucoup moins « enchantée », Boltanski et Chiapello font un constat plus amer : l’idée autogestionnaire, loin de remettre la logique capitaliste en question et de représenter une alternative, servirait au contraire à la justifier, à lui donner un sens, à remobiliser les travailleurs, c’est-à-dire ceux qui jouent un rôle dans le processus d’accumulation capitaliste sans en être les bénéficiaires privilégiés, et qui ont donc besoin d’une symbolique forte pour s’y engager.
Boltanski et Chiapello constatent ainsi la « capacité surprenante de survie [du système capitaliste] par endogénéisation d’une partie de la critique »287. C’est en effet la critique qui serait le facteur essentiel de régénération du capitalisme. En croyant le combattre, elle contribuerait, paradoxalement, à le maintenir. Ainsi, « parce que la critique permet au capitalisme de se doter d’un esprit qui est nécessaire à l’engagement des personnes dans le processus de fabrication du profit, elle sert indirectement le capitalisme et est un des instruments de sa capacité à durer ».
L’ouvrage de Michael Hart et d’Antonio Négri semble lui aussi conduire au même constat :
« de façon à la fois paradoxale et contradictoire, les processus impériaux de mondialisation assument ces événements en les identifiant à la fois comme limites et comme occasions pour recalibrer les instruments même de l’Empire ».
Ouverture :
Pour penser réellement la place de l’autogestion dans le renouvellement actuel des formes organisationnelles, il nous faut également souligner ce qui différencie cette théorie des nouvelles théories organisationnelles.
287 BOLTANSKI, Luc et CHIAPELLO, Eve. Le nouvel esprit du capitalisme. Gallimard, 1999
Tout d’abord, ces deux théories ne poursuivent pas les mêmes buts : la première valorise cette image de l’organisation car elle est jugée plus humaniste/démocratique, pour l’autre parce qu’elle est jugée plus efficace.
D’autre part, ces deux images de l’organisation fort similaires ne se développent pas dans le même contexte social, économique et culturel : l’une est fille du XIXème siècle288 alors que la deuxième émerge à l’orée du XXIème siècle.
Profondément, ces deux images sont donc le reflet deux idéologies bien distinctes : le socialisme, voire l’anarchisme, du XIXème siècle pour la première et le capitalisme contemporain pour la seconde.
Malgré ces fortes différences, ces deux idéologies semblent s’appuyer sur des principes organisationnels similaires, reposant notamment sur une intensification des activités communicationnelles, informationnelles et cognitives.
Une question se pose alors : de part cet ancrage idéologique fort différent, ces deux corpus théoriques prônant des principes organisationnelles quasi identiques vont-ils forcément déboucher sur des pratiques organisationnelles similaires ?
Une question plus conceptuelle se pose également : les tentatives de mise en application des nouvelles théories organisationnelles au sein de entreprises contemporaines amorcent-t-elles un certain renouveau de l’autogestion ou reflètent-elles au contraire l’extraordinaire intégration de la critique par le système capitaliste et donc « la fin de l’histoire », désormais engluée dans un système organisationnel indépassable ? Ou bien représentent-elles une troisième voie, une alternative permettant de dépasser ces deux idéologies par le passage à un méta niveau conciliant objectif économique et objectif social ?
Ce travail de recherche demande donc à être poursuivi en passant du niveau des théories, des principes et des discours à celui des pratiques organisationnelles.
Ce mémoire se poursuivra donc par la réalisation d’une Thèse visant à comparer les pratiques organisationnelles des coopératives autogérées à celles issues des innovations managériales contemporaines. L’objectif sera ainsi de poursuivre cette interrogation sur la place de l’autogestion dans les pratiques entrepreneuriales actuelles et d’affiner notre compréhension des modèles organisationnels actuellement en émergence.
288 En effet, même si certains auteurs, tels Frank Georgi, pensent que l’autogestion est fille du XXI° siècle, il est indéniable que cette pensée s’est réellement constitué au XIXème siècle et porte la marque de ses géniteurs, tels Proudhon.
Questions Fréquemment Posées
Qu’est-ce que le renouveau de l’autogestion dans les organisations ?
Le renouveau de l’autogestion se réfère à la réactualisation du concept d’autogestion comme système organisationnel alternatif, pertinent dans le contexte contemporain des nouvelles théories organisationnelles.
Pourquoi l’idée d’autogestion est-elle toujours pertinente aujourd’hui ?
Bien que le terme autogestion soit tombé en désuétude, les principes qu’il incarne, tels que la participation, la responsabilisation et la démocratie participative, restent d’actualité.
Comment l’autogestion est-elle liée aux mouvements contemporains ?
L’autogestion est liée aux mouvements contemporains qui favorisent une autre mondialisation, articulant les échelles de la démocratie, du local au global, et nécessitant un haut niveau d’auto régulation.
Quel est l’impact de la révolution informationnelle sur l’autogestion ?
La révolution de l’accumulation informationnelle nécessite une plus grande socialisation de la production, ce qui pourrait amener les entreprises contemporaines vers des chemins d’autogestion.