Les défis de l’autogestion révèlent une dynamique surprenante : malgré son déclin depuis les années 80, ce concept demeure essentiel dans les débats contemporains sur les formes organisationnelles. Cette recherche met en lumière la nécessité de réactualiser l’autogestion pour répondre aux enjeux actuels de participation et de démocratie au sein des entreprises.
- La remise en cause de la logique hiérarchique :
A la Péniche, aucun des onze membres n’a le statut de « dirigeant ». Cette organisation s’attache en effet à fonctionner sans système de pouvoir : la prise de décision étant partagée et s’effectuant à l’unanimité, le pouvoir est partagé par l’ensemble des salariés.
Plus largement, l’entreprise étend ce principe à l’ensemble de l’entreprise, en refusant tout poste statutaire qui différencierait les membres les uns des autres.
Au niveau juridique, la Péniche est néanmoins tenue d’avoir un dirigeant. Pour dégager ce titre de toute tâche, fonction, place et symbolique particulière dans l’entreprise, c’est par tirage au sort qu’il est nommé et ce titre ne l’engage à aucune charge particulière, l’ensemble des responsabilités étant partagées. Pour preuve, tous les salariés ont une délégation générale de signature du gérant et peuvent ainsi remplir à tout moment ses fonctions, si nécessaire.
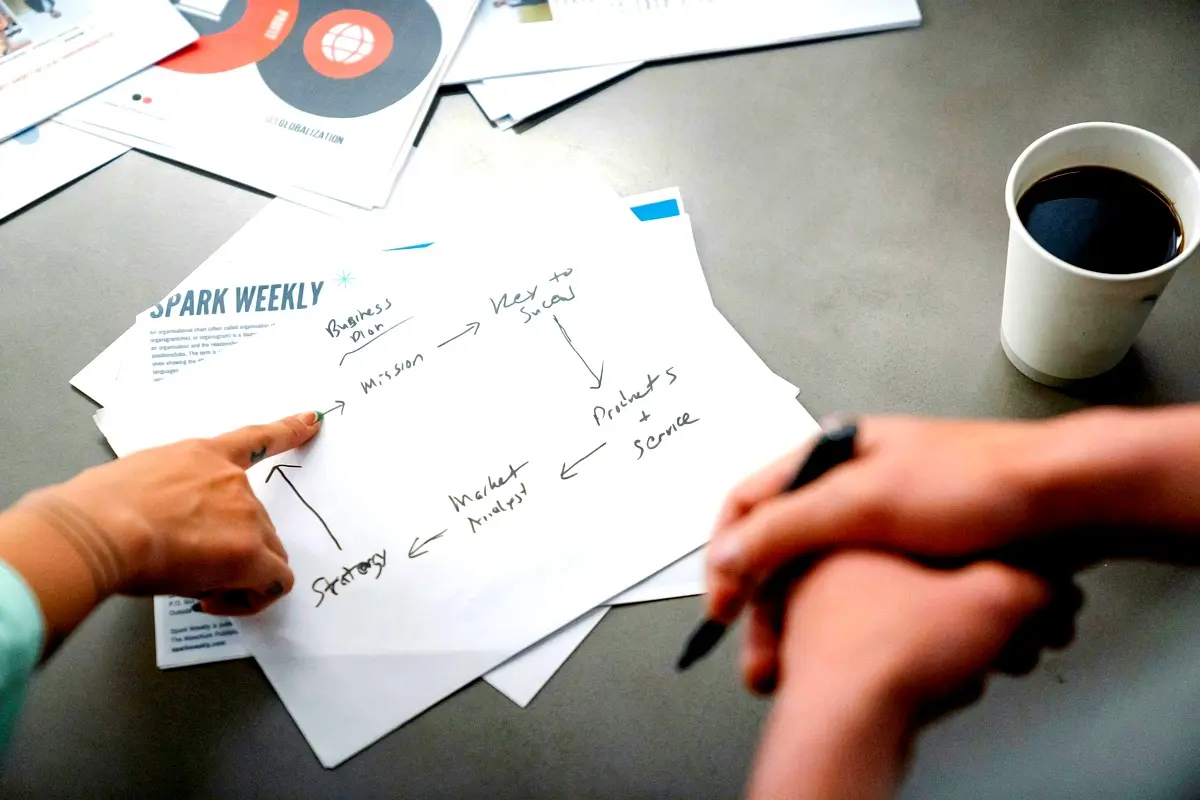
Ce tirage au sort à lieu tous les ans au mois de juin. Lorsqu’un des salariés a déjà été gérant, il est retiré du tirage au sort. Ainsi, chacun a été au moins une fois « gérant », et un nouveau tour a recommencé en juin 2005.
Ce tirage au sort est ainsi une procédure formalisée, toutefois elle ne correspond en rien aux procédures formelles classiques de désignation des dirigeants dont usent les entreprises hiérarchiques et capitalistiques. La part de hasard et l’absence de charge matérielle et symbolique qui accompagne cette désignation semblent en faire une procédure tout à la fois formelle et informelle.
Toutefois, on peut constater la mise en place d’une certaine « hiérarchie », mais les connotations habituelles de ce terme ne semblent pas appropriées à l’organisation politique et sociale expérimentée par la Péniche.
En effet, la prise de parole, permettant la participation aux décisions et donc à l’organisation de l’entreprise, n’est pas véritablement égalitairement répartie. Cependant cela ne tient à aucun facteur organisationnel : s’expriment peu ceux qui ne le souhaitent pas ou ceux qui n’ont rien d’utile à apporter aux discussions. Au delà de l’envie de prendre la parole ou de la pertinence des interventions, la Péniche est également consciente des différences psychologiques et culturelles entravant ou favorisant cette prise de parole.
Comme l’expliquent les membres de cette entreprise, « par timidité, complexe, manque d’assurance ou tout simplement d’idées, certains ne prennent pas toute la place qu’ils pourraient occuper au sein du collectif. Ce n’est pas si grave tant que l’ouverture demeure et que la parole de la personne est constamment sollicitée par les autres et que ceux-ci ne finissent pas par prendre l’habitude de ne plus considérer la personne dans la discussion et la prise de décision.
Mais il faut aussi que ce silence ne corresponde pas à un désinvestissement de la personne qui soit de fait un refus de la prise en charge collective en laissant aux autres le soin de régler les problèmes »214.
On peut également constater que l’ancienneté, l’expérience ou encore le charisme influent sur la capacité et la possibilité de prendre la parole et d’être écouté, comme dans toute organisation humaine.
De plus, il faut souligner que si hiérarchie il y a, elle ne ressemble en rien à la structure pyramidale et rigide que l’on rencontre dans les organisations classiques sous la forme d’organigramme. En effet, à la Péniche, cette pyramide se décompose en deux lignes, de proportion quasiment égales : ceux qui sont le plus impliqués dans la prise de décision, et ceux qui tendent à suivre les résolutions qui se dégagent naturellement des discussions sans en avoir véritablement influencé le contenu (une proportion de « retraitistes » diraient Sainsaulieu, Marty et Tixier215). En outre, les rôles ne sont pas statiques, ceux qui ne participent guère à certaines discussions peuvent s’investir davantage dans d’autres, et inversement. Ainsi, dans ce type de structure il n’existe pas un centre, mais plusieurs centres, qui plus est mobiles.
Ainsi, « même si les principes d’égalité sont clairs, il peut arriver que certains exercent une forme particulière de pouvoir sans forcément qu’ils le recherchent. C’est une objection classique au fonctionnement autogéré : l’émergence de leaders « naturels » au sein de tout groupe humain »216. Cependant si ce phénomène d’ « émergence de leaders naturels» suit les principes de pluralité et de mobilité des centres, il n’est pas du tout incompatible avec l’idée autogestionnaire.
Enfin, le rôle que confère ce positionnement hiérarchique au sein de La Péniche ne ressemble en rien à celui qui a habituellement cours dans les entreprises classiques. Ce rôle témoigne d’ailleurs de la mutation du rôle de la hiérarchie qui s’opère dans les nouvelles théories organisationnelles. Ainsi, le rôle qu’endosse cette « hiérarchie » au sein de La Péniche multiplie les analogies avec celui du « grand » de la cité-projet qui « n’est pas seulement celui qui sait s’engager, mais aussi celui qui est capable d’engager les autres, de donner de l’implication, parce qu’il inspire confiance, que sa vision produit de l’enthousiasme, toutes qualités qui font de lui l’animateur d’une équipe qu’il ne dirige pas de façon autoritaire mais en se mettant à l’écoute des autres, avec tolérance, en reconnaissant et en respectant les différences.
Ce n’est pas un chef (hiérarchique) mais un intégrateur, un facilitateur, donneur de souffle, fédérateur d’énergies, impulseur de vie, de sens et d’autonomie »217. Ainsi, à la Péniche, acquiert un rôle « hiérarchique » celui qui fait pleinement vivre le projet.
________________________
214 Autogestion, mode d’emploi. ↑
215 SAINSAULIEU, TIXIER, MARTY. La démocratie en organisation. Librairies des Méridiens, 1983. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quels sont les défis de l’autogestion dans les organisations contemporaines?
L’article souligne que la prise de parole n’est pas véritablement égalitairement répartie, et que des facteurs psychologiques et culturels influencent la participation des membres.
Comment la Péniche gère-t-elle la prise de décision sans hiérarchie?
À la Péniche, la prise de décision est partagée et s’effectue à l’unanimité, sans système de pouvoir, et le rôle de dirigeant est attribué par tirage au sort.
Quelles sont les caractéristiques de la hiérarchie à la Péniche?
La hiérarchie à la Péniche ne ressemble pas à une structure pyramidale classique, mais se décompose en deux lignes : ceux qui participent activement aux décisions et ceux qui suivent les résolutions sans influencer le contenu.