L’intelligence collective et autogestion révèle une dynamique surprenante dans les nouvelles formes organisationnelles. Cette recherche met en lumière comment ces concepts, bien que souvent négligés, sont essentiels pour repenser la participation et la démocratie dans un monde en mutation.
Une intelligence collective basée sur la multiplication des interactions :
Les nouvelles théories organisationnelles sont fortement marquées par la figure du réseau89, métaphore d’une organisation « aplatie » souple et réactive. Amblard, Bernoux, Herreros et Livian situent la première approche du concept de réseau dans les travaux menés par Howard Becker au début des années 80. Travaillant sur la production des œuvres d’art, il soutient la thèse selon laquelle « c’est le monde de l’art plutôt que l’artiste lui-même qui réalise l’œuvre »90. Toute œuvre est donc le fruit d’une action collective qui met des acteurs en réseau et ne peut exister que dans ce réseau.
La notion de réseau part ainsi de l’idée que l’intelligence, la créativité, l’innovation sont fondés non sur le seul génie créateur de l’artiste ou du décideur, mais sur la mise en réseau de tous les acteurs. Il n’y aurait donc réellement d’intelligence que collective.
Sylvie Bourdin soutient la même idée en proclament qu’« on ne pense pas seul, pas plus qu’on ne travaille seul »91. De même, pour Cornélius Castoriadis, « c’est de la folie que de prétendre à tout prix être sage tout seul »92.
Cette conception collective de l’intelligence se retrouve dans l’idée autogestionnaire. C’est en effet une idée que l’on retrouve dans la notion de « general intellect » développée par Marx. Comme nous l’explique Paulo Virno, cette expression « contredit une longue tradition selon laquelle la pensée serait une activité isolée et solitaire, qui nous sépare de nos semblables, une activité intérieure, sans manifestations visibles, étrangère au souci des affaires communes (…) Marx pose l’intellect comme quelque chose d’extérieur et de collectif, comme un bien public » appelé à devenir « le ressort véritable de la production de la richesse »93.
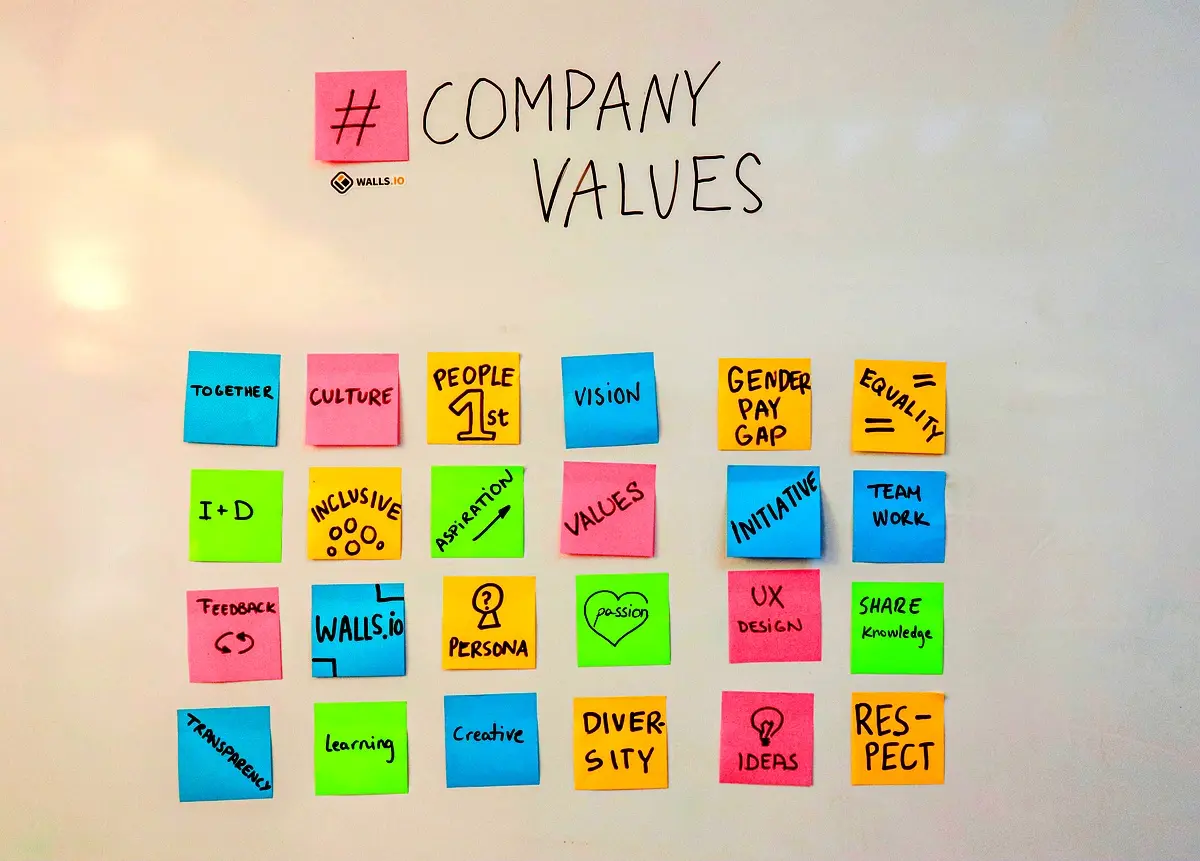
Cette nouvelle forme d’intelligence s’appuie donc, pour s’exprimer comme pour se développer, sur de multiples échanges relationnels. Les activités informationnelles et communicationnelles doivent désormais être sans cesse activées pour générer cette « saine émulation » dont l’entreprise a perpétuellement besoin pour se régénérer, c’est-à-dire s’adapter et innover.
Ainsi, « une autre logique de gestion des connaissances voit le jour » en réaction à celle purement instrumentale et mécaniste qui avait cours jusque là : « il ne s’agit pas ici de modéliser les connaissances mais plutôt d’organiser le dialogue (…) de favoriser le développement des liens interpersonnels, en escomptant l’apparition progressive de réseaux professionnels, au gré des affinités, des hasards, des pratiques quotidiennes », « il s’agit de passer d’une logique de gestion et de capitalisation des connaissances à la mise en place d’un environnement favorisant leur mobilisation »94.
Jacques-Henri Jacot parle d’ « organisation interactive » au sujet des formes organisationnelles susceptibles de représenter une véritable « rupture ». Dans cette nouvelle perspective, l’ensemble des activités relationnelles sont désormais considérées comme des facteurs clés dans les processus organisationnels.
C’est également un des postulats de l’organisation autogérée. En effet, comme nous l’avons évoqué en première partie, l’organisation autogérée s’appuie sur une socialisation des moyens d’information et de communication encourageant tous les savoirs à se rencontrer pour s’enrichir mutuellement.
Le développement de l’intelligence collective au sein des organisations autogérées est également permis grâce à une organisation à taille humaine. L’une des limites souvent évoquée lorsqu’il est question d’entreprise autogérée met l’accent sur la taille forcément limitée de celle-ci. Cependant, il semblerait plus juste de comprendre cette limite comme une contrainte profitable. Cette taille réduite est en effet la condition même du développement de l’intelligence collective. En effet, celle-ci ne peut s’actualiser que dans des organisations dont la taille permet à la fois de dépasser la rationalité individuelle limitée et de contrer la loi d’unité mentale des foules (l’une et l’autre revenant finalement au même).
Ce souci de développer des organisations à taille humaine semble également caractériser les nouvelles théories organisationnelles qui encouragent la « déconcentration productive ». Thomas Coutrot constate ainsi que « le mot d’ordre n’est plus à la constitution d’immenses conglomérats diversifiés, mais au recentrage sur des métiers. »95
Une intelligence pratique réactualisant la thématique de l’apprentissage :
Le développement de l’intelligence est également encouragé à fort recours de formations. Mais c’est également une nouvelle conception de l’apprentissage qui se développe. Celui-ci se conçoit désormais comme étant basé sur la pratique. L’intelligence se développe désormais « en situation ». L’entreprise devient un lieu d’apprentissage, un « lieu pédagogique »96.
Philippe Zarifian et Pierre Veltz insistent alors sur la nécessité de « sortir l’apprentissage et l’innovation de leur gangue fonctionnelle spécialisée pour en faire des processus actifs dans toute l’épaisseur de l’organisation ». L’activité professionnelle quotidienne doit devenir une « occasion d’apprentissage, d’enrichissement du répertoire d’actions efficaces, d’expérimentations»97.
Dans le même esprit, Proudhon souhaite renouer l’intelligence et l’activité, la pensée et l’action, notamment à travers ce qu’il nomme l’idéo-réalisme. Selon cette théorie, « toute idée a sa source dans un rapport réel révélé dans une action et perçu ainsi par l’entendement »98. Dans La Justice (1858) il énonce que « toute idée naît de l’action et doit retourner à l’action, sous peine de déchéance pour l’agent ».
L’organisation autogérée s’appuie ainsi sur une « dynamique de la formation permanente et de l’autodidaxie pratiquée dans l’entreprise »99.
________________________
87 THUDEROZ, Christian. Du lien social dans l’entreprise, travail et individualisme coopératif. Revue française de sociologie XXXVI, 1995. ↑
88 Voir annexe 2 : « généalogie de la théorie autogestionnaire » ↑
89 Voir annexe 1 : « généalogie des théories organisationnelles et communicationnelles » : « la métaphore du réseau » (p 46) ↑
90 BECKER, Howard. Le monde de l’art. Flammarion, 1988 ↑
91 BOURDIN, Sylvie. Pour une médiologie des organisations. In Communications organisationnelles, objets, pratiques, dispositifs (textes réunis par Pierre Delcambre). Presse universitaire de Rennes, 2000. ↑
92 CASTORIADIS, Cornélius. Les carrefours du labyrinthe II : Domaines de l’homme. Seuil, 1986 ↑
93 VIRNO, Paulo. Grammaire de la multitude, pour une analyse des formes de vie contemporaines. Editions de l’éclat et conjonctures. 2001 ↑
94 BOUILLON, Jean-Luc. Gestion des connaissances productives et objets de communication professionnelle. In Communications organisationnelles, objets, pratiques, dispositifs (textes réunis par Pierre Delcambre). Presse universitaire de Rennes, 2000. ↑
95 COUTROT, Thomas. L’entreprise néolibérale, nouvelle utopie capitaliste ? Editions La Découverte, 1998 ↑
96 THUDEROZ, Christian. Du lien social dans l’entreprise, travail et individualisme coopératif. Revue française de sociologie XXXVI, 1995. ↑
97 VIRNO, Paulo. Grammaire de la multitude, pour une analyse des formes de vie contemporaines. Editions de l’éclat et conjonctures. 2001 ↑
98 PROUDHON, Pierre-Joseph. La Justice (1858) ↑
99 THUDEROZ, Christian. Du lien social dans l’entreprise, travail et individualisme coopératif. Revue française de sociologie XXXVI, 1995. ↑
Questions Fréquemment Posées
Comment l’intelligence collective influence-t-elle l’autogestion en 2023 ?
Cette nouvelle forme d’intelligence s’appuie sur de multiples échanges relationnels, favorisant le développement des liens interpersonnels et l’apparition de réseaux professionnels.
Quelles sont les caractéristiques d’une organisation autogérée ?
L’organisation autogérée s’appuie sur une socialisation des moyens d’information et de communication, encourageant tous les savoirs à se rencontrer pour s’enrichir mutuellement.
Pourquoi la taille d’une organisation autogérée est-elle importante pour l’intelligence collective ?
La taille réduite est la condition même du développement de l’intelligence collective, car celle-ci ne peut s’actualiser que dans des organisations dont la taille permet de dépasser la rationalité individuelle.