Le cadre théorique de l’autofiction révèle comment la mémoire personnelle façonne l’identité dans La Répudiation de Rachid Boudjedra. Cette étude met en lumière des dynamiques sociocritiques inattendues, transformant notre compréhension des relations familiales et du statut des femmes dans le récit.
Analyse sociocritique du récit :
La répudiation est un récit qui relate la vie de Rachid. C’est un narrateur qui va raconter et dire à sa compagne Céline les événements qui ont marqué son enfance et sa vie durant plusieurs années. C’est un récit qui décrit la société et son univers culturel suite à l’indépendance de l’Algérie. Le discours de Rachid est à la lisière de l’affabulation.
Néanmoins, il prend comme cadre l’Algérie de l’après-indépendance, un pays qui sort d’une guerre qui a laissé des séquelles au sein de la société algérienne. En effet, le texte que nous propose Rachid Boudjedra est tentaculaire et contient une multitude de détails sur le vécu et les conditions socioculturelles dans lesquels vivent les Algériens.
Le récit décousu et parfois onirique de notre personnage principal est plein de détails précis sur la société de l’époque avec néanmoins des régressions qui relèvent de l’ordre de l’imaginaire. Rachid décrit les événements le concernant selon son point de vue mais également selon une vision parfois mensongère afin de mieux séduire Céline qui l’écoute avec une insouciance.
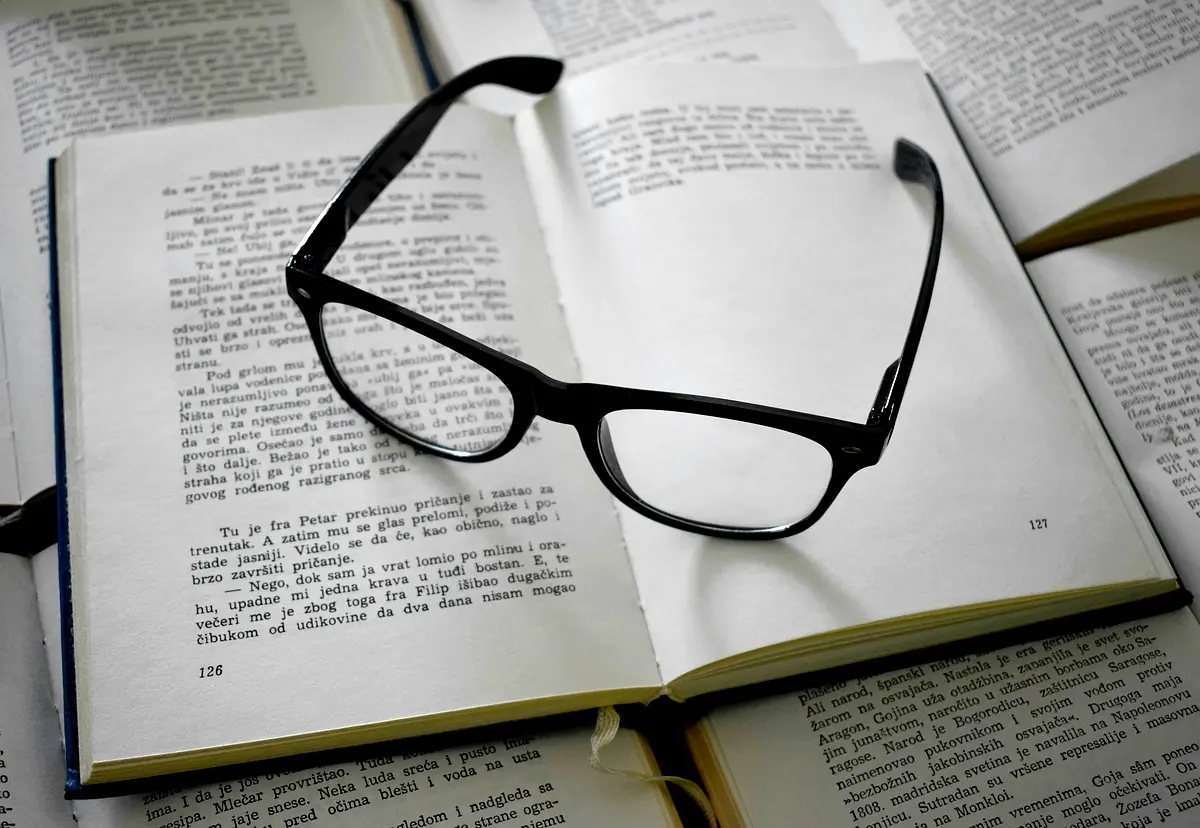
Rachid décrit à travers des réminiscences les fêtes religieuses et les fêtes de mariage : « pour ne pas rester en deçà de l’événement, accepta d’organiser les festivités. La mort sur le visage, elle prépara la fête »4. «A côté de la fête, il y avait aussi tout le reste ».5
Les soirées ramadanesques deviennent pour ainsi dire le lieu d’une interminable découverte de l’autre et une tentative de mieux sonder les comportements des membres de la tribu. C’est aussi le moment où les gens mangent trop le soir :
« les veillées se prolongeaient très tard et nous profitions de cette licence, malgré les surenchères des adultes qui nous écrasaient de leur jeûne ; notre abstinence, une fois poussée à bout, les terrifiait et nous faisions exprès de nous venger de l’insolence des caréneurs en affichant des mines épuisées et des visages pâles. L’on nous suppliait de cesser le jeûne mais nous criions au scandale et à l’hérésie : allait-on nous obliger à ne pas observer ce que Dieu avait prôné ? Nous restions donc maîtres du chantage et nous nous gavions, en cachette, de friandises et des restes de ripailles ». 6
Dans cet extrait, nous constatons que Rachid semble nous dire comment l’abstinence de manger et de boire devient le lieu d’expression d’une forme d’hypocrisie sociale. C’est à travers le paraître que les jeûneurs montrent une attitude de piété qui contraste avec la nature pernicieuse de la plupart d’entre eux. Rachid explique ainsi à Céline que la société est en fait factice et ne reflète point la vérité intrinsèque de chacun.
Les enfants sont ceux qui ont conscience de la supercherie des plus âgés. C’est pourquoi ils tentent à chaque occasion de les ridiculiser et de dévoiler ainsi ce simulacre de piété affectée et sans fondement réel. Le choix des mots de Rachid est aussi une façon de dire le caractère de ceux qui font semblant de suivre les dogmes et les préceptes du mois sacré.
L’abstinence n’est qu’une longue attente jusqu’au moment de profiter le soir d’une licence où l’interdit devient permis et où les enfants tentent de prolonger la nuit à travers une sorte d’insolence en imitant l’air des jeûneurs durant le jour. La représentation du jeûne dans ce passage est axée sur l’attitude de Rachid et de ses amis qui font office de témoins privilégiés d’une société factice et dont le vice ronge et détruit à la base.
4 La répudiation p 63. (sauf indication contraire, toute la numérotation qui va suivre fera référence au roman)
5 p 24.
6 P23.
Rachid explique à Céline que les gens du village attendent presque avec impatience le soir afin de manger et faire la fête. Il explique la fête selon un point de vue particulier où on trouve les coutumes et les traditions. C’est une société qui dépend qu’elle applique les règles religieuses.
Par contre, elle considère le mois de Ramadhan comme consacré seulement pour la nourriture : « Te dire que je n’aimais pas le mois de Ramadhan serait mentir. Nous savions guetter la lune. L’attente du mois sacré était bénéfique. Zahir s’arrêtait de boire pendant un mois. Ma reprenait espoir. La maison avait un air de fête.
On badigeonnait à la chaux toutes les pièces et en particulier la grande cour. On stockait pour un mois des comestibles rares et coûteux. Le carême n’était qu’un prétexte pour bien manger durant une longue période ».7
La société décrite par le narrateur de la répudiation est une communauté humaine vivant dans un village après l’indépendance de l’Algérie. Le héros du roman ainsi que ses compatriotes sont donc des paysans qui vivent dans une tribu à leur tête un chef. C’est une société fondée sur les droits dont jouissent les chefs de clan, une société où les hommes abusaient de leur pouvoir et où les femmes étaient soumises aux hommes :
« Le père vint demander conseil à Ma qui fut tout de suite d’accord. Les femmes lancèrent des cris de joie et ma mère, pour ne pas rester en deçà de l’événement, accepta d’organiser les festivités. La mort sur le visage, elle prépara la fête ; d’ailleurs, pouvait-elle s’opposer à l’entreprise de son mari sans aller à contre-courant des écrits coraniques et des décisions des mufris, prêts à l’entreprendre jour et nuit si elle avait eu la mauvaise idée de ne pas se résigner ? Ma ne querellait plus Dieu, elle se rangeait à son tour du côté des hommes. Ainsi, l’honneur du clan était sauf ».8
À cette époque, la notion du père occupe une place importante car c’est une société patriarcale : « Mon père, il ne venait plus à la maison où logeait l’énorme tribu, il n’en continuait pas moins d’avoir la haute main sur nous ».9
Cette société tribale repliée sur elle-même repose sur un certain nombre de structures à la fois sociales, politiques et économiques, qui en assurent la cohésion et le bon fonctionnement. Ce récit se focalise surtout sur la famille du narrateur Rachid et leurs conflits, leurs histoires d’amours et
7 P 19
8 P 63
9 P 85
de trahisons ainsi que de l’inceste. La société algérienne décrite dans le roman ne donne aucune valeur aux femmes, les filles sont mariées aux hommes âgés à un âge très tôt. La femme n’a pas le droit de parler, elle reste silencieuse et accepte tout ce qui se passe : « Ma mère est au courant, Aucune révolte ! Aucune soumission ! Elle se tait et n’ose dire qu’elle est d’accord. Aucun droit. »10.
Tout se résume à l’autorité incontournable du père : « mon père ne permettrait aucune manifestation. ».11
Elle est dans l’impossibilité de réagir car elle dépend toujours de son mari, elle organise la fête de mariage de son mari sans interagir.
Le discours social sur la famille révèle que le mariage est perçu plus comme un moyen assurant l’assouvissement des désirs du père, qu’une simple alliance entre deux individus. En effet, dans la société traditionnelle qui repose sur le pouvoir du chef de tribu, chaque homme a le droit de disposer de sa femme comme on dispose d’un objet : « Elle racontait que son mariage avec le père n’avait été que la conclusion d’une affaire financière ; sa mère, malgré sa grande connaissance des « noubas »
et des chants d’amour, était tombée entre les mains de si Zoubir et leurs rapports étaient mystérieux, sinon louches, car le mariage avait donné lieu à des tractations extraordinaires : la mère de ZouBida avait besoin d’argent ».12
Boudjedra dénonce les conditions de vie des Algériens pendant et après la colonisation en révélant que la souffrance de son peuple n’est pas terminée ; des prisons inhumaines restent ouvertes. La prison de Lambèse en est un grand témoignage, elle fut utilisée par les colons et le pouvoir avant et après l’indépendance.
Cette colonie pénitentiaire sert à emprisonner tous ceux qui s’opposent au pouvoir, Rachid nous expose la situation en quelques lignes : « je soupçonnais le Clan de m’avoir enfermé, avec l’accord de mon père, dans le bagne de Lambèse, en même temps qu’un grand nombre de détenus politiques qui y moisissaient depuis de longues années, sans avoir jamais été jugés ni même informés des charges retenues contre eux ».13 (Lambèse : c’est une ville militaire d’Afrique romaine se situant au
10 P 33
11 Ibidem
12 P 124
13 P 239
nord-est de l’Algérie sur le territoire de la commune de Tazoult dans la région des Aurès, à 10 km à l’est de Batna, sur la route de Timgad et de Khenchela.
Rachid Boudjedra traite le sujet de la sorcellerie, et c’est à travers la personnalité de sa mère qu’il apprend beaucoup sur ce phénomène. La mère est illettrée, elle ne sait ni lire ni écrire, mais elle est : « sorcière ». Ce qui veut dire qu’elle pratiquait la sorcellerie. Le narrateur indique que : « D’un nègre que nous allions consulter ma mère et moi, en cachette du père, et qui entrait en transe en se serrant la tête avec un fichu multicolore ; ventriloque et éboueur de son état, il utilisait ses siestes à délester les femmes de leur argent, en promettant le retour du mari perdu ». 14
L’auteur affirme que la répudiation de la mère perturbe non seulement son état mental, mais perturbe également profondément le comportement et la nature de l’enfant. Ainsi, le narrateur se venge de son père en ayant des relations avec ZouBida, sa maîtresse : « je couchais donc avec la femme légitime de mon père ». 15
En décrivant sa famille, le narrateur indique que : « Nous étions tous transpercés par la mort
».16 ; Il veut affirmer la malédiction sur la famille après le remariage de son père, indiquant que le mariage de son père est la principale raison de la séparation de la famille.
Ainsi, Boudjedra met en lumière un phénomène répandu dans le monde entier : la mendicité. Il traite ce phénomène dès les premières pages du roman, le narrateur nous dit que : « Dehors, nous avions quand même peur des mendiants acharnés à notre poursuite auprès des étrangers en visite dans la ville », « les mendiants qui infestent la ville ».
14 P 86
15 P 133
16 P 124
________________________
4 Définition donnée par l’article 62 de la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai 2001. ↑
5 Auchan Les 4 Temps, La Défense. ↑
Questions Fréquemment Posées
Comment l’autofiction est-elle utilisée dans ‘La Répudiation’ de Rachid Boudjedra ?
L’autofiction dans ‘La Répudiation’ permet de relater la vie de Rachid et de décrire la société algérienne après l’indépendance, tout en mêlant réalité et affabulation.
Quel est le rôle de la mémoire dans le récit de Rachid Boudjedra ?
La mémoire joue un rôle crucial dans le récit, car Rachid évoque des événements marquants de son enfance et de sa vie, tout en utilisant des réminiscences pour construire son récit.
Comment Rachid Boudjedra aborde-t-il le thème de la société algérienne dans son roman ?
Rachid Boudjedra aborde la société algérienne en décrivant ses conditions socioculturelles, les fêtes religieuses et les comportements hypocrites des membres de la tribu, révélant ainsi une société factice.