Les stratégies d’implémentation fiscales sont essentielles pour la pérennité des PME camerounaises. Cette étude révèle comment une gestion proactive du risque fiscal, illustrée par le cas de BKOUASS-Sarl, peut transformer les défis en opportunités, avec des implications cruciales pour le développement entrepreneurial en Afrique.
2.2. Les freins au développement des PME africaines
Les barrières au développement des PME peuvent être de diverses natures, environnementales, financières ou managériales (Oirya, 2010). En complément à la discussion précédente sur l’écosystème entrepreneurial, notre réflexion va se limiter aux éléments externes qui peuvent influencer négativement le développement des PME en Afrique subsaharienne (ASS) tel qu’ils ont été révélés dans différents travaux de recherche.
Mambula (2002) a réalisé une enquête auprès de 32 PME au Nigéria pour identifier les différents facteurs qui limitent la croissance et le développement de ces entreprises. Les dirigeants rencontrés désignent, le manque de financement, la mauvaise qualité des infrastructures (mauvaises routes, fourniture irrégulière et insuffisante de l’eau et de l’électricité, mauvaise qualité du système de télécommunications), l’accès difficile aux équipements, pièces de rechange et à la matière première parmi les principaux obstacles au développement de leur entreprise. Ces dirigeants ont aussi mentionné l’absence de relations avec les instituts de recherche que ce soit pour obtenir des informations relatives aux marchés, aux opportunités d’affaires ou aux méthodes de développement de nouveaux produits.
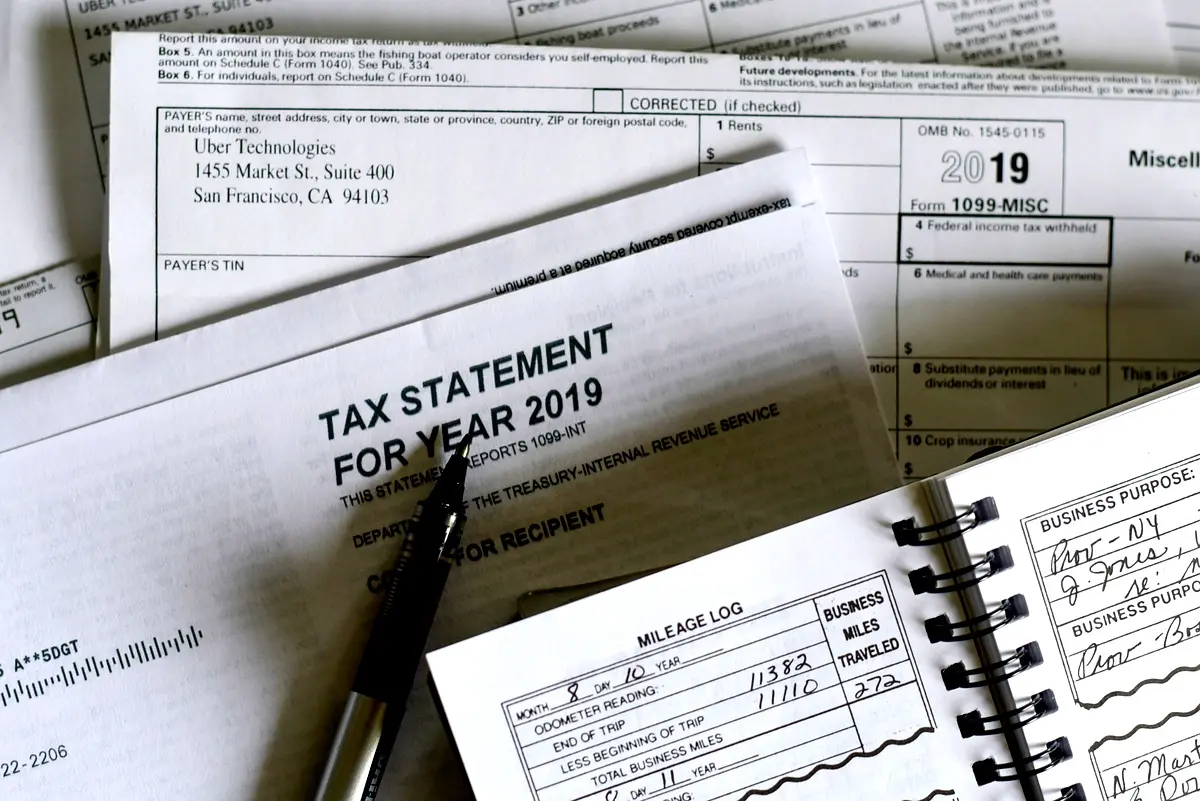
Au Nigéria, Obokoh (2008), à la suite d’une enquête auprès de 369 PME manufacturières de la ville de Lagos, a identifié les éléments suivants parmi les principaux facteurs d’échec de ces entreprises : l’accès au financement (qui serait dû au fait que le cadre légal et réglementaire ne soit pas adapté pour protéger les prêteurs), l’incohérence dans l’application des politiques gouvernementales pour le développement des PME (souvent conçu sans prendre en compte la nature et le niveau d’éducation des bénéficiaires).
En plus de cette incohérence, il y aurait aussi une insuffisance de fonds nécessaires pour l’application de ces politiques, un manque de personnel qualifié par rapport à l’ampleur des besoins (Mambula, 2002). Mambula (2002) note également que les différences au niveau de la langue, de la culture et de la religion seraient très importantes parmi les entrepreneurs et rendent la tâche encore plus difficile pour les agents publics (fonctionnaires).
Tushabomwe-Kazooba (2006) a conduit une étude mixte (entrevue et questionnaire) auprès de 133 dirigeants de PME actives dans deux localités (Bushenyi et Mbarara) de l’Ouganda pour identifier les causes de l’échec de ces entreprises. Il observe ainsi plusieurs facteurs internes (absence de comptabilité, imbrication entre la famille et l’entreprise, absence de plans d’affaires, etc.) et externes. Parmi les facteurs externes, la fiscalité vient en tête de classement; à cet élément, il faut rajouter les coupures d’électricité, l’absence de capital, le prix élevé des loyers.
A partir de données secondaires, Ishengoma et Kappel (2011) analysent l’évolution de l’environnement des affaires en Ouganda de 2004 à 2010 où ils observent une détérioration au cours de cette période.
Cette analyse fait également ressortir certains facteurs externes comme étant les plus grandes contraintes au développement des entreprises : accès limité au financement, corruption, faible qualité des services publics, taxes élevées, inefficience des services administratifs. Cette étude a été enrichie par une enquête réalisée auprès de dirigeants de PME.
Les résultats de cette enquête montrent que la croissance des PME est positivement associée à l’accès aux services de développement des entreprises5 et au financement; en effet, ces ressources « may enable a firm to produce quality products and access the market at low transaction costs » (Ishengoma et Kappel, 2011, p. 360). D’autre part, un accès limité aux ressources productives (financement, services de développement des entreprises), des taxes élevées et un accès limité au marché sont apparus négativement associés à la croissance des PME dans cette étude.
La corruption ferait aussi partie des principales entraves au développement des entreprises en Afrique. Ce phénomène n’est pas exclusif au continent africain mais il y prendrait des proportions très importantes, tout au moins en ce qui concerne les entreprises. Selon certaines estimations, la corruption représenterait une part du chiffre d’affaires bien plus importante que celle observée ailleurs : « plus de treize fois ce que paient les entreprises asiatiques, et plus du double de ce qui est versé dans les autres régions. » (Bigsten et Söderbom, 2006, p. 100). Bigsten et Söderbom (2006), notent que les PME paient proportionnellement plus de pots-de-vin que les grandes entreprises en Afrique.
En matière d’énergie, le continent africain est celui où les entreprises subissent le plus l’irrégularité de la fourniture d’électricité. Les entreprises africaines manquent d’électricité, en moyenne, pendant 13% de leur temps de fonctionnement, c’est deux fois plus qu’en Asie du Sud, qui est au deuxième rang du classement, avec seulement un taux de 7% (Larossi, 2009).
En 2007, la Banque Mondiale a évalué à 90,9 jours par an la durée moyenne des coupures d’électricité (délestages); ceci peut représenter un manque à gagner important pour les entreprises. Dans cette partie du monde, l’électricité n’est pas seulement rare, elle est aussi chère. Larossi (2009) note qu’en Asie, les entreprises paient leur électricité, en moyenne 7% moins cher que celles d’Afrique, en Inde et au Vietnam c’est 11% de moins.
Après avoir analysé le coût de l’électricité dans 48 pays en développement (dont 19 africains), cet auteur a conclu que l’Afrique n’est pas du tout compétitive sur le plan énergétique, malgré les disparités qui existent entre les différents pays africains.
Sur le plan des télécommunications, Onyeiwu (2002) a évalué le niveau de développement des technologies de l’information de 54 pays africains. Les résultats de cette étude montrent une différence significative entre les pays avancés et les autres. Des pays comme l’Afrique du Sud, la Namibie, le Botswana enregistrent un indice de développement technologique supérieur à 7, alors que la majorité des autres pays ont un score inférieur à 0,4.
En 2013, l’Union Internationale des télécommunications (UIT)6 a estimé à 16,8% le nombre d’individus utilisant internet en Afrique. Dernier de ce classement dominé par l’Europe (73,1%), l’Afrique est précédée par l’Asie et le Pacifique avec 30,1%. Au Cameroun, pour la même année, soit 2013, ce taux s’élève à 6,40% comparativement à 37,50% pour la Cap-Vert, 20,90% pour le Sénégal, et 16,40% pour la Guinée Équatoriale. Ce retard technologique n’est certainement pas sans effet sur le développement des entreprises locales et sur leurs capacités à s’insérer dans l’économie mondiale.
Dans un autre ordre d’idées, au Sénégal, selon Tiberghien (1989, p. 450), le bon fonctionnement d’une entreprise dépendrait de la qualité des relations avec les administrations publiques, les grandes sociétés privées, les gros commerçants. Au Nigéria, Okpara et Wynn (2007) observent que les activités politiques influencent négativement le développement des PME; les marchés publics étant généralement accordés comme récompenses politiques (aux supporteurs ou contributeurs financiers) et pas aux entreprises les plus compétentes. En Ouganda, Tushabomwe-Kazooba (2006) note que les affinités politiques permettent d’éviter de payer les taxes, d’empêcher les contrôles fiscaux et contribuent même à la fidélisation de la clientèle. Le « réseau » du dirigeant apparait comme un facteur de réussite incontournable dans cet environnement.
En conclusion, le financement, les infrastructures de base (telles que télécommunications, électricité) et la corruption apparaissent comme étant des faiblesses importantes de l’écosystème entrepreneurial ou de l’environnement d’affaires dans différents pays africains. Il est aussi intéressant de noter que la corruption, le niveau de revenus (évalué avec le PIB par habitant), l’utilisation des TIC (technologies de l’information et de la communication), le niveau d’éducation ont été identifiés parmi les variables les plus explicatives du développement entrepreneurial7, dans une étude réalisée avec les données de 118 pays (dont le Cameroun)8 (Driouchi et Gamar, 2015). Dans le but de mieux illustrer les freins à la croissance des PME africaines, le tableau suivant vous est présenté.
Tableau 3 : Taille et freins à la croissance des entreprises
[7_strategies-implementation-fiscales-pour-pme-au-cameroun_6]
Source : St Pierre Ethal
À la prochaine section, nous nous intéressons au cas particulier du Cameroun et les facilités pour faire des affaires dans ce pays.
5 BDS : Business Development Services. ↑
6 http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx consulté le 08 novembre 2014. ↑
7 La corruption étant le seul élément ayant un effet négatif. ↑
8 Pour cette étude, les auteurs se sont servis des données de différentes enquêtes internationales provenant de diverses institutions tel que : Banque mondiale, Forum économique mondial, Doing Business, World Heritage, Global Entrepreneurship and Development Institute, etc. ↑
________________________
Questions Fréquemment Posées
Quels sont les principaux freins au développement des PME en Afrique?
Les principaux freins au développement des PME en Afrique incluent le manque de financement, la mauvaise qualité des infrastructures, l’accès difficile aux équipements et matières premières, ainsi que l’absence de relations avec les instituts de recherche.
Comment la fiscalité affecte-t-elle les PME au Cameroun?
La fiscalité est considérée comme l’un des principaux facteurs d’échec des PME, avec des taxes élevées et une incohérence dans l’application des politiques gouvernementales qui impactent leur développement.
Quels facteurs externes limitent la croissance des PME en Afrique subsaharienne?
Les facteurs externes limitant la croissance des PME en Afrique subsaharienne incluent l’accès limité au financement, la corruption, la faible qualité des services publics, et les taxes élevées.
