La défense socioculturelle au Congo révèle des mécanismes de communication interculturelle souvent méconnus. Cette recherche innovante met en lumière comment les croyances influencent les interprétations des événements, offrant ainsi un cadre théorique essentiel pour comprendre les dynamiques sociales contemporaines.
- Communications généralisées et contextualités situationnelles de « l’interprétation subjective (rationnalisation) »
- Description de cas
- Communications généralisées et contextualités situationnelles de « l’interprétation subjective (rationnalisation) »
Pour comprendre la manière dont les acteurs sociaux congolais produisent le « déplacement » dans un contexte multiculturel, les sujets enquêtés ont été invités à tour de rôle à discuter autour du thème ci-après : « Les gens de votre milieu ont tendance à vouloir comprendre les événements en fonction de leurs croyances ».
Les données recueillies de ces échanges peuvent être résumées comme suit436 :
- Bandundu : Souvent, nous avons tendance à éviter les Kinoises portant des tenues collantes, car nous évitons d’être influencés par cette indécence. Ces personnes reflètent une mauvaise image dans notre société, à l’instar des prostituées. Cette vision est illustrée dans le proverbe kikongo « malala ya mbote boke vukisaka ve na ya mbi » se traduisant en français « on ne mélange pas une orange pourrie avec les saines »
- Bas-Congo : Très souvent : les Bakongo ont tendance à vouloir comprendre les événements en fonction de leur croyance, car selon eux tout événement malheureux vient des forces maléfiques ou de mauvais sorts. Dans cette optique, le dysfonctionnement de la Cimenterie de Lukala (Cilu) peut être expliqué par le fait qu’elle est gérée par un Kasaïen, un non originaire qui n’a pas la philosophie de bâtir comme un vrai Mukongo.
- Equateur : Très souvent, les étrangers sont libres chez nous de faire ce qu’ils veulent. Mais, lorsque les autochtones se sentent lésés par un étranger, ils n’hésitent pas à recourir aux féticheurs parmi les pygmées pour lui jeter un mauvais sort.
- Kasaï Occidental : Très souvent les Kasaïens attribuent tout événement malheureux à la sorcellerie. Ceci dit, tout enfant suspect est perçu comme sorcier. Le Kinois est perçu comme un « blanc » parce qu’il est branché sur l’actualité et la mode. Il parle bien le lingala et a plus d’avantages que d’autres du fait qu’il habite dans la capitale.
- Kasaï Oriental : Souvent, les étrangers sont bien accueillis chez nous ; ils sont toutefois appelés à respecter nos croyances et nos valeurs. Celui qui va à l’encontre de celles-ci est rejeté de notre société. Lorsque les autochtones se sentent lésés par un étranger, ils n’hésitent pas à recourir aux féticheurs pour lui jeter un mauvais sort.
- Katanga : Quelquefois, les Katangais cherchent à interpréter les événements, comme la mort d’une personne, par la sorcellerie, le fétiche ou le poison. Tout étranger qui va à l’encontre des règles et valeurs peut être châtié par l’une de ces pratiques.
- Kinshasa : Souvent, il nous arrive de croire que les ressortissants de l’intérieur du pays, peu importe leur provenance (ville ou village), sont des « sorciers », des « ingrats ou pas reconnaissants ». Une fois qu’ils maîtrisent l’environnement kinois, ils deviennent têtus et impolis. De nombreuses personnes que nous avons hébergées chez nous ou chez les voisins nous ont permis de tirer telles conclusions.
- Maniema : Souvent, notre peuple a sa propre croyance, par exemple nous croyons aux fétiches, à la sorcellerie. La majorité est constituée de musulmans, mais nous sommes tolérants les croyances des autres.
- Nord-Kivu : Souvent, chez nous les gens se prennent en charge, même l’aveugle est pris en charge par sa famille. C’est à peine que nous commençons à voir les enfants de la rue qui sont différents des Kulunaires437 de Kinshasa et des Wayapars de Lubumbashi (Katanga).
- Province Orientale : Très souvent, il nous arrive de croire que les gens pensent que quand une fille est mince, elle est encore vierge. En revanche, lorsqu’elle se développe physiquement, on se dit qu’elle commence à être courtisée par des hommes. Cependant, toutes les filles grasses, d’après les croyances du milieu, ont déjà été déviergées. Aussi
bien, nous avons tendance à vouloir tout expliquer par la mystique (le Satan ou la sorcellerie), surtout en cas d’échec.
- Sud-Kivu : Très souvent, il nous arrive de nous accrocher à notre culture et pour la perpétuer dans d’autres générations, tous les enfants sont obligés d’apprendre la langue maternelle.
Toutes ces données sont analysées en termes d’éléments communicationnels (généralisés et contextuels) dans le paragraphe qui suit en fonction de « tableau panoramique de dépouillement » (voir le tableau n°08) et de la « grille d’analyse » (voir tableau n°09).
- Analyse des éléments communicationnels (généralisés et contextuels)
Il est question à ce stade de dégager les éléments de la communication généralisée et de la contextualité situationnelle à partir des discours (réactions) des sujets enquêtés décrits ci-haut. Le tableau panoramique n°19 résume les éléments de cette analyse.
Tableau n°19 : Tableau panoramique de mécanisme d’interprétation subjective
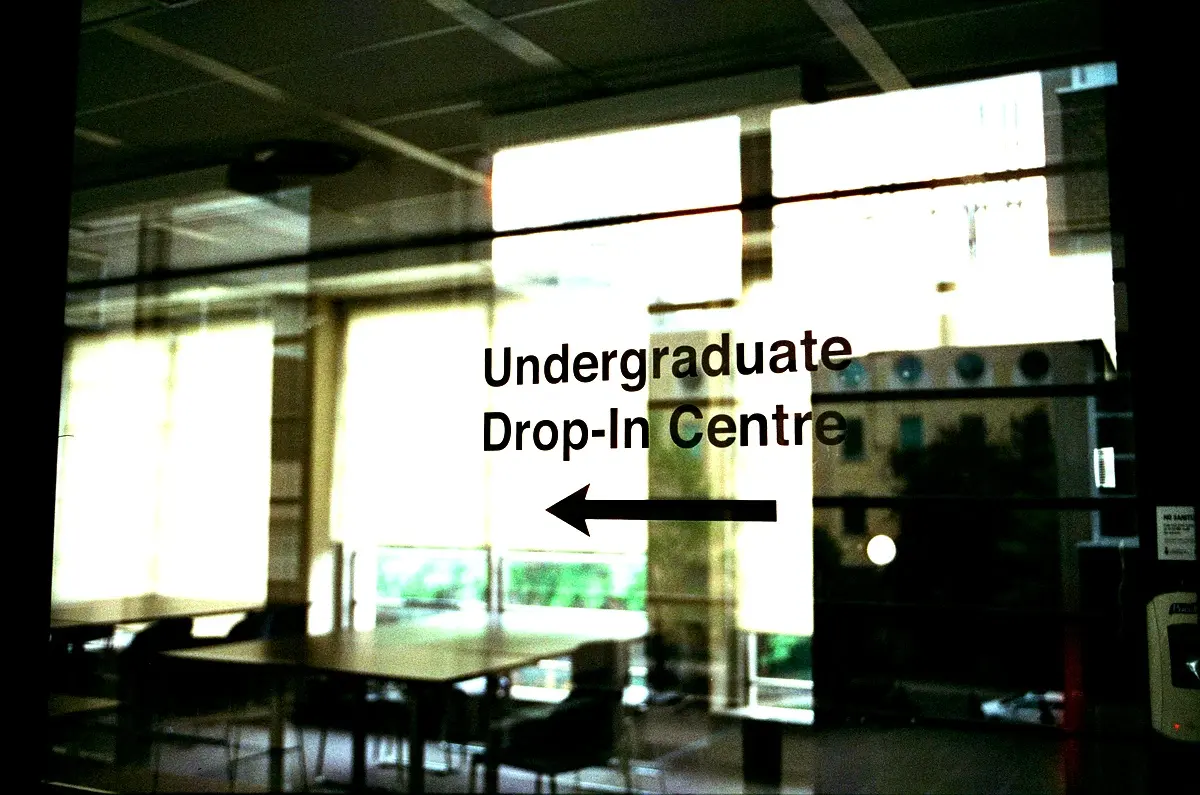
N° | Elément Acteur | Communication généralisée | Contextualité situationnelle | Valeur significative | |||
Norme | Enjeu | Positionnement | Qualité des relations avec les autres acteurs | ||||
1. | Bandundu |
| – Valorisation des principes, habitudes et règles de soi |
ses normes (habitudes et règles) |
|
| – |
2. | Bas-Congo |
| – Valorisation des principes, habitudes et règles de soi |
règles) |
|
| – |
3. | Equateur |
| – Valorisation des habitudes et règles des autres culturels |
|
|
| + |
4. | Kasaï Occidental |
| – Valorisation des habitudes et règles des autres culturels |
|
|
| + |
5. | Kasaï Oriental |
| – Valorisation des principes, habitudes et règles de soi |
|
|
| – |
6. | Katanga |
| – Valorisation des principes, habitudes et règles de soi |
règles) |
|
| – |
7. | Kinshasa |
| – Valorisation des principes, habitudes et règles de soi |
ses normes (habitudes et règles) |
|
| – |
8. | Maniema |
| – Valorisation des habitudes et règles des autres culturels |
|
|
| + |
9. | Nord-Kivu |
| – Valorisation des principes, habitudes et règles de soi |
ses normes (habitudes et règles) |
|
| – |
10 . | Province Orientale |
| – Valorisation des principes, habitudes et règles de soi |
ses normes (habitudes et règles) |
|
| – |
11 . | Sud-Kivu |
| – Valorisation des principes, habitudes et règles de soi |
règles) |
|
| – |
Il ressort du tableau n°19 les constats ci-après :
- Huit provinces pratiquent l’« interprétation subjective » (soit 73 %). Il s’agit de : Bandundu, Bas-Congo, Kasaï Oriental, Katanga, Kinshasa, Nord-Kivu, Province Orientale et Sud-Kivu. D’après les discours analysés, ces provinces véhiculent des valeurs négatives à l’égard des autres culturels, notamment le sentiment de rejet des autres, la méfiance et la tendance égocentrique. Certaines ont même manifesté de tendance tribale ;
- Trois provinces ne pratiquent pas ce mécanisme (soit 27 %), il s’agit de l’Equateur, du Kasaï Occidental et du Maniema. Elles développent des valeurs positives à l’égard des autres culturels comme le sentiment d’acceptation des autres culturels, la confiance et l’altruisme (tendance grégaire)
________________________
Questions Fréquemment Posées
Quels sont les mécanismes de défense socioculturelle observés au Congo?
Les mécanismes de défense socioculturelle incluent des croyances liées à la sorcellerie, des interprétations des événements en fonction des croyances locales, et des réactions face aux étrangers, comme le recours aux féticheurs.
Comment la communication interculturelle est-elle perçue dans différentes provinces du Congo?
Dans différentes provinces, la communication interculturelle est influencée par des croyances variées, comme la perception des étrangers, l’attribution d’événements malheureux à la sorcellerie, et des attitudes envers les pratiques culturelles des autres.
Pourquoi les Kasaïens attribuent-ils des événements malheureux à la sorcellerie?
Les Kasaïens attribuent souvent des événements malheureux à la sorcellerie car ils croient que tout enfant suspect peut être perçu comme sorcier, reflétant une interprétation culturelle des malheurs.