Les défis et solutions en communication interculturelle révèlent des mécanismes de défense insoupçonnés dans le contexte congolais. Cette recherche innovante, alliant psychologie interculturelle et méthodologies mixtes, promet de transformer notre compréhension des interactions socioculturelles.
DEUXIEME PARTIE CADRE METHODOLOGIQUE ET PRESENTATION DES DONNES
EMPIRIQUES
Nous venons, dans la première partie de notre travail, de construire notre cadre conceptuel et théorique. Il nous reste à présenter les « données empiriques de l’étude » en vue de valider notre hypothèse de recherche. Mais avant d’y arriver, nous allons d’abord construire notre cadre méthodologique qui va donner des orientations sur les démarches à suivre dans la collecte et l’exploitation (dépouillement et analyse) de ces données. C’est ce qui justifie ici « le cadre méthodologique » au quatrième chapitre, « l’analyse des mécanismes psychiques de base et situationnels » au cinquième chapitre, « l’analyse des mécanismes discriminatoires et ethniques » au sixième chapitre et « l’analyse quantitative des données et l’interprétation des résultats » au septème chapitre.
Ainsi, les cinquième et sixième chapitres vont essentiellement se baser sur des analyses qualitatives des données empiriques. Ces analyses consisteront d’abord, à décrire les cas recueillis lors des enquêtes réalisées auprès des étudiants de l’Institut Facultaire des Sciences de l’Information et de la Communication (IFASIC), ensuite, à présenter dans des tableaux panoramiques les résumés de ces données en termes de communications généralisées à partir desquelles sont déduits les éléments de la contextualité situationnelle pour les onze provinces par rapport à chaque mécanisme. Les données fournies dans chaque tableau vont nous permettre de dégager les éléments communs à toutes les provinces ainsi que les éléments distincts en termes de constats.
Enfin, le dernier chapitre s’emploiera d’une part, à consolider les résultats des analyses qualitatives précédentes avec les techniques d’analyse statistique et, d’autre part, à confronter les constats (résultats) de nos analyses aux théories et résultats des études antérieures à la lumière de notre modèle de recherche en vue de valider l’hypothèse de recherche.
Chapitre IV : METHODOLOGIE DE TRAVAIL
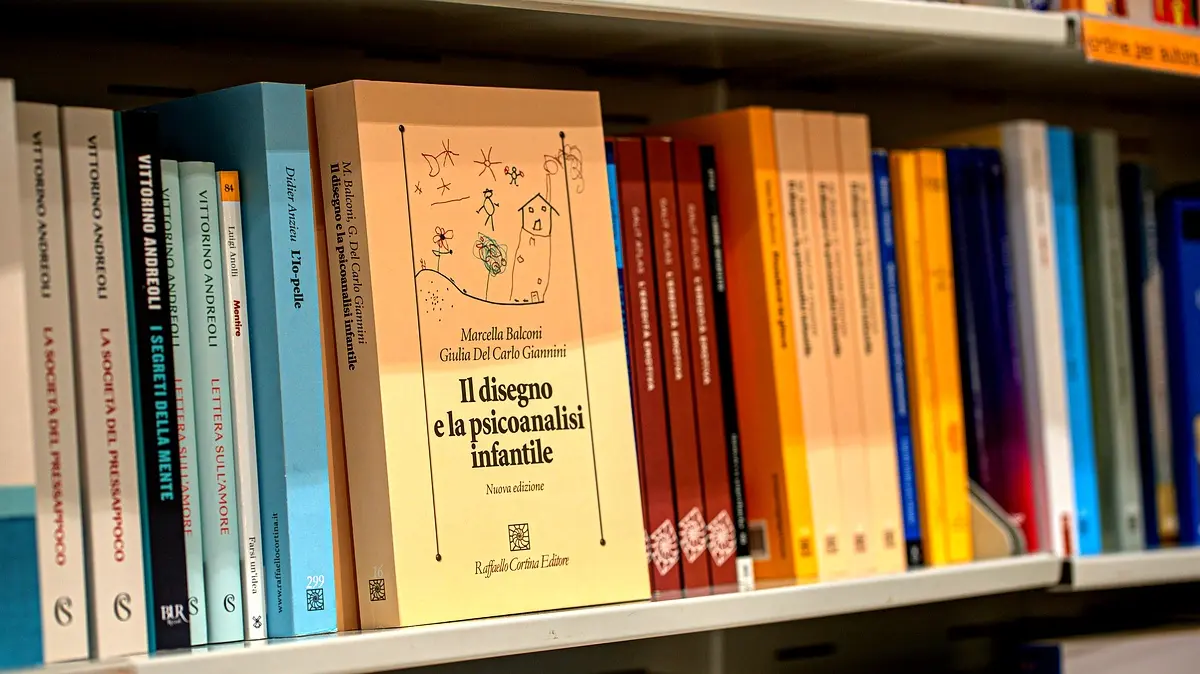
Comme nous venons de le souligner dans les pages précédentes, le paradigme constructiviste impose au chercheur de construire les contextes interprétatifs aux émergences prévues puisqu’il n’existe pas de théories puissantes. La méthodologie qualitative semble alors être plus appropriée à ce type de quête ; parce qu’elle est caractérisée essentiellement par l’implication du chercheur dans le maniement de la technique à utiliser. Mais par souci de garantir le principe de triangulation afin de contourner les limites que nous impose cette méthodologie, nous allons y associer la méthodologie quantitative. Ainsi, ce quatrième chapitre va décrire à tour de rôle les éléments relatifs à ces méthodologies, à la population et l’échantillon de l’étude.
Section 1 :
Méthodologie qualitative de l’étude
Ce premier paragraphe traite successivement de trois éléments de notre méthodologie qualitative : la méthode de contextualisation situationnelle panoramique, qui est l’une des méthodes constructivistes qualitatives, la technique d’ESDC pour la collecte des données et la technique de contenu pour l’analyse des données. Ces deux techniques viennent en appui à la méthode choisie.
- Méthode de contextualisation situationnelle panoramique
Dans leur ouvrage intitulé Etude des communications : Approches constructivistes, Alex Mucchielli et Claire Noy382 ont défini au total sept méthodes de contextualisation inspirées de l’approche constructiviste, applicables à toute étude des communications. Il s’agit des méthodes de contextualisation : actionniste, situationnelle panoramique, situationnelle dynamique, par les communications concomitantes, culturelle iconique, systémique des échanges, par les champs de l’expérience et de l’interaction. Ces méthodes sont fondées sur la construction, par le chercheur, du contexte interprétatif qu’il veut prendre pour analyser les phénomènes et ce sont, par nature, des méthodes qualitatives.
En ce qui nous concerne, notre étude vise à analyser les significations des comportements des individus placés dans une situation d’interculturalité. Cette situation est pluri-ethnique, et celle-ci donne des contextes différents de communication. Dans ce cas, la méthode de contextualisation situationnelle panoramique paraît la mieux indiquée.
Les paragraphes ci-après décrivent en détails le contenu de cette méthode : la description, les concepts clés, les principes d’utilisation et les étapes.
382 MUCCHIELLI, A. et NOY, C., op.cit, pp. 53-218.
- Description de la méthode
La méthode du tableau panoramique, inspirée d’Alex Mucchielli et Claire Noy383, permet de réaliser une « contextualisation situationnelle » tenant compte de diverses définitions de la situation créée par les acteurs impliqués dans cette situation. C’est une méthode d’analyse compréhensive d’une situation, établie du point de vue d’un observateur distant et en position de surplomb, qui vise à tenir compte des interprétations différentes de la même situation engendrées par les différents acteurs qui sont partie prenante de cette situation. Cette méthode part donc du principe que les différents acteurs d’une situation ont des définitions différentes de cette situation.
Cette méthode met en évidence les différentes définitions en les faisant apparaître dans un tableau qui montre les éléments pertinents de différents contextes constitutifs de la situation pour chaque acteur. Ici, le chercheur a la mission de présenter aux acteurs un récit contenant une intrigue (ou une problématique) à laquelle ils vont réagir.
Il s’agit donc d’une méthode des cas. Cette méthode est une « stratégie de recherche adéquate quand la question de recherche débute par « pourquoi » ou « comment ». Elle vise la compréhension des dynamiques présentes au sein d’environnements spécifiques »384. C’est une enquête empirique qui « examine un phénomène contemporain au sein de son contexte réel lorsque les frontières entre phénomène et contexte ne sont pas clairement évidentes et pour laquelle de multiples sources de données sont utilisées »385.
Les données recueillies auprès de différents acteurs de cette situation sont consignées dans un tableau. Le tableau dit « panoramique » permet, ensuite, de faire des analyses à partir de la comparaison des définitions des situations perçues par les acteurs. Il sert de grille pour l’écriture du cas et donc pour le recueil des données. Ci-après un descriptif de ce tableau (n°06).
Tableau n°06 : Tableau panoramique pour l’étude des situations386
Elément Acteur | Communication généralisée significative | Elément « induit » de la situation | |||
Enjeu | Norme | Position | Relation | ||
Acteur 1 | |||||
Acteur 2 | |||||
……… | |||||
Acteur n | |||||
Pour sa constitution, ce tableau nécessite les éléments ci-après :
383 MUCCHIELLI, A. et NOY, C., op.cit, pp. 83-84.
384 GOMBAULT, A., « La méthode de cas », in ROUSSEL, P. et WACHEUX, F. (dir), op.cit, p. 32. 385 YIN, R., Case study research: Design and methods, Beverly Hills, Sage publications, 1990, p. 13. 386 MUCCHIELLI, A. et NOY, C., op.cit, p. 84.
- La colonne 1, identifie les acteurs impliqués dans la situation. Frederick Wacheux avance trois raisons de s’intéresser aux acteurs dans une recherche constructiviste 387:
- les acteurs produisent et reproduisent les faits sociaux dans une construction du temps et de l’espace qu’ils maîtrisent plus ou moins ;
- la rationalité limitée et les théories implicites des acteurs entrent, de fait, dans l’analyse à partir de ce qui est considéré comme important pour eux ;
- les acteurs ont naturellement une connaissance immédiate de leur signification (savants ordinaires) et ils ne comprennent pas souvent l’intérêt d’être engagé dans une démarche de recherche (primat de la praxis).
Il sied de rappeler que le concept d’acteur a été analysé dans les pages précédentes. Pour nous, les acteurs qui font partie de notre étude sont des Congolais de différentes provinces.
- La colonne 2, relève, dans un cadre temporel qui reste à déterminer par le chercheur, des « communications généralisées significatives » des différents acteurs. Ce type de communication concerne les communications qui sont marquantes ou récurrentes et typiques ;
- Les colonnes 3 à 6 regroupent, à partir des renseignements recueillis auprès des acteurs par interview ou par observation, les éléments constitutifs des contextes de la situation pour chaque acteur (enjeu, norme, position et relation). Nous allons chercher à distinguer dans ces données, sur base de la philosophie de Ricoeur388, les événements infrasignificatifs (le descriptif de ce qui arrive dans le contexte vécu ou non), l’ordre et le règne du sens (le non-événementiel auquel les acteurs font référence dans leur discours) et l’émergence d’événements supra-significations (la construction narrative d’identité fondatrice).
Une fois le tableau rempli, des comparaisons entre les définitions des situations sont possibles. Elles donnent lieu à des commentaires analytiques en fonction du problème pratique que l’on veut traiter, du point de vue des acteurs (interventions) ou du point de vue scientifique (formalisation d’un type de problème).
________________________
382 MUCCHIELLI, A. et NOY, C., op.cit, pp. 53-218. ↑
383 MUCCHIELLI, A. et NOY, C., op.cit, pp. 83-84. ↑
384 GOMBAULT, A., « La méthode de cas », in ROUSSEL, P. et WACHEUX, F. (dir), op.cit, p. 32. ↑
385 YIN, R., Case study research: Design and methods, Beverly Hills, Sage publications, 1990, p. 13. ↑
386 MUCCHIELLI, A. et NOY, C., op.cit, p. 84. ↑
387 Frederick Wacheux avance trois raisons de s’intéresser aux acteurs dans une recherche constructiviste. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quels sont les défis de la communication interculturelle au Congo ?
L’étude examine les mécanismes de défense socioculturelle qui représentent des défis dans la communication interculturelle au Congo.
Comment la méthodologie qualitative est-elle appliquée dans l’étude de la communication interculturelle ?
La méthodologie qualitative est caractérisée par l’implication du chercheur et utilise des techniques comme la méthode de contextualisation situationnelle panoramique et la technique d’ESDC pour la collecte des données.
Quelle est l’importance de la triangulation dans la recherche sur la communication interculturelle ?
La triangulation est importante pour contourner les limites de la méthodologie qualitative en associant des approches quantitatives, garantissant ainsi une validation plus robuste des résultats.