Les applications pratiques de la communication révèlent des mécanismes de défense insoupçonnés dans le contexte congolais. Cette étude innovante, alliant psychologie interculturelle et méthodologies mixtes, offre des perspectives essentielles pour comprendre les dynamiques socioculturelles contemporaines.
- Eléments significatifs de la contextualité situationnelle
Alex Mucchielli et Clair Noy159 distinguent sept éléments de la contextualité situationnelle. Il s’agit de : contextualité normative, contextualité des enjeux, contextualité de positionnement, contextualité relationnelle, contextualité temporelle, contextualité spatiale, contextualité physique et sensorielle. Chacun de ces sous-systèmes d’objets cognitifs représente donc une des dimensions de tout « contexte global » dans lequel s’inscrit un phénomène de communication. C’est en intervenant sur ces différents contextes à travers les processus de la communication que les acteurs vont transformer les sous-contextes et vont participer à la construction du sens de leurs échanges puisque, par définition, ce sens surgit d’une mise en contexte des phénomènes communicationnels.
En ce qui nous concerne, nous nous intéressons ici à la norme, aux enjeux culturels, au positionnement et aux relations avec les autres.
Norme
Le contexte normatif est l’une des dimensions de référence de toute situation de communication entre les acteurs. Il est constitué par l’ensemble des normes présentes, implicitement ou explicitement, dans une situation.
Cependant, la norme est l’un des éléments-clés qui fondent la culture, laquelle détermine les conduites typiques d’un groupe ou d’un individu. Pour Mulumba Ngasha160, les normes sont entendues dans le sens d’obligations sociales acceptées, dont les contrevenants subissent des sanctions de la part des membres de la société. Elles constituent aussi des moyens par lesquels la société agit sur l’action sociale des individus. Par les normes sociales, le groupe ou la société oriente l’action sociale des individus dans le sens souhaité par les autres membres du groupe, et de ce fait, la rend significative et cohérente non seulement aux yeux du sujet lui-même qui agit, mais aussi aux yeux des autres membres du groupe.
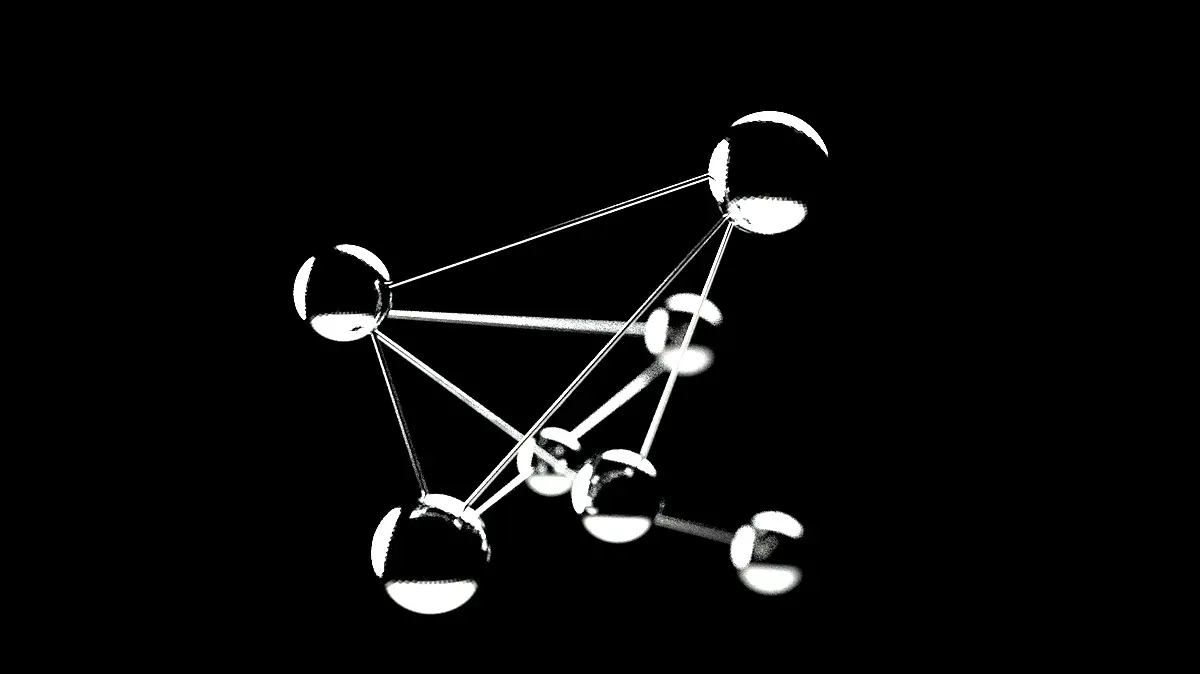
Jacques-Philippe Leyens161 affirme, d’une part que la norme est une échelle de référence ou d’évaluation, qui définit une marge de comportements, attitudes et opinions permis et répréhensibles. D’autre part, la norme est l’acceptation partagée d’une règle qui est une prescription en ce qui concerne la façon de percevoir, de penser, de sentir et d’agir.
Georg Bossong162, quant à lui, confère à la norme le statut d’une convention sociale à demi-consciente. Elle existe sous la forme d’un ensemble de règles, assimilées individuellement et mises en pratique quotidiennement par un groupe de locuteurs plus ou moins grand, d’une façon plus ou moins homogène. Elle est à demi consciente, ce qui revient à dire qu’elle fonctionne normalement sans réflexion, mais que son statut et les problèmes qu’elle soulève peuvent être l’objet d’une réflexion et d’un examen conscients de la part du locuteur à n’importe quel moment.
Enfin, les normes préexistent toujours aux échanges. Ceux-ci prennent sens par rapport à celles-là normes, mais aussi les acteurs sociaux, à travers leurs échanges, participent à la construction des référents normatifs de leurs propres échanges.
Enjeu culturel
Le contexte enjeu culturel est l’une des dimensions de référence de toute situation de communication entre les acteurs. Il est constitué par l’ensemble des influences présentes, implicitement ou explicitement, dans une situation.
Ces influences incarnent même la nature fondamentale de la communication qui est un acte de mobilisation d’autrui. « Dans l’acte de communication, il y a une tentative d’influence de l’autre. L’influence est une ressource humaine, liée à la nature de certaines personnes qui ont un pouvoir de conviction tel qu’elles le font passer à travers leurs communications. Communiquer c’est donc, en partie, s’efforcer de mobiliser autrui par divers processus d’influence »163.
Il est important de savoir que « l’enjeu de l’acteur oriente sa perception de la situation et des faits s’y déroulant. Il oriente aussi toutes ses activités en situation. Dans chaque cadre situationnel, on peut essayer d’expliciter les enjeux primordiaux de l’acteur en question. Les enjeux des acteurs sont donc des lunettes, pour eux, comme des lunettes déformantes. Pour être entendu et compris par un autre acteur, il faut donc chausser ses lunettes pour voir son monde et être capable de lui parler le langage de son monde »164.
Dans son article intitulé « L’enjeu culturel : exemple des relations franco-chinoises », Emmanuel Lincot165 estime que lorsque deux cultures s’affrontent, il y a des enjeux culturels qui sont mis en jeu. A titre exemplatif, on peut citer : l’élaboration d’une stratégie culturelle (éducation, information et la diffusion de sa culture), la valorisation de sa culture comme moyen d’affirmer sa puissance, la dualité entre les cultures opposées, l’état de défiance et d’incompréhension, l’intégration en soi des valeurs culturelles des autres, la révolution mentale des intellectuels par rapport aux normes imposées, le patriotisme et la connaissance de sa langue.
Les enjeux d’un acteur en situation concernent les différents niveaux de son implication dans le monde. Ils participent d’ailleurs au découpage, pour lui, de différents cadres situationnels. Et, l’ensemble des enjeux des acteurs sociaux d’une situation constitue le contexte des enjeux. Ce dernier est une des dimensions de référence de toute situation de communication entre des acteurs. Il prend en compte le système interactif des enjeux dans la situation.
Positionnement
Fondamentalement, la communication est un acte de positionnement personnel. Si on s’en tient au modèle où un sujet émet et l’autre reçoit, on peut être à un moment donné émetteur et à un autre récepteur ; on donne ainsi une idée d’égalité des deux intervenants sans tenir compte des relations de pouvoir. Car, « chaque acteur, dans une situation de communication, interprète un rôle qu’il cherche à faire reconnaître. Communiquer c’est donc, en partie, se positionner par rapport à autrui, en proposant des éléments de son identité »166.
Pour Alex Mucchielli et Claire Noy167, le positionnement est un des concepts les plus importants, car toute « communication généralisée » peut être considérée comme contribuant à positionner les acteurs échangeant les uns envers les autres. Le simple fait d’ouvrir la bouche pour dire quelque chose, c’est se positionner comme ayant quelque chose à dire dans les circonstances présentes.
De ce fait, les acteurs sociaux, impliqués dans une situation, ne peuvent pas ne pas avoir, entre eux, des positions réciproques dans une situation. L’ensemble de ces positions respectives forme le « contexte des positionnements ». Un positionnement peut découler des statuts, des rôles historiques ou actuels. Il peut aussi découler des places qui sont attribuées ou que s’attribuent les acteurs au cours de leurs échanges.168
Enfin, toute communication est donc porteuse d’une situation des « positions ou places » des interlocuteurs, dont chacune détermine les comportements de ces derniers.
Relations avec les autres
La perception de l’espace est dynamique parce qu’elle est liée à l’action, à ce qui peut être accompli dans un espace donné, plutôt qu’à ce qui peut être vu dans une contemplation passive. Ces différentes distances ne sont pas toujours faciles à comprendre parce que la plupart des mécanismes liés à la saisie des distances se produisent inconsciemment. C’est ainsi que, par exemple, la perception de la chaleur corporelle d’autrui permettra de marquer la frontière entre espaces intimes et non intimes.
Chez l’homme, les distances selon la « proxémie » de Edward Twitchel Hall169 peuvent se classer comme suit : l’intime, le personnel, le social et le public. Les « mesures » exactes de chaque type et la place des limites correspondantes varient selon la culture. A ces zones sont associées des activités, des relations et des émotions.
La distance intime (15 à 45 cm) : la présence de l’autre s’impose, c’est une relation d’engagement avec un autre corps. On peut alors avoir deux modes (proche et éloigné). Le mode proche, c’est la distance de l’acte sexuel et de la lutte. Le contact physique domine la conscience des partenaires. Tandis que dans le mode éloigné, les mains peuvent se joindre, la distorsion du système visuel, la voix est étouffée.
La distance personnelle (45 cm à 1,20 m), c’est la distance fixe qui sépare les membres, une bulle qui les sépare les uns des autres. Dans le mode proche, la distance est de 45 à 75 cm. Tandis que dans le mode éloigné (75 cm à 1,20 m), on remarque la distance à la « longueur des bras », à la limite de l’emprise physique sur autrui. Il est possible, à cette distance, de discuter de sujets personnels.
La distance sociale (1,20 à 3,60 m), on passe la frontière de la limite du pouvoir sur autrui, la hauteur de la voix est normale. Dans le mode proche (1,20 à 2,10 m), sont visibles, la tête et la haut du corps (1,20 m) et l’ensemble du corps (2,10 m), c’est la distance des négociations interpersonnelles, elle est adoptée par les personnes qui travaillent ensemble. Dans le mode éloigné (2,10 à 3,60), les rapports prennent un caractère plus formel, il faut maintenir le contact visuel si l’entretien est prolongé. A cette distance, on peut travailler sans impolitesse en présence d’autrui, c’est le cas de réceptionniste avec le visiteur.
La distance publique (3,60 à 9 m) est située hors du cercle où l’individu est directement concerné. Dans le mode proche (3,60 à 7,50), il est possible d’adopter une conduite de fuite ou de défense si l’on se sent menacé. Le langage revêt un style formel. Tandis que dans le mode éloigné (7,50 à 9 m), c’est la distance qu’imposent les personnages officiels importants. Ce sont surtout les gestes et postures qui assurent l’essentiel de la conversation non verbale. Le rythme de l’élocution est ralenti.
A la suite de Edward Twitchel Hall, Jean-claude Abric170 en a présenté quatre zones : la zone intime, la zone personnelle, la zone sociale et la zone publique. La zone intime correspond approximativement à la distance de l’avant-bras (50 cm) : sorte de bulle qui entoure l’individu et le protège ; sauf dans le cas de situations spécifiques (relation amoureuse, confidence).
La zone personnelle (distance du bras tendu de 70 à 1,20 m), c’est la zone de l’échange personnalisé, de la rencontre entre deux personnes proches. La zone sociale (de 1,20 à 2,40 m), permet un échange direct et personnalisé, mais à une distance qui préserve l’intimité. C’est la zone de l’échange peu impliqué, de la rencontre entre deux personnes ne se reconnaissant pas.
La zone publique (au de-là de 2,40 m) est celle où toute communication est perceptible et partagée par les personnes présentes. La relation est moins directe et naturelle. Rarement utilisée à deux, elle est la zone de l’échange en groupe ou face à un public.
Il y a donc lieu de noter que la « proxémie » souligne un point important du processus de communication. Ainsi donc à chaque espace correspond un type de communication adapté et à chaque type de message correspond une distance optimale. La réussite d’une communication dépend du choix d’un espace approprié à l’objectif et à la nature de la communication.
Pour conclure ce paragraphe, quatre facteurs peuvent définir la « contextualité situationnelle », à savoir : la norme, l’enjeu, le positionnement et les relations avec les autres. Ces facteurs seront tous examinés dans le cadre de cette étude.
________________________
159 MUCCHIELLI, A. et NOY, C., op.cit, p. 137. ↑
160 MULUMBA, N., Manuel de sociologie générale, Kinshasa, Africa, 1977, p. 116. ↑
161 LEYENS, J.-P., Psychologie sociale, Bruxelles, Pierre Mardaga, 1976, pp. 53-54. ↑
162 BOSSONG, G., « Normes et conflits normatifs », in NELDE, P. et al. (dir.), Kontaktlinguistik. Ein Handbuch der internationalen Forschung, Berlin, Gruyter, 1996, p. 609. ↑
163 ABC du Conseiller, « Les enjeux de la communication », pp. 1-3, consulté le 26 mars 2013, URL : http://www.abcduconseiller.qc.ca ↑
164 ABC du Conseiller, op.cit, pp. 1-3. ↑
165 LINCOT, E., « L’enjeu culturel : l’exemple des relations franco-chinoises », in Enjeux stratégiques, pp. 76-82. ↑
167 MUCCHIELLI, A. et NOY, C., op.cit, pp. 91-92. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quels sont les éléments de la contextualité situationnelle dans la communication interculturelle?
Les éléments de la contextualité situationnelle incluent la contextualité normative, des enjeux, de positionnement, relationnelle, temporelle, spatiale, et physique et sensorielle.
Comment les normes influencent-elles la communication interculturelle au Congo?
Les normes sont des obligations sociales acceptées qui orientent l’action sociale des individus et donnent sens aux échanges en fonction des attentes du groupe.
Quel est l’enjeu culturel dans la communication interculturelle?
L’enjeu culturel est constitué par l’ensemble des influences présentes dans une situation de communication, qui orientent la perception et les activités des acteurs.