Les stratégies d’implémentation de l’UA révèlent des différences surprenantes avec l’UE, notamment en matière d’adhésion universelle. Cette étude critique souligne l’importance de réformer les institutions de l’UA pour une intégration régionale efficace, avec des implications majeures pour l’avenir de l’Afrique.
Section 2 : Elargissement des normes communautaires
Parce que nous considérons que l’Union africaine jouit d’une personnalité juridique autonome et distincte de ses États membres, nous admettons que ses décisions soient émises uniquement par elle et non à partir de la convergence des volontés de ses membres.
Mais pour que notre propos soit compatible avec la réalité des choses et avec le droit, il faut que les normes de l’Union soient renforcées avec une large typologie des actes et une nette volonté d’impacter l’ordre juridique des Etats membres, à l’instar de la situation dans l’Union européenne qui évolue au moyen d’une gamme variée de normes avec des effets correspondants à la nature et au degré de l’acte.
Paragraphe 1 : Nature et typologie des actes
L’expérience de l’Union européenne, suivie par l’Union africaine, nous enseigne qu’il faut distinguer les sources du droit primaire de l’organisation d’intrégration de celles de son droit dérivé.
A- Droit primaire
Dans le cadre de l’intégration européenne, la première source du droit est constituée des traités instituant l’UE, y compris les annexes et les protocoles qui leur sont joints ainsi que leurs compléments et modifications ultérieurs.
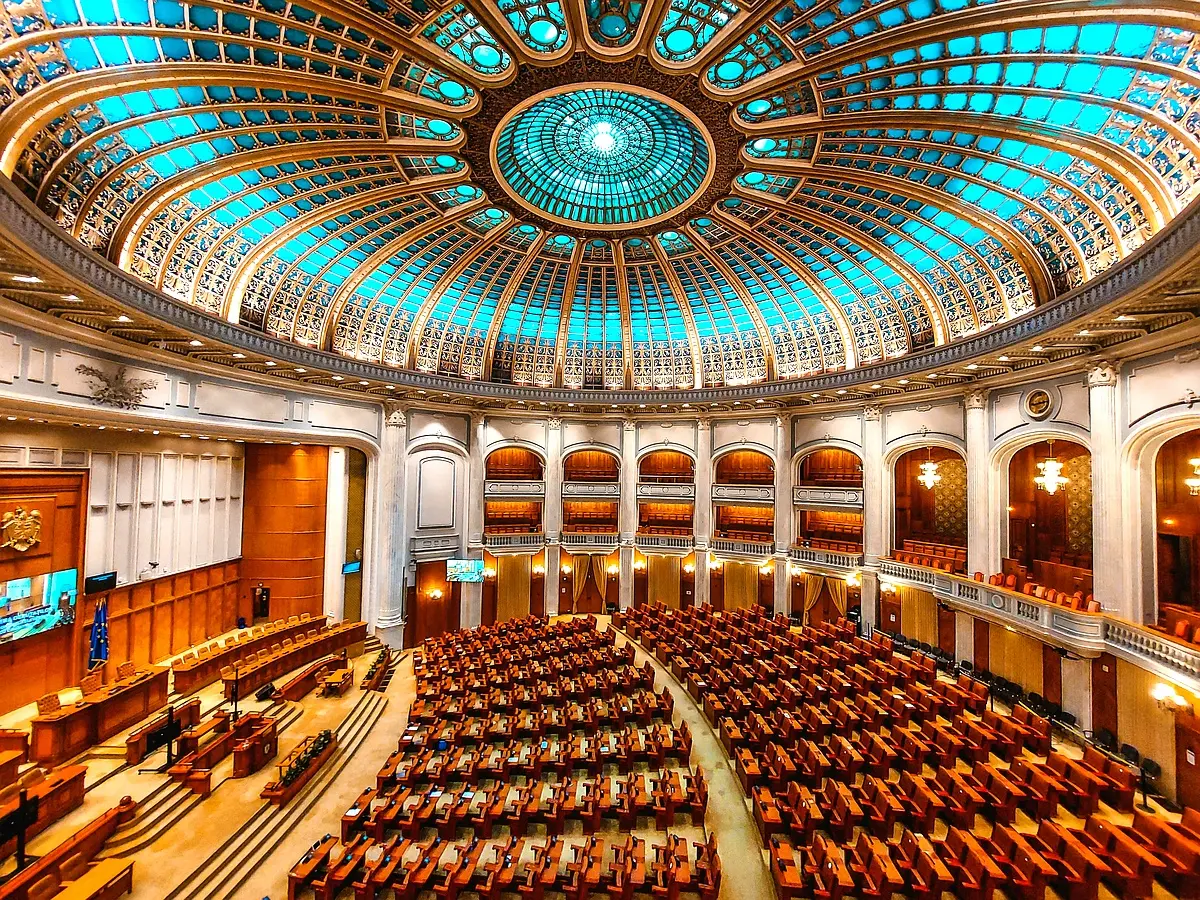
Ces traités fondateurs, ainsi que leurs compléments et modifications, qui sont surtout les traités de Maastricht, d’Amsterdam, de Nice et de Lisbonne et les différents traités d’adhésion, contiennent à la fois des règles juridiques de base relatives aux objectifs, à l’organisation et au fonctionnement de l’UE et certains éléments du droit économique et financier.
Cela vaut également pour la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui a la même valeur juridique que les traités depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne (article 6, paragraphe 1, du traité UE).
Ils forment ainsi le cadre constitutionnel de l’UE, que les institutions de l’Union doivent ensuite remplir dans l’intérêt de l’Union grâce aux pouvoirs législatifs et administratifs dont elles ont été dotées à cette fin.
En tant que droit directement créé par les États membres, ces règles sont qualifiées, dans le langage juridique, de droit primaire de l’Union.
A cette catégorie, nous pouvons ajouter les accords internationaux conclus par l’Union (Accords d’association, Accords de coopération, Accords commerciaux45) constituent la troisième source du droit est liée au rôle de l’UE à l’échelle internationale.
B- Droit dérivé
Le droit créé dans l’exercice des compétences conférées aux institutions de l’Union est appelé droit dérivé de l’Union, qui est la deuxième source principale du droit de l’UE.
Il comprend :
- les actes juridiques à caractère législatif («actes législatifs»),
- les actes juridiques n’ayant pas un caractère législatif (actes simples, actes délégués, actes d’exécution),
- les actes juridiques non contraignants (avis, recommandations), ainsi que
- d’’autres actes, qui ne sont pas des actes juridiques (par exemple les accords interinstitutionnels, les résolutions, les communications et les programmes d’action).
Les «actes législatifs» sont des actes juridiques adoptés dans le cadre de la procédure législative ordinaire ou de la procédure législative spéciale (article 289 du traité FUE).
Les « actes délégués » (article 290 du traité FUE) sont des actes juridiques qui n’ont pas un caractère législatif, mais qui ont une portée générale et obligatoire et par lesquels certains éléments non essentiels d’un acte législatif peuvent être modifiés ou complétés.
Ils sont adoptés par la Commission, qui doit être explicitement habilitée à cet effet par un acte législatif.
Lorsqu’il faut fixer des conditions uniformes d’exécution des actes juridiquement contraignants de l’UE, cela est fait au moyen d’actes d’exécution, qui sont adoptés en principe par la Commission, exceptionnellement aussi par le Conseil (article 291 du traité FUE).
Les institutions de l’Union peuvent émettre des recommandations et des avis, qui sont des actes juridiques non contraignants.
Il existe enfin toute une série d’ « actes qui ne sont pas des actes juridiques», qui permettent aux institutions de l’Union de publier des avis et des déclarations non contraignants ou qui règlent la vie interne de l’UE ou de ses institutions, comme c’est le cas des règles adoptées d’un commun accord, des accords interinstitutionnels ou des règlements intérieurs des institutions.
Les actes juridiques ayant ou non un caractère législatif peuvent prendre des formes diverses.
Les principaux types d’actes sont recensés et définis dans un catalogue (article 288 du traité FUE).
Dans ce catalogue figurent les règlements, les directives et les décisions, qui sont des actes contraignants.
On y trouve également les recommandations et les avis, qui sont pour leur part des actes non contraignants.
Ce catalogue n’est toutefois pas exhaustif. Il existe en effet toute une série d’autres types d’acte qui ne rentrent pas dans ce catalogue.
Il s’agit par exemple des résolutions, des déclarations, des programmes d’action et des livres blancs ou verts.
Tous les types d’acte diffèrent sensiblement par leur procédure d’adoption, leurs effets juridiques et leurs cercles de destinataires ; ces différences sont abordées dans un chapitre ultérieur, intitulé «Les instruments dont dispose l’UE».
La création du droit dérivé de l’Union est un processus progressif et continu.
L’adoption du droit dérivé donne vie au droit primaire, qui est constitué des traités de l’Union, et concrétise et complète au fur et à mesure l’ordre juridique européen.
________________________
45 Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994), les accords sur les mesures antidumping et sur les subventions et mesures compensatoires, l’accord général sur le commerce des services (GATS), l’accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et le mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends. À côté de cela, les accords de libre-échange bilatéraux gagnent de plus en plus de terrain au détriment des accords multilatéraux. En raison des difficultés considérables pour conclure des accords de libre-échange multilatéraux, dans le cadre de l’OMC par exemple, les grandes nations commerciales, y compris l’UE, ont recours aux accords de libre- échange bilatéraux. Parmi les exemples les plus récents figurent la réussite finale des négociations avec le Canada (accord économique et commercial global -CETA) et avec Singapour, ainsi que les négociations en cours avec les États-Unis (partenariat transatlantique de commerce et d’investissement — TTIP) et avec le Japon. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quelle est la différence entre le droit primaire et le droit dérivé dans le cadre de l’Union européenne ?
Le droit primaire est constitué des traités instituant l’UE et de leurs modifications, tandis que le droit dérivé est créé dans l’exercice des compétences conférées aux institutions de l’Union.
Quels types d’actes juridiques sont inclus dans le droit dérivé de l’Union européenne ?
Le droit dérivé comprend les actes législatifs, les actes non législatifs, les actes non contraignants, ainsi que d’autres actes qui ne sont pas des actes juridiques.
Comment l’Union africaine peut-elle renforcer ses normes communautaires ?
Pour renforcer ses normes, l’Union africaine doit adopter une large typologie des actes et avoir une volonté d’impacter l’ordre juridique des États membres.