Les perspectives d’intégration régionale révèlent des différences surprenantes entre l’Union africaine et l’Union européenne. Alors que l’UA prône une adhésion universelle, l’UE impose des critères stricts, soulevant des questions cruciales sur l’avenir de l’intégration en Afrique.
B- UE, organisation supranationale à géométrie variable
L’Union européenne est difficile à classifier parmi les catégories d’organisations connues, puisqu’elle constitue une organisation sui generis. En effet, elle possède des caractéristiques propres qui instituent une relation particulière avec ses États membres:
un Parlement élu au suffrage universel direct, un droit propre et contraignant, une monnaie commune, une citoyenneté propre, etc.
Deux opinions sont émises sur la nature juridique de l’Union européenne. La première souligne qu’elle est simplement une forme d’organisation internationale car sa création s’est faite conformément à la règlementation internationale ; tandis que la seconde accorde à l’Union une valeur extraordinaire, fondée sur les arrêts de la Cour européenne de justice, cette dernière ayant approuvé plusieurs principes de la Communauté/Union, tels que la suprématie des droits de l’Union sur ceux des Etats membres et l’impact direct.
Ces deux arrêts fondamentaux ont été rendus en 1963 et 1964 par la Cour de justice de la Communauté économique européenne.
(OUEDRAOGO Idrissa, Le Panafricanisme est-il réellement une idéologie d’initiative africaine ?,
https://www.academia.edu/33258505/Le_Panafricanisme_est_il_r%C3%A9ellement_une_id%C3%A9ologie_di nitiative_africaine page consultée le 05 octobre 2020.
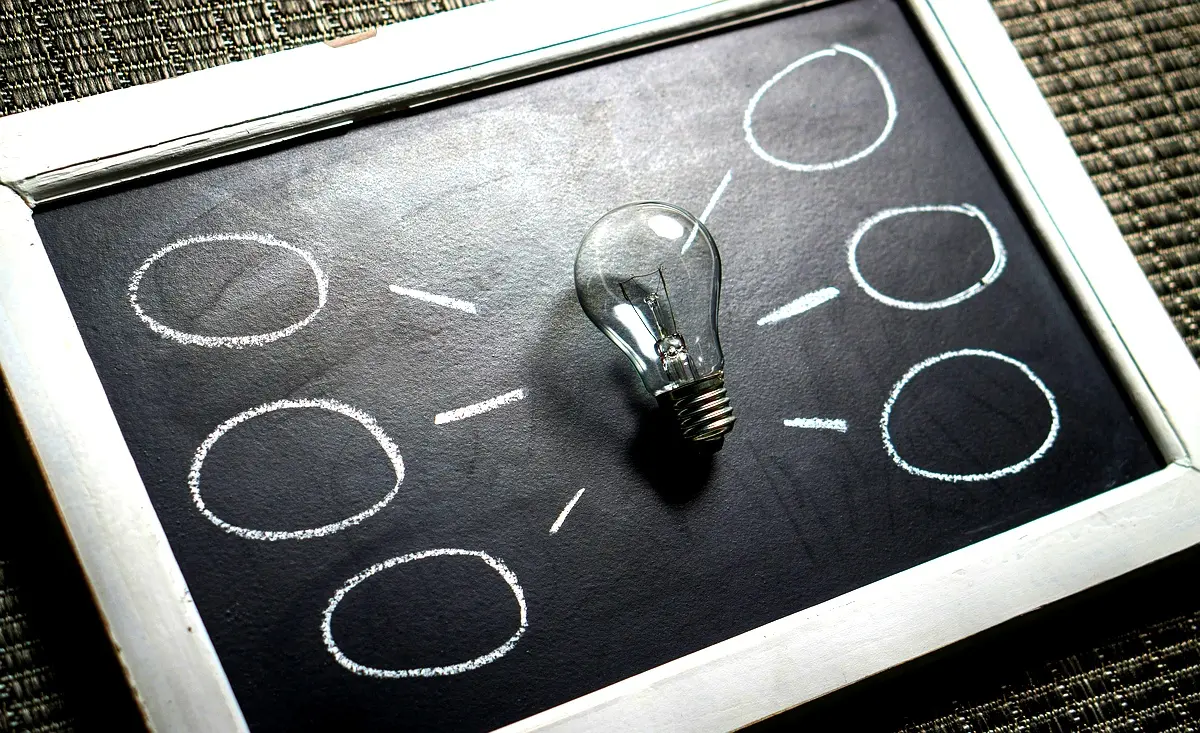
29 Roland Pourtier, « Le panafricanisme. Vers une identité culturelle africaine », hors série Le Monde–La Vie,
no 19, « L’atlas des utopies », 2017, pp. 132-133, https://fr.wikipedia.org/wiki/Panafricanisme#cite_note-LM-5 page consultée le 10 octobre 2020.
L’affaire Van Gend & Loos
Dans cette affaire, l’entreprise de transport néerlandaise Van Gend & Loos avait introduit devant un tribunal des Pays-Bas une action contre l’administration des douanes néerlandaises, au motif que celle-ci avait perçu un droit de douane majoré à l’importation d’un produit chimique en provenance de la République fédérale d’Allemagne. L’entreprise estimait qu’il y avait là une violation de l’article 12 du traité CEE, qui interdit aux États membres d’introduire de nouveaux droits de douane ou d’augmenter des droits de douane existants dans le marché commun.
La juridiction néerlandaise a suspendu la procédure et a saisi la Cour de justice en lui demandant de clarifier la portée et l’interprétation juridique de l’article invoqué du traité fondateur de la CEE.
Cette affaire a donné à la Cour de justice l’occasion d’établir certains aspects fondamentaux de la nature juridique de la Communauté économique européenne. Dans son arrêt, la Cour a déclaré ce qui suit :
« […] attendu que l’objectif du traité CEE qui est d’instituer un marché commun dont le fonctionnement concerne directement les justiciables de la Communauté, implique que ce traité constitue plus qu’un accord qui ne créerait que des obligations mutuelles entre les États contractants; que cette conception se trouve confirmée par le préambule du traité qui, au-delà des gouvernements, vise les peuples, et de façon plus concrète par la création d’organes qui institutionnalisent des droits souverains dont l’exercice affecte aussi bien les États membres que leurs citoyens; […] qu’il faut conclure de cet état de choses que la Communauté constitue un nouvel ordre juridique de droit international, au profit duquel les États ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains, et dont les sujets sont non seulement les États membres mais également leurs ressortissants […]».
L’affaire Costa/ENEL
À peine un an plus tard, l’affaire Costa/ENEL devait permettre à la Cour de justice d’approfondir encore davantage son analyse. Cette affaire reposait sur les faits suivants : en 1962, l’Italie avait nationalisé la production et la distribution de l’électricité et avait transféré le patrimoine des entreprises électriques à la société ENEL. En tant qu’actionnaire de la société touchée par la nationalisation, Edison Volta, M. Costa s’était vu privé de dividendes lui revenant et avait donc refusé de payer une facture d’électricité de 1 926 lires italiennes.
Devant la justice italienne, M. Costa avait justifié sa conduite en faisant valoir, entre autres, que la loi de nationalisation violait toute une série de dispositions du traité de la CEE. Le tribunal italien avait alors soumis plusieurs questions à la Cour de justice sur l’interprétation de diverses dispositions du traité de la CEE.
Dans son arrêt, la Cour de justice a déclaré au sujet de la nature juridique de la CEE :
« …. le traité de la CEE a institué un ordre juridique propre intégré au système juridique des États membres […] et qui s’impose à leur juridiction. En instituant une Communauté de durée illimitée, dotée d’institutions propres, de la personnalité, de la capacité juridique, d’une capacité de représentation internationale et plus particulièrement de pouvoirs réels issus d’une limitation de compétence ou d’un transfert d’attributions des États à la Communauté, ceux-ci ont limité leurs droits souverains et créé ainsi un corps de droit applicable à leurs ressortissants et à eux-mêmes. »
Sur la base de ces observations détaillées, la Cour de justice a conclu comme suit :
« ……… le droit du traité ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu’il soit, …; que le transfert opéré par les États, de leur ordre juridique interne au profit de l’ordre juridique communautaire, des droits et obligations correspondant aux dispositions du traité, entraîne donc une limitation définitive de leurs droits souverains contre laquelle ne saurait prévaloir un acte unilatéral ultérieur incompatible avec la notion de Communauté […]».
L’UE constitue donc une entité autonome dotée de droits souverains et d’un ordre juridique indépendant des États membres, qui s’impose tant aux États membres qu’à leurs ressortissants dans les domaines relevant de la compétence de l’UE.
Les actes fondateurs de l’UE ont en effet abouti à la création d’une Union autonome dotée de droits souverains et de compétences propres. Les États membres ont renoncé à une partie de leur souveraineté au profit de cette Union et l’ont déléguée à l’UE en vue d’une appropriation commune.
C’est pourquoi l’UE n’est ni une organisation internationale classique ni une association d’États, mais une entité qui se situe à la croisée de ces formes traditionnelles d’association entre États. En termes juridiques, on parle d’une « organisation supranationale ».30
Les États membres et les peuples de l’Union européenne étant « unis dans la diversité » socioculturelle et économique, il est naturel que la construction européenne recoure à des formes d’intégration différenciée afin d’agir de manière efficace tout en tenant compte de cette diversité.
Yves Bertoncini, directeur de l’Institut Jacques DELORS parle de « l’intégration différenciée dans l’UE : une légitimité à géométrie variable »31 en ce sens que tous les Etats européens ne sont volontaires ou jugés aptes à toutes les étapes du processus d’intégration régionale, n’ayant pas les mêmes niveaux d’avancement.
Schématiquement, nous pouvons remarquer que sur le continent européen :
- 47 pays européens sont membres du Conseil de l’Europe :
(Crée en mai 1948, à l’issue du congrès de l’Europe tenu à La Haye, sous la présidence de Churchill, le Conseil de l’Europe est une structure de coopération politique mais doté d’un pouvoir strictement consultatif. Le Conseil de l’Europe joue en fait le rôle de tribune, de laboratoire d’idées. Son œuvre majeure est la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (adoptée en 1950 et entrée en vigueur en 1953). Aujourd’hui 47 Etats en sont membres, soit la quasi-totalité des Etats européens32)
- 27 pays sont dans l’Union Européenne ;
- 16 pays appartiennent à la zone euro ; et
- 25 pays sont membres de l’espace Schengen, avec la suppression totale des frontières entre l’Allemagne, la France et le Benelux.
Elle entrait en vigueur le 1er mars 1995 et est élargie à d’autres pays. Certains pays de l’UE ne font pas partie de l’espace Schengen (Grande-Bretagne, Irlande, Roumanie, Bulgarie, Chypre). Par contre, des Etats non membres de l’UE y sont intégrés : Suisse, Norvège, Islande.
30 Klaus-Dieter BORCHARDT, L’ABC du droit de l’Union européenne, pp 45 et suivants.
31 Policy Paper publié le 13 mars 2017, et disponible sur le site https://institutdelors.eu/publications/lintegration-differenciee-dans-lue-une-legitimite-a-geometrie-variable/ page consultée le 10 octobre 2020.
32 en dehors de la Biélorussie, du Kosovo et du Vatican.
________________________
29 Roland Pourtier, « Le panafricanisme. Vers une identité culturelle africaine », hors série Le Monde–La Vie, no 19, « L’atlas des utopies », 2017, pp. 132-133, https://fr.wikipedia.org/wiki/Panafricanisme#cite_note-LM-5 page consultée le 10 octobre 2020. ↑
30 Klaus-Dieter BORCHARDT, L’ABC du droit de l’Union européenne, pp 45 et suivants. ↑
31 Policy Paper publié le 13 mars 2017, et disponible sur le site https://institutdelors.eu/publications/lintegration-differenciee-dans-lue-une-legitimite-a-geometrie-variable/ page consultée le 10 octobre 2020. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quelles sont les caractéristiques de l’Union européenne?
L’Union européenne possède un Parlement élu au suffrage universel direct, un droit propre et contraignant, une monnaie commune, et une citoyenneté propre.
Comment l’Union africaine diffère-t-elle de l’Union européenne en matière d’adhésion?
L’Union africaine a adopté une adhésion universelle sans conditions, tandis que l’Union européenne a procédé par élargissement progressif avec des critères stricts.
Pourquoi est-il nécessaire de réformer les institutions de l’Union africaine?
Il est nécessaire de réformer les institutions techniques et exécutives de l’Union africaine pour renforcer l’intégration régionale africaine.