Le cadre théorique de l’intégration régionale révèle des différences surprenantes entre l’Union africaine et l’Union européenne. Alors que l’UA prône une adhésion universelle, l’UE impose des critères stricts, soulevant des questions cruciales sur l’avenir de l’intégration en Afrique.
B- Intégration pour la gestion des biens publics
La mondialisation (parfois désignée par l’anglicisme globalisation) est le processus d’intégration des marchés et de rapprochement des hommes, marqué par :
- l’accroissement des échanges humains (migrations internationales) ;
- l’accroissement des échanges de biens et services (commerce mondial) ;
- l’accroissement des investissements directs étrangers (mondialisation de la production industrielle) ;
- l’accroissement des échanges financiers (globalisation financière).
Elle est poussée par la libre circulation des marchandises, des capitaux, des services, des personnes, des technologies de l’information et de la communication. Elle engendre une concurrence et une compétition mondiales des plus âpres, entre tous Etats de la planète sans exception, les économies faibles se faisant phagocyter par les plus fortes.
De là nait la nécessité pour les Etats d’intégrer leurs économies à celle des pays voisins afin de créer des blocs économiques régionaux plus importants et plus compétitifs et de pouvoir prendre part aux échanges internationaux et pas seulement individuellement en tant qu’Etat, mais en tant que puissance régionale.
Francis SAUDUBRAY saluant « les vertus de l’intégration régionale en Afrique » note que : « L’émergence d’un espace commun présente des avantages
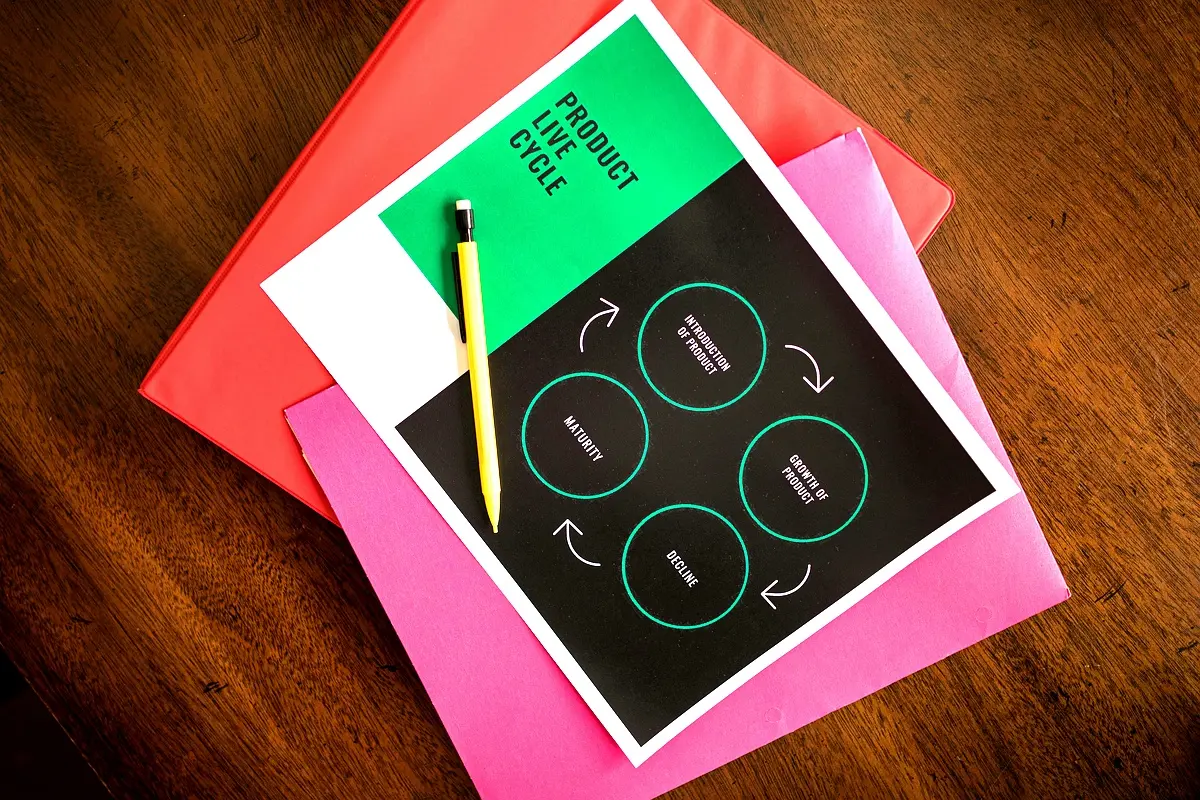
évidents pour les économies africaines[…]Ces avantages ont d’autant plus d’intérêt
dans le contexte de la mondialisation, où les économies nationales les plus solides
sont malmenées par les flux et les décisions internationaux. »6
Face au rouleau compresseur de la mondialisation, l’heure n’est plus ni à l’isolationnisme, ni aux aventures solitaires, ni au repli derrière l’artifice d’une souveraineté politique dont s’embarrassent peu les réalités économiques du monde globalisé (malgré les efforts des Etats-Unis d’Amérique de protéger leur marché intérieur et leurs entreprises, les produits ‘‘made in China’’ foisonnent toujours sur ce marché).
6 Francis SAUDUBRAY, « Les vertus de l’intégration régionale en Afrique », Afrique contemporaine, n° 2008/3 n° 227, De Boeck Supérieur, p.179-180.
Comme l’explique à juste titre Kémoko Diakité, « Avec nos micros États, les États africains ont réalisé que sur le continent, il y a des pays longtemps exploités disposant de ressources naturelles énormes, longtemps divisés et qui, pour accéder à
un niveau de vie convenable, doivent conjuguer leurs efforts dans le cadre de
l’intégration. L’Union européenne, l’ASEAN, le MERCOSUR et l’ALENA montrent
que même les grands États ont besoin de s’unir pour assurer à leurs peuples une
prospérité durable. La mondialisation ne laisse aujourd’hui à aucun État la latitude de se complaire dans l’isolationnisme ».7
D’où l’urgence pour les économies fragiles d’Afrique, émiettées en 55 marchés de taille relativement modeste, d’aller très vite à l’intégration au travers de grands ensembles. C’est ce qu’explique Abdou Diouf lorsqu’il affirmait que : « Bon gré mal gré, l’Afrique doit aujourd’hui vivre, comme l’ensemble de notre planète, à l’heure de ce que l’on appelle la mondialisation. Mais, contrairement à d’autres régions du Sud, elle demeure mal outillée pour, à la fois, affronter ses contraintes et profiter de ses opportunités. Une des raisons de cette fragilité réside dans son extrême fragmentation,
dans sa « balkanisation 8» […. ]L’Afrique se compose d’une cinquantaine d’États,
dont une vingtaine comptent moins de 10 millions d’habitants, et près d’une dizaine moins d’un million. Que pèse chacun d’eux face aux grands ensembles qui occupent aujourd’hui la scène mondiale ?»9
D’ailleurs, Paul Collier et Anthony J. Venables, tous deux professeurs à l’Université d’Oxford, estiment que la fragmentation de l’Afrique en une cinquantaine de petits Etats constitue un facteur explicatif du retard de l’Afrique dans la mondialisation en même temps qu’elle empêche l’Afrique de tirer avantage du commerce mondial.10 Ils expliquent que la balkanisation de l’Afrique, ce qui a été
7 Kémoko DIAKITE, Droit de l’intégration Africaine : Organisations communautaires en Afrique de l’Ouest, Rapports entre les organisations sous-régionales, l’Union africaine et l’Organisation des Nations Unies, Défis prioritaires de l’intégration en Afrique, L’Harmattan, 2017, Paris, 2017, p.17.
8 Ce terme désigne un processus de morcellement opéré par les puissances coloniales d’unités politiques et géographiques en une multitude d’États à la viabilité précaire afin de profiter des divisions ainsi créées pour en diminuer la puissance.
9 Abdou DIOUF, « Afrique, l’intégration régionale face à la mondialisation », Politique étrangère, n°2006/4, Institut français des relations internationales, p.785-797.
10 Paul COLLIER et Anthony J. VENABLES, « Trade and Economic Performance: Does Africa’s Fragmentation Matter ? », Revue d’économie du développement, 2009/4 Vol. 17, De Boeck Supérieur, p.5-39, https://www.cairn.info/revue-d-economie-du-developpement-2009-4-page-5.htm page consultée le 05 octobre 2020.
traduit par fragmentation, constitue l’un des principaux freins au développement du continent en ce sens qu’elle génère trois niveaux de coûts : « Le premier est que la
fragmentation implique que les avantages naturels risquent d’être distribués inéquitablement entre les pays. Le second concerne la perte des économies d’échelle,
au niveau de l’entreprise, de la ville, et du pays dans son ensemble. Le troisième
concerne la perte de biens publics car l’échelle de la coopération politique est réduite. » 11
Ainsi que l’exprimait l’ancien Secrétaire général des nations unies, Koffi Annan, « une paix plus solide, une prospérité mieux partagée, un environnement épargné : rien de ceci n’est hors de portée si l’on en a la volonté politique. Mais ni les marchés, ni les gouvernements ne peuvent, livrés à eux-mêmes, réaliser ces biens
publics mondiaux. C’est pourquoi nos efforts doivent se tourner vers le terme manquant de l’équation : les biens publics à l’échelle mondiale. » 12 Cette prise de position illustre la montée en puissance d’un nouveau concept destiné à penser la régulation de l’économie mondiale, celui des biens publics globaux.
Les biens publics sont des biens ou des services qui présentent deux caractéristiques : la non-rivalité – la consommation d’un bien par un individu n’empêche pas sa consommation par un autre – et la non-exclusion- personne n’est exclu de la consommation de ce bien qui est à la disposition de tous. Les exemples les plus connus sont ceux d’un éclairage public ou d’un feu d’artifice : je peux en profiter sans léser la consommation des autres et tout le monde peut en jouir. En réalité, peu de biens publics sont réellement purs, car beaucoup n’ont pas ces deux caractéristiques.
L’économiste James Buchanan parle ainsi de biens publics réservés, de fait, à une communauté et constituant des « biens de club ».
On peut distinguer les biens publics matériels (dépollution de l’eau ou de l’air), immatériels (la production et la diffusion des connaissances, la recherche, la sécurité, la justice, les droits de l’homme) et naturels (le climat, les milieux). Ces biens sont qualifiés de publics, d’une part, parce que leur production résulte de choix collectifs, d’autre part, du fait de leurs effets de diffusion, leurs « externalités » (les effets
11 Paul COLLIER et Anthony J. VENABLES, op cit p.5.
12 Jean-Jacques Gabas, Philippe Hugon, « Les biens publics mondiaux et la coopération internationale », L’Économie politique, 2001/4, (n°12), p.19 à 31.
involontaires positifs ou négatifs générés par une activité), sur l’ensemble des acteurs de la société.
A l’échelle régionale, la gestion au mieux de ces biens publics tels que la paix et la sécurité (la lutte contre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme international), la finance internationale, la connaissance, le commerce international, le cyberespace, l’environnement, etc, dépasse largement le cadre de l’Etat-nation13 agissant isolément et implique une coopération plus étroite entre les diverses nations à commencer par celles de la proximité géographique.
La nécessité d’une action coordonnée des Etats se trouve ainsi justifiée, qu’elle soit par voie de coopération (bilatérale ou multilatérale) ou par voie d’intégration, surtout lorsque certains évènements viennent bouleverser le cours normal des choses.
________________________
6 Francis SAUDUBRAY, « Les vertus de l’intégration régionale en Afrique », Afrique contemporaine, n° 2008/3 n° 227, De Boeck Supérieur, p.179-180. ↑
7 Kémoko DIAKITE, Droit de l’intégration Africaine : Organisations communautaires en Afrique de l’Ouest, Rapports entre les organisations sous-régionales, l’Union africaine et l’Organisation des Nations Unies, Défis prioritaires de l’intégration en Afrique, L’Harmattan, 2017, Paris, 2017, p.17. ↑
8 Ce terme désigne un processus de morcellement opéré par les puissances coloniales d’unités politiques et géographiques en une multitude d’États à la viabilité précaire afin de profiter des divisions ainsi créées pour en diminuer la puissance. ↑
9 Abdou DIOUF, « Afrique, l’intégration régionale face à la mondialisation », Politique étrangère, n°2006/4, Institut français des relations internationales, p.785-797. ↑
10 Paul COLLIER et Anthony J. VENABLES, « Trade and Economic Performance: Does Africa’s Fragmentation Matter ? », Revue d’économie du développement, 2009/4 Vol. 17, De Boeck Supérieur, p.5-39, https://www.cairn.info/revue-d-economie-du-developpement-2009-4-page-5.htm page consultée le 05 octobre 2020. ↑
11 Paul COLLIER et Anthony J. VENABLES, op cit p.5. ↑
12 Jean-Jacques Gabas, Philippe Hugon, « Les biens publics mondiaux et la coopération internationale », L’Économie politique, 2001/4, (n°12), p.19 à 31. ↑
13 A l’échelle régionale, la gestion au mieux de ces biens publics tels que la paix et la sécurité (la lutte contre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme international), la finance internationale, la connaissance, le commerce international, le cyberespace, l’environnement, etc, dépasse largement le cadre de l’Etat-nation agissant isolément et implique une coopération plus étroite entre les diverses nations à commencer par celles de la proximité géographique. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quels sont les avantages de l’intégration régionale en Afrique selon Francis Saudubray?
Francis SAUDUBRAY note que l’émergence d’un espace commun présente des avantages évidents pour les économies africaines, surtout dans le contexte de la mondialisation.
Pourquoi l’intégration régionale est-elle urgente pour les États africains?
L’urgence pour les économies fragiles d’Afrique d’aller à l’intégration est due à leur émiettement en 55 marchés de taille relativement modeste, ce qui les rend moins compétitifs sur la scène mondiale.
Comment la mondialisation affecte-t-elle les États africains?
La mondialisation engendre une concurrence mondiale et pousse les États à intégrer leurs économies pour créer des blocs économiques régionaux plus importants et compétitifs.