La méthodologie théologique écologique révèle que la crise écologique actuelle découle d’une rupture profonde entre l’homme et la nature. En s’inspirant de Saint François d’Assise, cette recherche propose des approches innovantes pour rétablir cette relation essentielle, avec des implications cruciales pour notre avenir.
Université Catholique du Congo
Faculté de Théologie
Grade de licencié (Master/LMD) en théologie
Project presentation
Théologie de la création : Quelques approches nouvelles à l’heure de la crise écologique
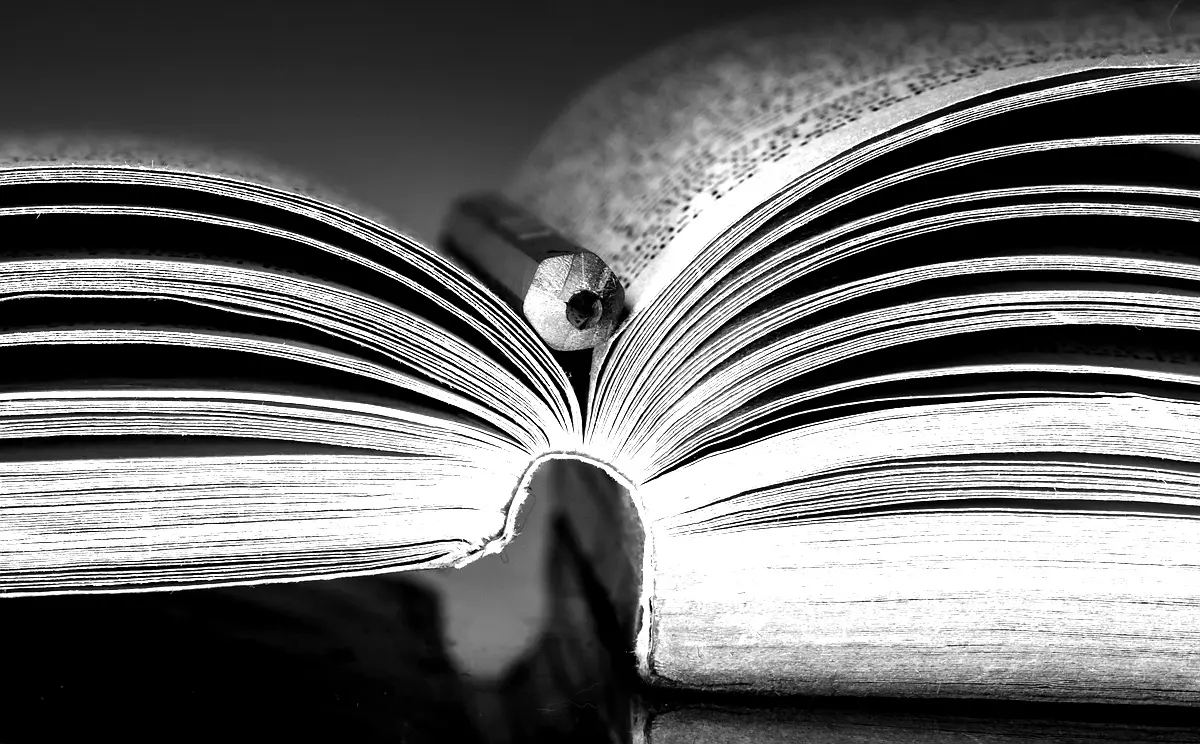
Par: [Student Name]
Supervised by: Prof. E. Kumbu Ki Kumbu
2018-2019
Créé à son image et à sa ressemblance, l’homme trouve en Dieu créateur non seulement l’origine de toutes choses mais aussi leur accomplissement définitif. Le monde est pour l’homme un lieu d’habitation, d’autoréalisation et de quête incessante du bonheur dont le point culminant est Dieu lui-même. Reprenant avec vivacité le cantique de Saint François d’Assise1, Patron de l’écologie, intitulé « Loué soit tu mon Seigneur » le Pape François rappelle que notre maison commune est aussi comme une sœur avec laquelle nous partageons notre existence et comme une mère, belle, qui nous accueille à bras ouvert2.
Et si la terre n’est que sa maison d’habitation, c’est que l’homme n’en est pas le propriétaire mais l’intendant. De même « notre corps est constitué d’éléments de la planète, son air nous donne le souffre et son eau nous vivifie3 ».
Et cela dire que la qualité de vie de l’homme sur terre dépend nécessairement de sa relation avec la nature environnante, et celle-ci dépend de sa relation avec le Créateur.
Malheureusement, nous assistons aujourd’hui à une crise écologique sans précédent. Le nihilisme marque désormais les rapports avec la nature. Presque toutes les cultures du monde se trouvent entrainées par la civilisation scientifique industrielle dans une exploitation démesurée et irresponsable de la nature. Pour le Saint Père, « la violence qu’il y a dans le cœur humain blessé par le péché se manifeste aussi à travers les symptômes de maladie que nous observons dans le sol, dans l’eau, dans l’air et dans les êtres vivants4 ».
Le nœud de problème résiderait donc dans la crise de la foi qui engendre la crise plus profonde de sens et de fondement. Il s’agit à juste titre de la crise de toute la civilisation humaine. Il est donc légitime de se demander si la théologie chrétienne de la création en se renouvelant, peut apporter un souffle nouveau pour remédier à cette situation aux allures irréversibles.
Une autre question souvent posée ces dernières années consiste à se demander si la foi chrétienne a pu contribuer à cette situation de crise alarmante. Lynn White Jr.5 l’affirme avec vigueur. Dans son article intitulé, « Racine historique de notre crise écologique »6, il fait le procès de la doctrine judéo-chrétienne de la création. Il affirme que « le christianisme spécialement dans sa forme occidentale, étant la religion la plus anthropocentrique que le monde ait connue a modelé l’homme qui se croit supérieur à la nature7 ».
L’homme croit détenir un statut particulier et privilégié par rapport au reste de la création en se fondant sur sa compréhension biaisée du récit de la création, en particulier ces deux versets ; « Créons l’homme à notre image, à notre ressemblance, et qu’il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre.[…] Dieu créa l’homme et la femme à son image, les bénit et leur dit : « Soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-la ; dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre » (Gn 1,26.28).
4 Laudato Si n°2.
5 Note biographique : Lynn White Jr. (1907 -1987) est un historien médiéviste américain des sciences et des techniques, et professeur à l’Université de Californie à Los Angeles. Auteur de nombreuses études sur l’histoire des techniques, et surtout de la célèbre thèse sur « Les racines historiques de notre crise écologique », conférence prononcée le 26 décembre 1966 à Washington, devant l’assemblée annuelle de l’American Association for the Advancement of Science, et originellement publiée en anglais dans la prestigieuse revue Science de l’AAAS, L.
WHITE, (Jr.), The Historical Roots of Our Ecologic Crisis, in Science, New Series, Vol. 155, No. 3767 (Mar. 10, 1967), pp. 1203-1207. Dans cette thèse, Lynn White Jr. fut le tout premier à soutenir que le changement de perspective introduit par le judéo-christianisme avait ouvert la porte au « désenchantement du monde », au matérialisme et à un nouveau dualisme matière-esprit aux effets écologiques délétères.
Son argumentation repose alors sur des passages des Écritures incriminants à ses yeux. Cette prise de position de Lynn White a fait référence comme texte de base pour toute une génération d’écologiste. Consulté sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Lynn_White,_jr. Le 01 juin 2019.
6 Cf. J.GRINEVALD, Les racines historiques profondes de notre crise écologique (Lynn WHITE, Jr.), dans D. BOURG et Ph. ROCH, (éd.), Crise écologique, crise des valeurs? Défis pour l’anthropologie et la spiritualité, Paris, Labor et Fides, 2010, p. 13-24.
7 J-C. ESLIN, Racine historique de notre crise, dans D. BOURG, & A. PAPAUX, (Dirs), Dictionnaire de la pensée écologique, Paris, PUF, 2015, p. 850.
Créé à l’image, car il est fait à l’image de Dieu, l’homme prétend partager la transcendance de Dieu vis-à-vis la nature. Contrairement au paganisme antique et aux religions orientales, « non seulement le christianisme établit un dualisme entre l’homme et la nature mais il soutient que Dieu veut que l’homme domine la nature pour se propres fins8 ».
Du coup la nature va subir une désacralisation et une dévaluation, perdant ainsi son premier rang et ses titres de mère (natura mater) et de maîtresse des hommes et de dieux9 ».
Elle est désormais considérée comme une réalité physique et un moyen d’autoréalisation pour l’homme. Etant donné que l’impulsion initiale était religieuse dans tous les domaines, White considère que la technique moderne serait aussi une réalisation volontariste du dogme chrétien de la transcendance de l’homme et de sa légitime domination sur la nature.
Devenu si puissant et dominant, l’homme se permet d’objectiver la nature.
Selon White, « dès lors que les racines de notre malaise sont en grande partie religieuses, le remède lui aussi doit être essentiellement religieux10 ». Le christianisme doit donc se transformer et « abandonner le postulat de nature au service de l’homme, sinon, il faudra envisager l’émergence d’une autre religion ou spiritualité11 ».
À ses yeux, le modèle de St François d’Assise constituerait une vision chrétienne alternative : « François s’est révolté contre le dynamisme technique occidental et s’est efforcé de réhabiliter la nature en lui rendant sa place par rapport à Dieu et aux hommes, et en cherchant à rééquilibrer profondément le rapport de l’immanence et la transcendance12 ».
C’est ainsi que Lynn White a été le premier à proposer que François d’Assise soit le saint patron des écologistes.
Si Lynn White lui-même dans son article fait référence aux travaux du théologien protestant Ernst Benz, nous pouvons aussi évoquer Alain W. Watts qui avait insinué dans les années 1950 que ; « L’effort de l’Occident pour changer la physionomie de la nature par la science et la technologie plonge ses racines dans la cosmologie politique du christianisme. Et l’apologétique chrétienne d’aujourd’hui est entièrement fondée à rappeler que la13.
La thèse de Lynn White est donc loin d’être isolée. « Elle participe d’un mouvement culturel qui ressemble à une renaissance et qu’on pourrait bien appeler la Renaissance écologique ». Avec Printemps silencieux14, son livre le plus célèbre, la courageuse Rachel Carson avait défendu avec une voix particulièrement forte la cause de l’environnement et de l’écologie mais sans vraiment remettre en question la religion chrétienne.
Certaines voix se sont même levées contre la thèse de Lynn White. Il s’agit surtout de Jean Bastiaire qui soutient que l’Église est restée fidèle au véritable esprit chrétien, jusqu’à ce que, à l’aube de l’époque moderne se produise une déchristianisation du cosmos, signe avant-coureur de la déchristianisation de l’homme. On a vu réapparaître le vieux dualisme gnostique qui oppose le corps à l’âme, la chair à l’esprit. On a ravivé sournoisement l’antique manichéisme qui condamne la matière et, par conséquent, la création comme œuvre d’une puissance mauvaise15 ».
Pour lui, la vraie explication se trouverait dans le tournant cartésien du XVIIe siècle. Dans sa démarche analytique, « Descartes cautionne l’idée de l’homme maitre et possesseur de la nature au sens d’un tyran qui peut faire ce qu’il veut d’un monde rationnellement transformé en objet16 ».
Réagissant à la thèse de Lynn White, Jean-Michel Maldamé la trouve purement et simplement indéfendable. A ses yeux, « le texte biblique de Gn 1, 26 & 28) a été réinterprété à la naissance de la science classique dans un sens qui n’était plus le sens premier17 ».
Ainsi, les racines de la crise écologique actuelle ne se trouvent nullement dans la doctrine chrétienne de la création, moins encore dans le message biblique mais plutôt dans la conscience humaine. Il affirme que « c’est le primat accordé au sujet humain et qui est centré sur sa conscience qui caractérise la pensée moderne en Occident18 ».
Cet anthropocentrisme démesuré est certes la trace sécularisée de la pensée chrétienne mais il est surtout corrélatif de l’émergence de l’objectivité dans les sciences. L’homme moderne est allé trop loin en s’instituant maître et possesseur de la nature. Rappelons d’ailleurs que « l’idéologie du progrès en soi n’est pas chrétienne, elle s’est même constituée contre la tradition chrétienne19 ».
Selon Maldamé, le récit de la chute dans la Genèse fourni une bonne explication de l’origine de la crise. « Il est dit que l’homme a été placé par Dieu comme gardien du jardin. Sa faute a consisté à se comporter en propriétaire en mettant la main sur l’arbre situé au centre du jardin, dont la position signifiait que Dieu seul est le créateur20 ».
L’homme, par orgueil, n’a pas respecté sa place et a voulu s’emparé de la place de Dieu. C’est ce que continue de faire l’homme moderne. La crise écologique devient l’actualisation de ce phénomène qui prend un aspect dramatique à l’heure du développement des moyens techniques plus performants.
Fabien Revol, quant à lui, indique que le Pape François, dans l’encyclique Laudato si’ « sur la sauvegarde de la maison commune », a parfaitement intégré la critique de Lynn White Jr., car il propose une relecture des textes fondateurs pour corriger les représentations chrétiennes de la nature déformées par le paradigme technocratique et moderne.
Ce travail suppose une conversion du regard sur la nature, profondément inspirée par l’intuition franciscaine de communion et de fraternité avec l’ensemble du vivant21.
En 2005, Jacques Arnould a répondu également dans une lettre ouverte à Lynn White et à ceux qui s’en réclament22 ».
Aussi En 2006, Jean-Paul Maréchal avait répondu par une analyse approfondie de l’Ancien Testament et du Nouveau Testament23 ».
Quoi qu’il en soit, tout en étant essentiellement un traité historique, la thèse de Lynn White ne peut laisser aucun théologien indifférent surtout en ce temps de crise écologique sans précédent.
Partant de ce que nous venons d’évoquer, il nous semble que l’homme moderne est devenu de plus en plus inconscient par rapport à sa propre survie et celle de la planète tout entière. Dès lors ce qu’on appelle la crise de l’environnement naturel d’abord une crise de l’homme lui-même. C’est dans la perspective de cette crise de fond que prennent sens les questions de nos contemporains : comment se présente cette situation de crise écologique aujourd’hui et que seraient ses causes lointaines et immédiates ?
Que signifie pour les croyants, croire au Dieu créateur, croire que ce monde est sa création et qu’il l’habite par son Esprit Saint ? Face à l’accroissement de l’exploitation industrielle et à la destruction irréversible de la nature quelle portée devrait avoir la voix prophétique et innovatrice du théologien24 ? Est-il possible aujourd’hui de formuler de façon nouvelle et pertinente la théologie de la création de telle sorte que celle-ci ne continue pas à être elle-même facteur de crise écologique mais plutôt catalyseur de paix avec la nature25 ?
Comment alors la réflexion théologique sur la création peut-elle promouvoir la réconciliation entre les êtres et là symbiose cosmo-théandrique véritable ? Dans cette perspective de l’harmonie, quel serait le juste rapport entre « Dieu- l’homme- la nature » ? Etant donné que la notion de la création est très complexe, et qu’elle doit faire appel à une implication interdisciplinaire pour une meilleure intelligibilité, quel serait alors la place de la théologie de la création dans la mosaïque des disciplines et son rapport avec les sciences de la nature ? La Bible étant la source fondamentale de la révélation, comment une meilleure compréhension des Ecritures sur la création peut-elle faire face à des positions extrêmes telles que le créationnisme et le fondamentalisme ? Et enfin où serait la place de l’Afrique et quel serait l’apport de la théologie africaine dans ce débat théologique.
Voilà certains des questions qui guideront notre recherche scientifique. Celle-ci sera nourrie par plusieurs théologiens qui ont travaillé dans ce sens, en particulier Jean Michel Maldamé avec sa conception évolutive de la création, François Euvé qui propose une conception ludique de la création. Notre recherche s’ouvrira aussi au paradigme trinitaire et sabbatique de Jurgen Moltmann qui insiste sur l’immanence de Dieu dans la nature sans pour autant nier sa transcendance. Nous n’oublions pas la conception eschatologique du cosmos proposée par John F. Haught.
Plusieurs théologiens africains tels que Oscar Bimwenyi Kweshi, Englbert Mvengi, Paulin Poucoutta, Willy Libambu, Roger Dikebelayi Maweja, Evariste Kabemba Nzemba, Ka Mana, Jean Marc Ela et j’en passe, entreront enfin dans la danse pour nous apporter un éclairage non négligeable dans une perspective africaine.
Ces théologiens contemporains représentent, à nos yeux, les penseurs qui se sont engagés de façon pertinente dans l’élaboration d’une théologie de la création tenant compte du contexte des revers écologiques que traverse le monde naturel. Dans leur démarche, à la fois historique et herméneutique, ils ont avant tout élaboré une critique de la conception dualiste, objectiviste, technicienne et matérialiste qui a dominé le temps moderne.
Cette conception avalisée surtout par le rationalisme cartésien et le monisme spinozien serait à la base du désenchantement du monde créé. Ces théologiens prônent le retour aux sources chrétiennes pour retrouver la foi en Dieu créateur comme vraie source d’inspiration. Leur théologie de la création, s’enrichit des découvertes scientifiques récentes indiquant que ces deux disciplines peuvent s’articuler en véritable symbiose.
Cette démarche est à notre sens crédible et plausible étant donné que l’entreprise théologique ne constitue pas un système clos mais plutôt un lieu d’échange et d’enrichissement mutuel.
Questions Fréquemment Posées
Comment la théologie de la création peut-elle aider à résoudre la crise écologique ?
La théologie chrétienne de la création, en se renouvelant, peut apporter un souffle nouveau pour remédier à cette situation aux allures irréversibles.
Quelle est la thèse de Lynn White Jr. sur l’anthropocentrisme du christianisme ?
Lynn White Jr. affirme que le christianisme, spécialement dans sa forme occidentale, étant la religion la plus anthropocentrique, a modelé l’homme qui se croit supérieur à la nature.
Quel modèle d’écologie intégrale est proposé dans l’article ?
L’article s’inspire de l’exemple de Saint François d’Assise comme modèle d’écologie intégrale.