Le cadre théorique des attitudes linguistiques révèle que 70% des étudiants subsahariens perçoivent le français comme essentiel dans leur vie quotidienne. Cette étude met en lumière des représentations souvent méconnues, transformant notre compréhension de l’usage linguistique dans un contexte multiculturel.
Les attitudes et représentations linguistiques
Les notions d’attitudes et de représentations linguistiques sont complémentaires parce que ces deux notions se basent sur le contenu et les formes du discours épilinguistique où les locuteurs expriment leurs sentiments et leurs opinions sur leurs langues, les langues en présences, celles des autres. Ces deux concepts sont liés l’un a l’autre et donc tous les deux aux comportements. Mais par ordre de présence, les représentations précèdent les attitudes parce que ce sont des images mentales traduites par un comportement linguistique. C’est en effet cet aspect chronologique qui différencie les attitudes des représentations.
L’attitude linguistique
L’attitude en général est définie par PETTY comme : « l’évaluation générale et relativement durable que les gens ont par rapport à des objets, idées ou autres personnes. Ces évaluations peuvent être positives, négatives ou neutres et peuvent varier en intensité. ».13
12 MOREAU, M-L, 1997, Sociolinguistique concepts de base, MARDAGA, P32-33.
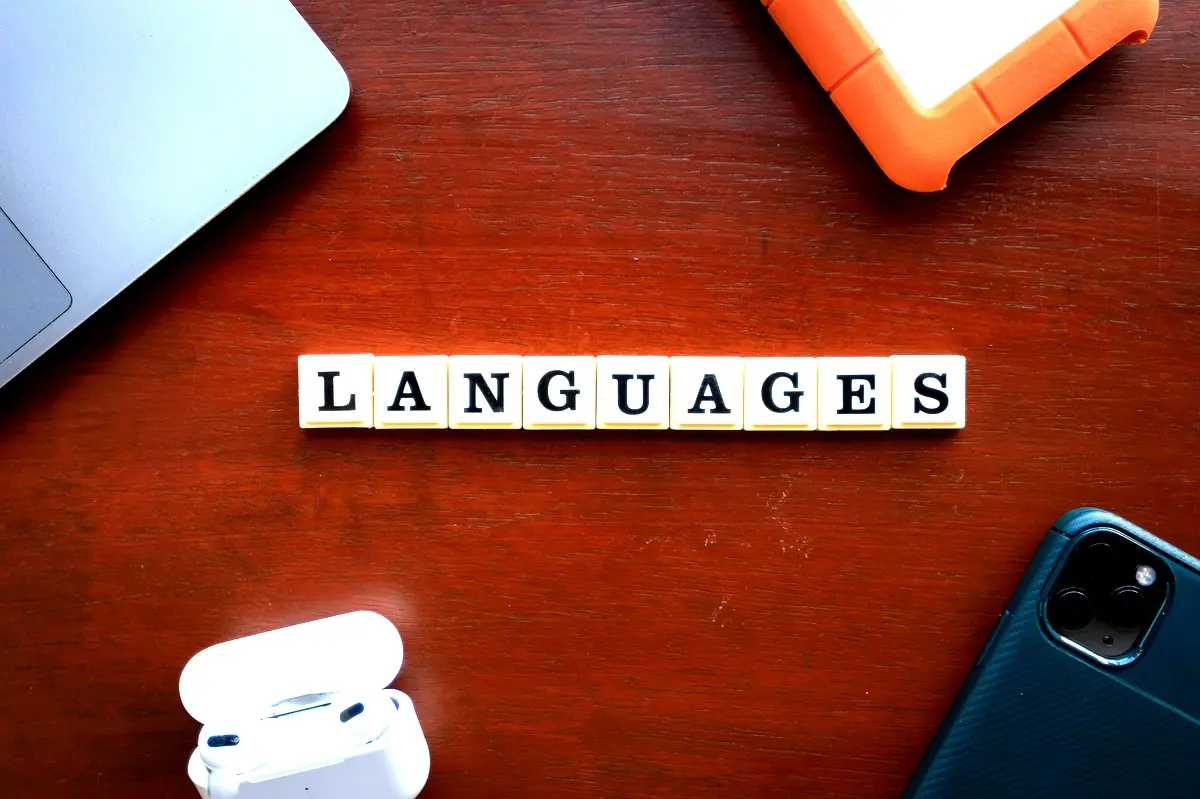
L’attitude linguistique quant à elle, émanant du plurilinguisme et du contact entre les langues est un ensemble de jugements sociaux portés par les locuteurs sur les variétés linguistiques. Pendant les années soixante, le concept d’attitude linguistique est employé parallèlement à représentation, norme subjective, évaluation subjective, jugement, opinion, pour désigner tout phénomène à caractère épilinguistique qui a trait au rapport à la langue.
En effet selon le dictionnaire de la linguistique, les attitudes langagières constituent l’ensemble des opinions explicites ou implicites sur l’usage d’une langue. Ces attitudes concernent le plus souvent les langues minoritaires ou même les langues étrangères.
Pour CALVET L.J. : « les attitudes linguistique renvoient à un ensemble de sentiments que les locuteurs éprouvent pour les langues ou une variété d’une langue. Ces locuteurs jugent, évaluent leurs productions linguistiques et celle des autres en leur attribuant des dénominations. Ces dernières relèvent que les locuteurs, en se rendant compte des différences phonologiques, lexicales, et morphosyntaxiques, attribuent des valeurs appréciatives ou dépréciatives à leur égard. ».14
Quant à YAGUELLO M, pour elle, les attitudes linguistiques peuvent être distinguées de trois natures différentes :15
- Explicatives, conduisant à des rationalisations, à des tentatives de théorisation, ainsi par exemple sur l’adéquation du genre grammatical et du genre naturel, sur l’origine des mots et des langues, etc. ;
- Appréciatives, se traduisant sur des jugements sur la beauté, la logique, la clarté, la simplicité de telle ou telle langue ;
- Normatives, s’exprimant par l’opposition à toutes les formes de « corruption » de la langue.
13 PETTY, 2003, dans HOUVILLE S-L, 2012, Attitudes linguistiques : définitions, implications et applications à l’anglais, mémoire de master études anglophones, Université Stendhal Grenoble III, P10.
14 CALVET L.J., 1993, La sociolinguistique, PUF, collection Que sais-je ? Paris, P46.
15 YAGUELLO M, 1988, dans HOUVILLE S-L, 2012, Attitudes linguistiques : définitions, implications et applications à l’anglais, mémoire de master études anglophones, Université Stendhal Grenoble III, P19.
La représentation linguistique
Il est à noter que l’usage du terme représentation en sociolinguistique est un emprunt aux sciences humaines (géographie, histoire, psychologie sociale) apparu pour la première fois au début du XXème siècle. Les sciences humaines qui d’ailleurs elles-mêmes le tiennent du vocabulaire de la philosophie. Là, il désigne une forme courante (et non savante) de connaissances, socialement partagée, qui contribue à une vision de la réalité commune à des ensembles sociaux et culturels.16
En effet les représentations peuvent être linguistiques, représentation de l’étranger, représentation de la culture étrangère ou même celle des langues en contact.
Les jugements sur la langue ou sur les langues appartiennent au domaine des représentations ou des phénomènes épilinguistiques. Les représentations regroupent les attitudes, les perceptions et les opinions linguistiques. L’origine des représentations en tant que croyances collectives partagées par la communauté linguistique remontent aux années 1950.17
Pour HENRI BOYER la représentation est : « un ensemble de systèmes d’interprétations régissant notre relation au monde et aux autres, donc à la langue, à ses usages et aux usagers de la communauté linguistiques. Celui-ci conçoit les représentations comme : « l’ensemble des images que les locuteurs associent au monde qu’ils pratiquent, qu’il s’agisse de valeurs, d’esthétique ce sentiment normatif plus largement métalinguistique. Elles permettent de sortir de l’opposition radicale entre le réel, les faits objectifs dégagés par la description linguistique, et l’idéologie. »18
P.BOURDIEU quant à lui considère qu’il faut inclure dans le réel la représentation du réel, ou plus exactement la lutte des représentations, au sens d’images mentales, mais aussi de manifestations sociales destinées à manipuler les images mentales. Pour lui la langue, le dialecte ou l’accent, réalités linguistiques, sont l’objet de représentations mentales, c’est-à-dire d’actes de perception et d’appréciation, de connaissance et de reconnaissance où les agents montrent leurs intérêts et leurs présupposés.19
16 MOREAU, M-L, 1997, Sociolinguistique concepts de base, MARDAGA, P.246.
17 T.T ; « Le pouvoir des représentations. » (Page consultée le 23/05/2021), Le pouvoir des représentations | art, langage, apprentissage (hypotheses.org).
18 BOYER H, (p79), dans CHERINGUEN F, les enjeux de la nomination des langues de l’Algérie contemporaine, l’Harmattan, Paris, 2007, (19).
19 BOYER H, 2001, Introduction à la sociolinguistique, Dunod, Paris, P.42.
Nous citons aussi CALVET qui relie la notion de représentation à celle de l’insécurité linguistique. Il affirme donc à ce sujet que : « du côté des représentations se trouve la façon dont les locuteurs pensent les pratiques, comment ils se situent par rapport aux autres locuteurs, et aux autres pratiques, comment ils situent leurs langues par rapport aux autres langues. »20 Ce dernier souligne aussi que les représentations déterminent :
- Des jugements sur les langues et la façon de les parler, jugement qui souvent se répandent sous forme de stéréotypes.
- Des attitudes face aux langues, aux accents, c’est-à-dire face aux locuteurs que les stéréotypes discriminent.
- Des conduites linguistiques tendant à mettre la langue du locuteur en accord avec ses jugements et ses attitudes.
Conclusion partielle
Pour conclure nous avons évoqué dans ce chapitre quelques concepts sociolinguistiques clés que nous avons bien sûr jugés utiles dans le cadre de la réalisation de notre travail, nous nous sommes donc intéressés à les définir.
Dans le chapitre suivant, nous allons nous focaliser sur l’aspect méthodologique. En effet nous allons aborder l’ensemble de méthodes et techniques scientifiques auxquelles nous avons recouru dans l’élaboration de ce travail de recherche.
20 CALVET, L-J., 1999, Pour une écologie des langues du monde, France, PLON, p.158.
________________________
12 MOREAU, M-L, 1997, Sociolinguistique concepts de base, MARDAGA, P32-33. ↑
13 PETTY, 2003, dans HOUVILLE S-L, 2012, Attitudes linguistiques : définitions, implications et applications à l’anglais, mémoire de master études anglophones, Université Stendhal Grenoble III, P10. ↑
14 CALVET L.J., 1993, La sociolinguistique, PUF, collection Que sais-je ? Paris, P46. ↑
15 YAGUELLO M, 1988, dans HOUVILLE S-L, 2012, Attitudes linguistiques : définitions, implications et applications à l’anglais, mémoire de master études anglophones, Université Stendhal Grenoble III, P19. ↑
16 MOREAU, M-L, 1997, Sociolinguistique concepts de base, MARDAGA, P.246. ↑
17 T.T ; « Le pouvoir des représentations. » (Page consultée le 23/05/2021), Le pouvoir des représentations | art, langage, apprentissage (hypotheses.org). ↑
18 BOYER H, (p79), dans CHERINGUEN F, les enjeux de la nomination des langues de l’Algérie contemporaine, l’Harmattan, Paris, 2007, (19). ↑
19 BOYER H, 2001, Introduction à la sociolinguistique, Dunod, Paris, P.42. ↑
20 CALVET, L-J., 1999, Pour une écologie des langues du monde, France, PLON, p.158. ↑
Questions Fréquemment Posées
Qu’est-ce que l’attitude linguistique selon PETTY?
L’attitude est définie par PETTY comme : « l’évaluation générale et relativement durable que les gens ont par rapport à des objets, idées ou autres personnes. Ces évaluations peuvent être positives, négatives ou neutres et peuvent varier en intensité. »
Comment les attitudes linguistiques sont-elles liées aux représentations linguistiques?
Les représentations précèdent les attitudes parce que ce sont des images mentales traduites par un comportement linguistique.
Quels types d’attitudes linguistiques YAGUELLO distingue-t-elle?
YAGUELLO distingue trois natures d’attitudes linguistiques : explicatives, appréciatives et normatives.
