L’usage du français chez les étudiants subsahariens révèle une dynamique surprenante : cette langue est non seulement un outil de communication, mais aussi un vecteur d’identité culturelle. Cette étude met en lumière des résultats essentiels qui redéfinissent notre compréhension du français dans un contexte universitaire diversifié.
Chapitre I :
Aspect Théorique : Définitions de
Quelques Concepts Sociolin-
guistiques.
Définition de quelques concepts sociolinguistiques
Introduction
Dans le cadre de notre travail de recherche au sein des résidences de l’Université Salah Boubnider sises à Constantine, nous allons en premier lieu essayer de définir quelques concepts relatifs à notre sujet de recherche tout au long de ce chapitre. Ces concepts nous seront sans nul doute utiles un peu plus loin dans la partie pratique de ce dit travail.
La langue véhiculaire
Au sens le plus courant, une langue est un instrument de communication, un système de signes vocaux spécifique aux membres d’une même communauté, telle est la définition donnée dans le dictionnaire de la linguistique.
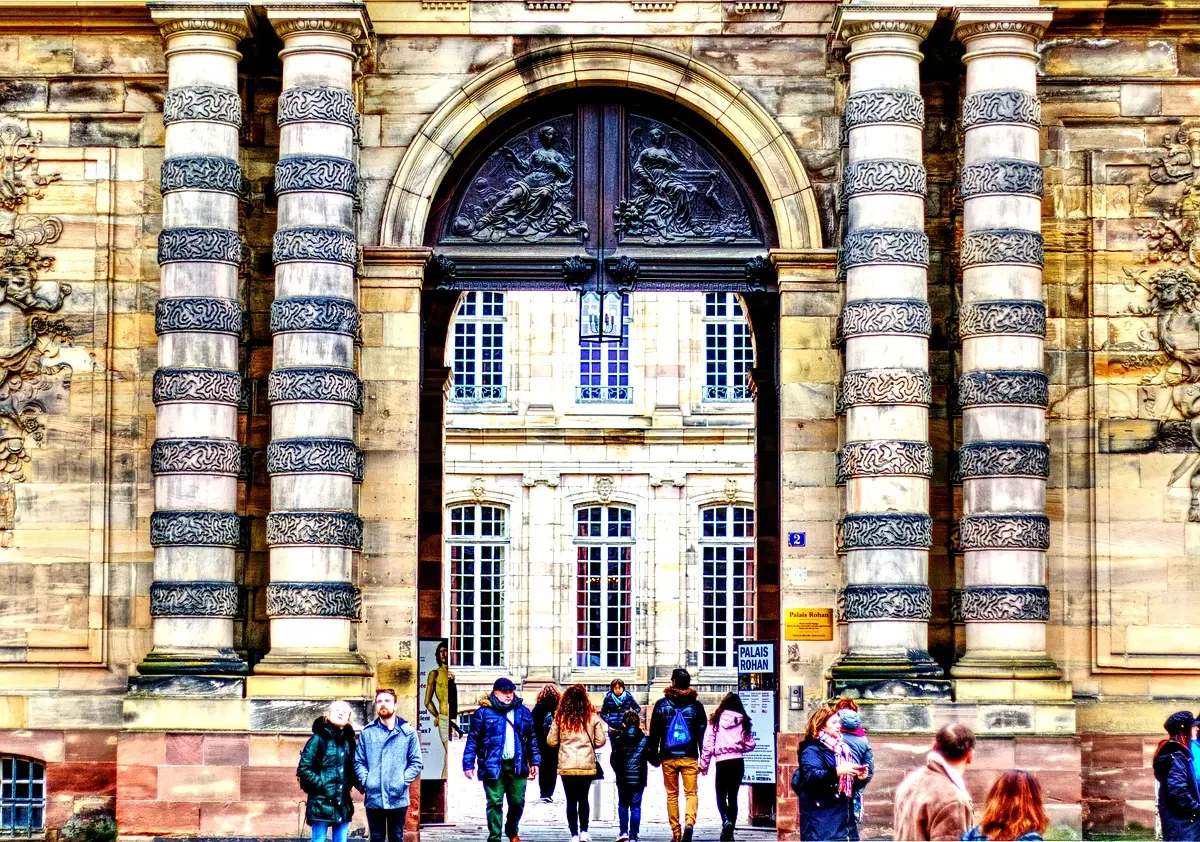
La langue étant définie, nous tenons à souligner qu’il existe différentes langues à travers le monde et qu’elles sont en contact entre elles pour des raisons d’ordre géographique, historique, individuel ou social. C’est dans cette optique que J-L.CALVET affirme que : « Les êtres humains sont confrontés aux langues où qu’ils soient, quelle que soit la première langue qu’ils ont entendue ou apprise, ils en rencontrent d’autres tous les jours, les comprennent ou ne les comprennent pas, les reconnaissent ou ne les reconnaissent pas, les aiment ou ne les aiment pas, sont dominés par elles ou les dominent : le monde est plurilingue, c’est un fait ».4 Comme l’a dit J-L CALVET le monde est plurilingue, il définit ainsi la langue véhiculaire comme : « une langue utilisée pour la communication entre des groupes qui n’ont pas la même première langue ».
A titre d’exemple, le haoussa au Niger sert souvent de langue véhiculaire pour d’autres ethnies et cela est aussi souvent observé au-delà même du territoire national. Nous tenons aussi à souligner l’affirmation de J-L CALVET selon laquelle la langue véhiculaire « peut être la langue d’un des groupes en présence (par exemple, le wolof au Sénégal, le bambara au Mali, etc.) ; la langue véhiculaire peut être une langue créée, langue composite empruntant aux différents codes en présence »5
4 CALVET Louis-Jean, 1987, La guerre des langues et les politiques linguistiques, Paris, PAYOT, P.43.
5 CALVET Louis-Jean, 2013, La sociolinguistique, PUF.
Le dictionnaire de la linguistique quant à lui définit la langue véhiculaire comme : une des langues d’une région donnée où vivent plusieurs communautés linguistiques différentes, utilisée de manière privilégiée pour l’intercompréhension.
Pour les linguistes, il s’agit des « langues utilisées pour l’intercompréhension entre des communautés linguistiques géographiquement voisines et qui ne parlent pas les mêmes langues »6. En nous référant donc à l’ensemble de ces définitions nous dirons que plus une langue est véhiculaire, plus elle assure la plus grande intercompréhension, c’est la langue qui est la plus attendue, entendue et la plus utilisée.
Cependant nous devons distinguer la langue véhiculaire de la langue vernaculaire. Cette dernière est une langue à diffusion locale ou régionale, par opposition à une langue véhiculaire qui permet la communication avec d’autres groupes. La cohabitation d’un grand nombre de langues vernaculaires et d’une langue véhiculaire est fréquente dans les États issus de la décolonisation comme l’Inde ou de nombreux États africains, mais elle se retrouve aussi dans la plupart des grands États du monde, par exemple le Canada, la Russie, ou la Chine.7 Cela dit, la langue vernaculaire d’une région donnée peut devenir véhiculaire dans d’autres pays, mais n’est vernaculaire que là où elle est langue maternelle.
La communauté linguistique
La notion de communauté linguistique qui selon le dictionnaire de linguistique se définit comme : « un groupe d’êtres humains utilisant la même langue ou le même dialecte à un moment donné et pouvant communiquer entre eux »8, est presque aussi vieille que la linguistique. Mais les différents linguistes lui ont donné des définitions variées. Pour L.BLOOMFIELD : « Une communauté linguistique est un groupe de gens qui agit au moyen de discours », il rajoute aussi que : « les membres d’une communauté linguistique peuvent parler d’une façon si semblable que chacun peut comprendre l’autre ou peuvent se différencier au point que des personnes de régions voisines peuvent ne pas arriver à se comprendre ».
6 CALVET Louis-Jean, 1981, Les langues véhiculaires, Paris, P.23.
7 Géoconfluences, (JBB) juin 2018, «Vernaculaire (langue, patrimoine…) », (Page consultée le 26 Mai 2021), http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/vernaculaire.
8 DUBOIS, J, 1994, Dictionnaire de la linguistique et des sciences du langage, Larousse.
les unes les autres. Pour lui il peut donc ne pas y avoir intercompréhension entre les membres d’une même communauté linguistique.
W.LABOV quant à lui définit la communauté linguistique comme : « un groupe qui partage les même normes quant à la langue » ou encore « comme étant un groupe de locuteurs qui ont en commun un ensemble d’attitudes sociales envers la langue ».
Bilinguisme/Plurilinguisme ou Multilinguisme
Le bilinguisme
Le bilinguisme est l’une des principales conséquences du phénomène de contact des langues, on considère qu’il y’a bilinguisme lorsqu’une personne est capable d’user de deux systèmes linguistes de manière égale et sans qu’un système ne soit valorisé par rapport à l’autre. C’est un phénomène sociolinguistique qui caractérise les locuteurs pratiquant deux langues.
Selon le dictionnaire de linguistique et des sciences des langages : « le bilinguisme est la situation linguistique dans laquelle les sujets parlants sont conduits à utiliser alternativement, selon les milieux et les situations, deux langues différentes ».9
Cependant nous tenons à souligner la distinction entre le bilinguisme et la bilingualité. HAMERS et BLANC « opposent la bilingualité au bilinguisme en mettant sous le premier l’ensemble des états ou des facteurs psychologiques liés à l’utilisation de deux systèmes linguistiques différents et sous le second les facteurs proprement linguistiques ».10
Le plurilinguisme ou multilinguisme
Le monde est plurilingue ; et tous les linguistes le reconnaissent par l’existence d’une multitude de langues dans le monde. Comme nous l’avons cité un peu plus haut, c’est dans cette optique que J-L.CALVET affirme que : « Les êtres humains sont confrontés aux langues où qu’ils soient, quelle que soit la première langue qu’ils ont entendue ou apprise, ils en rencontrent d’autres tous les jours, les comprennent ou ne les comprennent pas, les reconnaissent ou ne les reconnaissent pas, les aiment ou ne les aiment pas, sont dominés par elles ou les dominent : le monde est plurilingue, c’est un fait ».
On considère qu’il y’a plurilinguisme ou multilinguisme lorsqu’une personne est capable d’user de plusieurs systèmes linguistiques.
Ce concept renvoie selon TRUCHOT.C : « à la coexistence de plusieurs systèmes linguistiques et communautés linguistiques dans une aire géographique donnée ».
L’alternance codique
Les voisinages des communautés linguistiques, le déplacement des individus pour des raisons quelconques, la colonisation, les guerres, la religion… sont les principales causes qui ont engendré le phénomène de contact des langues. Ce dernier à son tour donna naissance à d’autres phénomènes qui lui sont étroitement liés, notamment l’alternance codique.
Elle peut se définir selon GUMPERZ comme : « la juxtaposition à l’intérieur d’un même échange verbal de passages où le discours appartient à deux systèmes ou sous-systèmes grammaticaux différents ».
D’autres linguistes remettent en cause l’existence du mélange codique, c’est le cas de HAUGEN qui reconnait l’existence du fait que les bilingues passent d’une langue à une autre mais pour qui : « l’introduction d’éléments d’une langue dans une autre langue ne signifie pas un mélange des deux, mais plutôt un passage à l’autre langue ».
Selon le dictionnaire de la linguistique et des sciences du langage : « on appelle alternances des langues la stratégie de communication par laquelle un individu ou une communauté utilise dans le même échange ou le même énoncé deux variétés nettement distinctes ou deux langues différentes alors que le ou les locuteur(s) sont expert(s) dans les deux langues ou dans les deux variétés (alternance de compétence) ou ne le sont pas (alternance d’incompétence) ».11
11 DUBOIS, J, 1994, Dictionnaire de la linguistique et des sciences du langage, Larousse.
L’alternance peut être, selon la structure syntaxique des segments alternés, intraphrastique, interphrastique ou extraphrastique12 :
- Intraphrastique, lorsque des structures syntaxiques appartenant à deux langues coexistent à l’intérieur d’une même phrase ; c’est-à-dire lorsque les éléments caractéristiques des langues en cause sont utilisés dans un rapport syntaxique très étroit ;
- Interphrastique, quand il y a une alternance de langue au niveau d’unités plus longues, de phrases ou de fragments de discours, dans les productions d’un même locuteur ou les prises de parole entre interlocuteurs ;
- Extraphrastique, lorsque les segments alternés sont des expressions idiomatiques appartenant aux deux langues, comme les proverbes, les dictons… etc.
________________________
2 Définition donnée par l’article 62 de la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai 2001. ↑
3 Auchan Les 4 Temps, La Défense. ↑
6 CALVET Louis-Jean, 1981, Les langues véhiculaires, Paris, P.23. ↑
7 Géoconfluences, (JBB) juin 2018, «Vernaculaire (langue, patrimoine…) », (Page consultée le 26 Mai 2021), http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/vernaculaire. ↑
8 DUBOIS, J, 1994, Dictionnaire de la linguistique et des sciences du langage, Larousse. ↑
9 DUBOIS, J, 1994, Dictionnaire de la linguistique et des sciences du langage, Larousse. ↑
11 DUBOIS, J, 1994, Dictionnaire de la linguistique et des sciences du langage, Larousse. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quelle est la définition d’une langue véhiculaire ?
Une langue véhiculaire est définie comme une langue utilisée pour la communication entre des groupes qui n’ont pas la même première langue.
Comment le français est-il perçu par les étudiants subsahariens à Constantine ?
Le français est perçu comme un outil de communication essentiel dans un contexte de diversité culturelle parmi les étudiants subsahariens.
Quelles méthodes ont été utilisées pour l’enquête sur l’usage du français ?
Les méthodes d’enquête incluent des questionnaires et des enregistrements pour une analyse approfondie des données.
