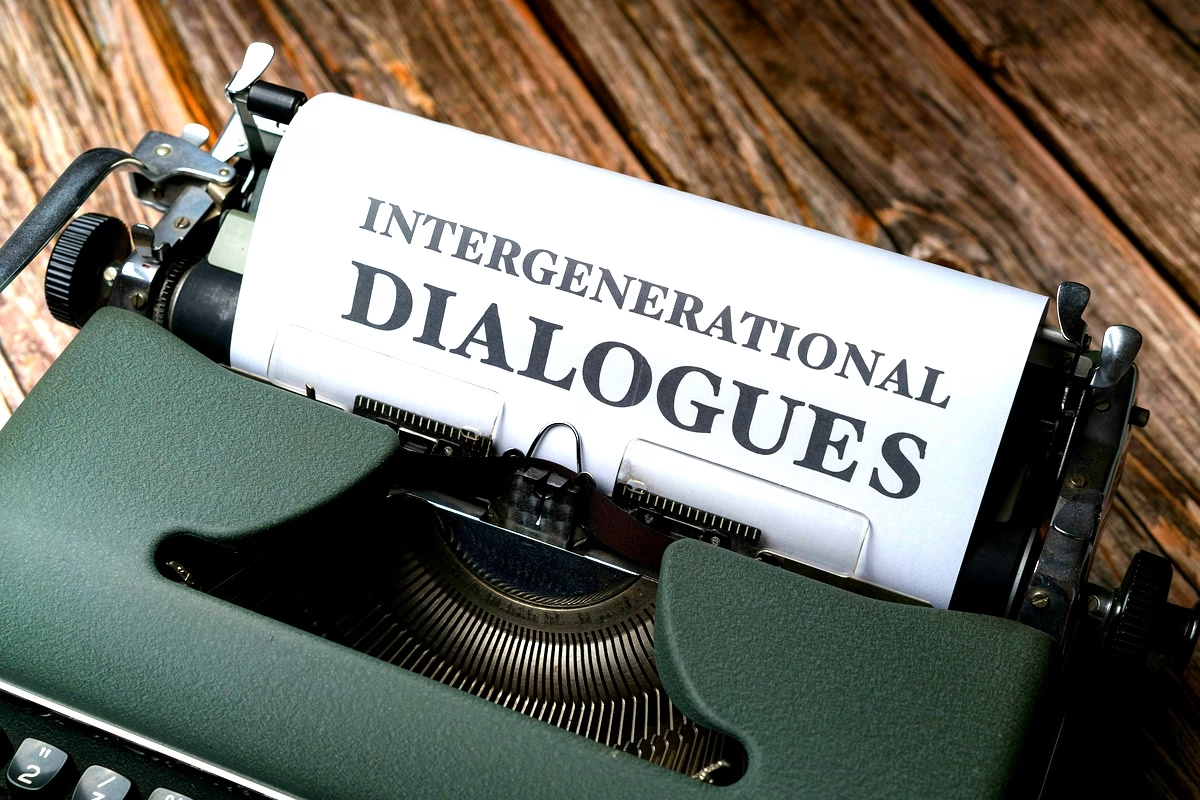Cette étude révèle comment l’analyse du discours politique du ministre algérien sur France 24 et RFI dévoile des stratégies discursives subtiles. Quelles implications ces méthodes pragmatiques et argumentatives ont-elles sur notre compréhension des intentions politiques ?
Théorie de la pertinence :

Il existe aussi une théorie étroitement liée à la théorie pragmatique dite la théorie de la pertinence qui partage avec cette dernière des concepts pragmatiques communs comme les présupposés, les implicatures, qui servent comme indices significatifs pour l’interlocuteur selon le contexte de la production langagière pour pouvoir inférer l’intention du locuteur dans la situation de communication.
Cette théorie est apparue après l’émergence des maximes de Grice, pose que le langage vise à produire exclusivement ce qui est pertinent. Elle a été développée par le philosophe français Dan Sperber et le linguiste anglais Deirdre Wilson.
Cette théorie repose sur le principe de pertinence qui nous permet de déceler le sens dans un énoncé au moment où le segment linguistique dissimule les informations nécessaires à la compréhension.
Un recours au contexte recherché dans le monde réel permet de préciser la signification et obtenir plus de détails qui complètent l’information, ce principe traduit par une logique qui relie les énoncés à des implications matérielles et les interpréter en appliquant les règles du concept du raisonnement logique pour étudier et analyser le sens sémantique et exprimer la signification de chaque énoncé.
Selon Sperber et Wilson « La tâche du destinataire est alors de construire une interprétation du message propre à confirmer cette présomption de pertinence ». (Sperber & Wilson, 1990, 74)
Ces considérations de pertinence permettent au destinataire de reconnaître les contenus explicites et implicites d’un énoncé, le type d’acte de parole que cet énoncé sert à accomplir, son caractère littéral ou figuré, ses effets stylistiques.
La présence de l’orateur dans son discours :
L’énonciation est l’action de produire un énoncé (discours) qui se réalise dans une situation énonciative déterminée par le temps, le lieu,…
Cette action nécessite deux actants énonciateur E1 et énonciataire E2, en attachant une importance au contexte, aux conditions sociales, culturelles et historiques qui l’entourent et tout ce qui peut influencer l’échange interactif et l’intersubjectivité des actants dans leur discours qui est l’objet d’étude de l’analyse du discours.
Cette discipline fait l’étude analytique du discours qui se diversifie en fonction du contexte physique ou symbolique de l’énonciation, par différentes approches et plusieurs visées selon les points de vue des linguistes en s’appuyant sur le repérage des embrayeurs, déictiques et modalisateurs.
Les embrayeurs
: ce sont tous les pronoms personnels, les déterminants et les formes verbales (les terminaisons et les temps des verbes) les pronoms personnels et les déterminants fréquents dans les discours comme le : «je » et le « nous », « vous », « notre », « leur »,… les formes verbales comme le présent de l’indicatif, l’imparfait, le futur,…
6.3. Les déictiques :
ce sont tous les indicateurs spatiotemporels comme : ici, maintenant, aujourd’hui, là,…
Les embrayeurs et les déictiques ne prennent sens que dans l’énoncé, les mots sont considérés comme des marques qui changent de sens et de référent à chaque énonciation.
6.4. Les modalisateurs :
ce sont les verbes, les adverbes et les adjectifs. Ce sont des formes qui ont un sens fixe et stable, qui ne change pas selon les situations d’énonciations. Le locuteur exprime sa subjectivité en utilisant des modalisateurs appropriés à sa prise de position dans son discours.
Ces embrayeurs, déictiques et modalisateurs trahissent la présence de l’énonciateur dans son discours, ils révèlent son intention, son opinion, ses pensées et tous les éléments qui composent sa subjectivité.
À travers ces éléments axiologiques, l’énonciateur marque sa présence, son point de vue, sa vision sur le monde, son jugement mélioratif ou péjoratif, ses sentiments, ses doutes,… selon les choix des mots de langue lorsqu’il utilise celle-ci pour produire des énoncés lors d’une prise de parole. L’analyse de l’énonciation qui observe l’implication du locuteur dans son discours à travers les différentes nuances qu’il utilise pour s’exprimer.
Emile Benveniste, le linguiste français, conçoit l’énonciation comme une opération qui prend usage de la langue pour construire un acte de langage, l’énonciateur surgit dans son discours, mobilise cet outil qui est la langue pour produire un énoncé et entretient une attitude et une relation avec son interlocuteur à travers l’énoncé qui comporte un objectif, une influence sur l’énonciataire et qui est interactif.
Dans une analyse du discours, on peut dégager la nature de la relation entre le locuteur et son interlocuteur au moment d’une énonciation, l’énonciateur marque sa présence et sa position dans son énoncé, c’est la subjectivité dans le discours. On peut apercevoir cette subjectivité par les choix des mots ; des embrayeurs, des déictiques, les verbes et les adjectifs selon l’axe paradigmatique et syntagmatique en effectuant à chaque fois un énoncé inédit.
Catherine Kerbrat-Orecchioni définit l’énonciation comme un processus où le locuteur choisit des signes linguistiques à chaque fois qu’il souhaite émettre un énoncé où il laisse son empreinte de subjectivité ou prend de la distance par rapport à son discours et cela dépend des formes linguistiques utilisées.
Selon Emile Benveniste : « Le langage est donc la possibilité de la subjectivité, du fait qu’il contient toujours les formes linguistiques appropriées à son expression, et le discours provoque l’émergence de la subjectivité, du fait qu’il consiste en instances discrètes » (Benveniste, 1966b, p 263).