Cette étude révèle comment les implicatures conversationnelles façonnent le discours politique, en analysant les stratégies discursives du ministre algérien des affaires étrangères. Découvrez les subtilités qui échappent à l’analyse logique et comment elles influencent la perception des intentions.
3. Les implicatures de Grice :
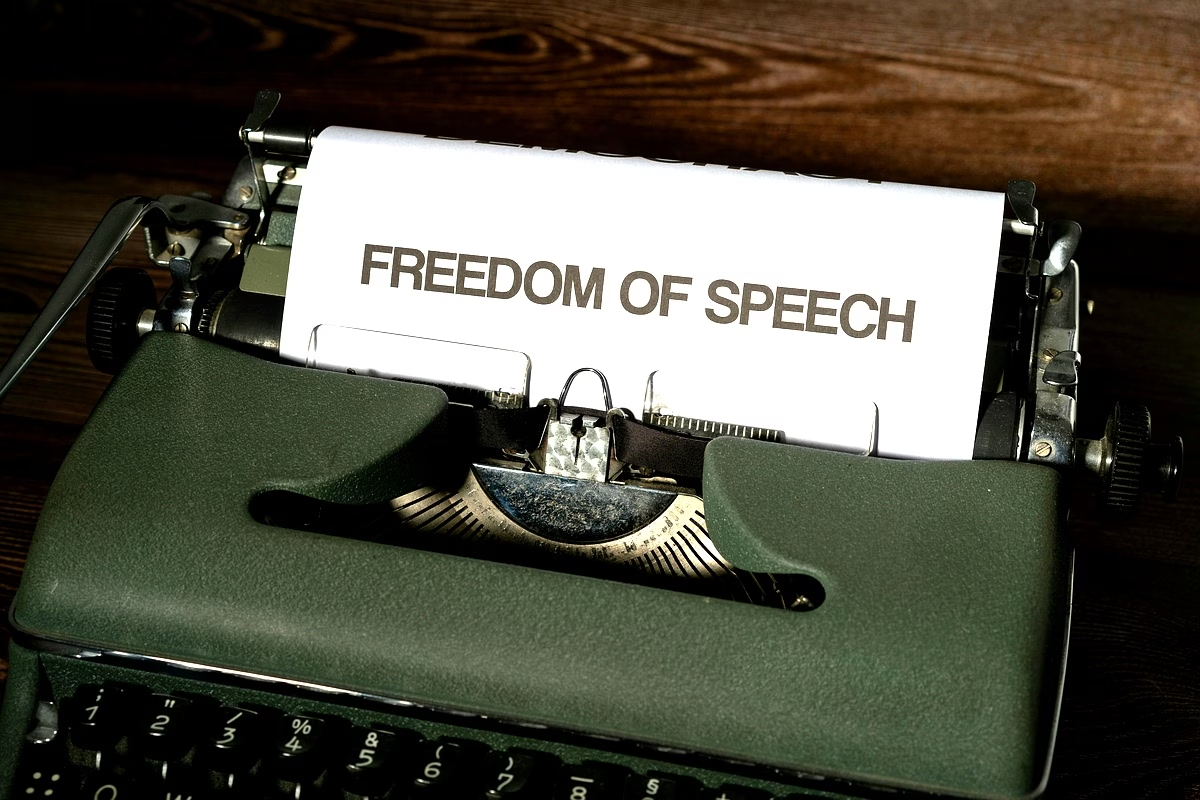
Influencé par Austin, Herbert Paul Grice a développé un processus inférentiel dans le domaine de la communication qui repose sur le principe de coopération suivi par le locuteur au moment d’une situation de communication, l’interlocuteur essaye de percevoir l’intention du locuteur.
Parfois, des implicites surviennent dans un énoncé et ne peuvent être expliqués par l’analyse logique et sémantique mais plutôt par des hypothèses qui dépassent ce que contient l’énoncé, ces hypothèses sont appelés des implicatures et des conventions qu’on va aborder dans ce qui suit vue qu’on aura besoin dans l’analyse des énoncés choisis.
3.1. Les implicatures conversationnelles et conventionnelles :
Selon Grice, un énoncé comporte un double sens ; objectif et subjectif, on peut les distinguer selon le désir de l’orateur, il y a deux types d’implicatures : les implicatures conversationnelles et les implicatures conventionnelles.
A/ Les implicatures conversationnelles :
C’est une inférence qu’on peut dégager par raisonnement logique dans un énoncé qui porte un sens, lors d’une conversation. Selon Francis Corblin : « l’implicature conversationnelle a donc toutes les propriétés de ce que les spécialistes du raisonnement ordinaire appellent une inférence par défaut ». (Corblin, 2013 : 88)
Les implicatures conversationnelles ce sont ce qui est communiqué à partir de ce qui est dit, se réfèrent à la sémantique. Lors d’une conversation, ce que l’interlocuteur en infère de ce que le locuteur énonce est appelé implicatures.
Par exemple :
- L’énoncé : la semaine passée, il a pris congé.
- L’implicature : à présent, il n’est plus en congé.
- Ou bien : il est toujours en congé.
Selon la linguiste Claire Beyssade : « Une implicature conversationnelle est ce qui suit d’une phrase, mais non pas au sens strict, logique. Plutôt ce qui suit de son énonciation dans une situation normale, ce qui suit en vertu des principes habituels qui régissent la conversation ». (C. Beyssade, 2008 : 05)
B/ Les implicatures conventionnelles :
Si les implicatures conversationnelles sont les inférences qu’on peut extraire de notre appréhension d’un énoncé selon une logique qui nous permet d’interpréter correctement le sens d’un énoncé par un autre énoncé, les implicatures conventionnelles sont les conséquences qui découlent d’un énoncé, mais si la conséquence n’est pas réelle, ne correspond pas à la vérité, la vérité de l’énoncé complet n’est pas affectée.
L’implicature conventionnelle est une implicature liée à un syntagme spécifique par convention qui se réfère à la notion pragmatique, selon Corblin « nous avons affaire à l’implicature d’un terme qui relie des propositions, et le contenu de l’implicature elle-même est une fonction propositionnelle à deux arguments, qui n’est pas représentable en logique des propositions ». (F. Corblin, 2013 : 85)
Par exemple :
- L’énoncé : Marc n’est pas généreux bien qu’il soit avocat.
- L’implicature : normalement si on est avocat, on est généreux.
- L’énoncé s’interprète comme « est-ce que l’avocat est généreux ? »
Pour Christian Plantin, cela fait partie du discours douteux « La logique, qu’on dit mère de l’argumentation […] est la science du transfert correct de la vérité d’énoncé à énoncé. Elle distingue des discours enchainé de façon valide et des discours douteux ». (Plantin, 2002)
Il y a une certaine correspondance entre implicatures et présuppositions, il s’agit dans les deux notions d’une information qui n’est pas citée explicitement dans l’énoncé.
4. La situation de communication :
Tout acte de langage se déroule forcément dans une situation de communication et à travers celle-ci on peut relever le sens de la production langagière « La situation de communication surdétermine en partie ces acteurs, leur donne des instructions de production et d’interprétation des actes langagiers et donc qu’elle est constructrice de sens »
(Patrick Charaudeau, 2007).
Chaque situation de communication réussie se compose de trois angles essentiels : le discours, qui a été précédemment défini, un contexte, un orateur et un auditoire.
4.1. La notion du contexte :
Chaque énoncé produit dans une situation d’énonciation est lié à des éléments intralinguistiques ou extralinguistiques qui prennent le nom de contexte, l’énoncé ne prend sens qu’à travers la prise en considération de ces éléments-là qui conditionnent sa production. Des éléments intralinguistiques ou linguistiques tout simplement sont les énoncés qui le précédent et/ou qui le suivent « le traitement des énoncés donne lieu à une série d’hypothèses locales sur l’intention du locuteur, qui sont à l’origine des hypothèses sur l’intention globale, qui sera soit renforcée, soit confirmée, soit infirmées par les énoncés suivants » (Moeschler, 2014).
Des éléments extralinguistiques ou non linguistiques sont les éléments qui accompagnent la production de l’énoncé comme le cadre spatiotemporel, les connaissances culturelles et encyclopédiques qui portent des informations à propos de l’énoncé en question, le statut des locuteurs, la relation entre le locuteur et son interlocuteur,… tous ces éléments-là composent le contexte de production de cet énoncé.
Dans le grand Robert de la langue française, le contexte désigne « l’entourage plus ou moins étendu d’un élément linguistique dans l’énoncé et les éléments de la réalité non linguistique associés à la production d’un élément d’énoncé ».
Le contexte peu être clair ou occulte, dans certaines situations il n’est pas donné mais construit par rapport aux connaissances et aux informations pré-acquises qui stipulent qu’un sens est le plus correspondant à un énoncé donné qu’un autre.
1. L’orateur :
L’orateur est celui qui prend la parole en public ou devant des personnes en entretien ou en réunion pour prononcer un discours, parler d’un sujet particulier pour informer ou influencer son auditoire en se distinguant d’un caractère particulier et en utilisant des stratégies discursives pour convaincre, persuader ou détourner l’opinion de l’auditoire.
Selon Oswald Ducrot : « Un des secrets de la persuasion telle qu’elle est analysée depuis Aristote est, pour l’orateur, de donner de lui-même une image favorable, image qui séduira l’auditeur et captera sa bienveillance » (Ducrot, 1984, 200) [(Duteil-Mougel, 2005)].
2. L’auditoire :
Selon le dictionnaire le Robert c’est « l’ensemble des personnes qui écoutent » c’est aussi l’assistance, le public.
En général, l’auditoire c’est les personnes qui écoutent le discours de l’orateur, ils interagissent avec l’énonciateur et valorisent ses arguments à travers leur adhésion.