Les stratégies d’écriture dans Ravisseur de Leila Marouane révèlent un positionnement idéologique à travers l’utilisation de la satire, permettant de critiquer les travers de la société algérienne. Cette analyse discursive met en lumière le rôle essentiel des dialogues dans l’intrigue et la représentation des idéologies.
III.3.2. Les stratégies d’écriture
L’investissement du genre choisi est une autre marque du positionnement idéologique de l’auteur. Nous l’avons signalé plus haut que Leila Marouane compose son récit comme une satire pour dénoncer les travers de la société algérienne. La satire est l’une des formes du discours humoristique qui permet et qui est apte à parler de malheurs.
Sous le couvert de la raillerie, nous pouvons dire ce que l’on pense sans s’occuper des interdits. Le rire sert d’alibi, en diminuant la portée de ce qui est dit.La volonté de l’auteur est de situer son roman aux frontières du tragi- comique. Ravisseur se construit sur des métaphores pour évoquer la violence par une extrême visualisation des scènes dialoguées.
Nous récapitulons que l’absurdité peut être supportée grâce à l’emploi de l’une des formes du discours humoristique qui est donc un moyen infaillible pour assumer une situation douloureuse et s’en débarrasser. Ce croisement de discours permet d’échapper au sentiment d’angoisse et d’absurdité.
Le positionnement de l’écrivaine se fait par rapport à d’autres écrivains. Selon Maingueneau « pour se positionner, pour se construire une identité le créateur doit définir des trajectoires propres dans l’intertexte1 ». Leila Marouane écrit sur des modèles préexistants,son roman est une manifestation d’une autre œuvre. À notre avis dans son récit, elle imite l’écriture de Boudjedra. Sur les traces de cet écrivain, son écriture se veut provocatrice et choquante.
Pareillement à Boudjedra qui a analysé le thème de la répudiation dans son roman « La Répudiation » publié en 1967, Leila Marouane trente ans plus tard, traite à son tour ce thème dans « Ravisseur ».
Boudjedra dénonce l’autorité paternelle, retrace la souffrance de la mère et ses enfants, tandis que Marouane imagine un renversement de situation et réévalue la place de la mère. Dans son récit, la répudiation est synonyme d’une nouvelle jeunesse, de jouissance pour la mère et de déchéance pour le père.
Son positionnement se fait non seulement par rapport à la littérature des années 60, mais en introduisant les voix féminines dans le récit, elle se situe dans l’écriture féminine introduite dans les années 80 par Djebar.
L’auteur a choisi comme matériau la condition de la femme au centre de cette violence qui ne cesse de croitre, une femme tenue pour responsable de tous les malheurs qui lui arrivent.
Plusieurs auteurs pour évoquer la marginalisation et l’aliénation de la femme créent un espace dominé par les hommes et où les femmes sont effacées. Alors que Marouane redonne la voix aux personnages féminins. Au moment où la voix masculine s’efface peu à peu, la voix féminine retrouve un espace de parole.
La parole est donnée à trois personnages masculins : Allouchi, Omar et Aziz. Le premier n’intervient pas directement, autre une parole isolée, ces paroles sont rapportées par d’autres personnages. Alors qu’Omar participe à deux dialogues. Et bien sûr c’est le père, figure de l’autorité qui s’emparera de la parole. Cette voix caractérise l’homme coléreux autoritaire et agressif qui provoque l’antipathie du lecteur. Une parole qui finira par ne plus avoir de crédibilité parce que devenue délirante.
Cette interdiction de donner la parole aux personnages masculins sinon pour la bafouer est une marque du positionnement de l’auteur.
Autre la condition de la femme dans la société algérienne, l’école constitue un espace de la dénonciation de l’auteur.L’échec scolaire, le refus d’aller à l’école sont une sorte de rejet d’une école qui selon les propos des personnages ne répond pas à leurs attentes.
Dans ce sens, ce lieu censé répandre le savoir est devenu un lieu d’ennui, un lieu risqué (attentats)
Le roman de Leila Marouane élabore un discours sur la violence de la société et de la famille. Pour fustiger l’application aveugle de la religion, l’auteur élabore un discours qui vise à secouer le lecteur et à le faire agir. Les descriptions, le choix du lexique, des adjectifs évaluatifs
sont les traces de la subjectivité de l’auteur. Ducrot souligne que « « toute production discursive présuppose l’existence d’un sujet producteur, qui s’inscrit dans l’énoncé directement […] ou indirectement »2
En effet, la parole de la narratrice dissimule celle de l’auteur productrice du texte qui s’efface derrière ses personnages pour dire son engagement, de « « laisser entendre sans encourir la responsabilité d’avoir dit »3
La situation d’énonciation qui représente « les participants du discours, son cadre spatio-temporel, son but » sont des éléments qui
« s’articulent de manière stable à travers des institutions langagières définies en termes de contrats de parole ou de genres de discours »4 Cette situation d’énonciation soulève la thématique de la violence.
L’auteur se positionne par rapport aux écrivains qui ont commencé avant elle l’écriture de tragédie algérienne. Or, elle veut se démarquer de ces prédécesseurs en s’éloignant de l’écriture témoignage et en écrivant le tragique sur un ton burlesque.
Contrairement à ces écrivains qui, durant la décennie noire, font appel à « écriture témoignage »5, Leila Marouane exprime la violence du monde réel sans pour autant la transposer ou la calquer.
Elle emploie de nombreux procédés pour dire l’indicible et mettre en scène une réalité complexe. Elle s’appuie sur la stylisation extrême de l’actualité sanglante « les séismes et les secousses ». Ainsi, l’auteure tourne le dos au réalisme qui a caractérisé la littérature algérienne durant cette période là.
Son style est original, singulier, différent de ce discours témoignage des écrivains qui « luttent afin de sortir de la spirale infernale du mal et du cauchemar qui étouffent leurs esprits»6
Leila Marouane, par son écriture dédramatise les évènements. Cette dédramatisation fait partie de son esthétique comme elle le
souligne :
« Raconter l’horreur dans son intégralité, c’est illisible. Pour moi, il est important de dédramatiser et de créer un contrepoids esthétique à la violence. C’est un travail à faire, un exercice de style »7
L’auteur ne nomme pas les évènements et les choses par leurs noms. Elle opte pour le non-dit et pour l’allusion.
Elle évoque par des périphrases, des métaphores et des images poétiques les évènements tragiques qui ont secoué l’Algérie.
Prenons cet extrait du polylogue ayant pour thème central l’agression de Samira, qui a aussi permis d’annoncer l’arrestation du père, de revenir sur les moqueries des voisins, et surtout montrer l’état de la narratrice après l’agression: visage défiguré, chuintement et traumatisme.
- Notre famille n’arrête pas de se disloquer, dit Yasmina.
Amina la regarda comme si jamais elle n’avait entendu pareille absurdité.
- Quelle est de nos jour la famille encore intacte ? Ailleurs les tremblements de terre n’ont plus de cesse. Et tous les volcans sont en éruption. Leur lave enlise des villages entiers.
- On dit que maman et Allouchi habitent dans le désert, là où il n’y a ni séismes ni volcans. Juste du pétrole. Même que maman attendrait un bébé, dit Fouzia.(p.123)
Les locutrices soulignent l’état d’angoisse qui s’est généralisé dans toute la société. La question d’Amina n’est pas une demande d’information, mais une réaction à l’assertion de Yasmina qui fait un constat. Cette réaction lui permettra d’insérer une autre information : généraliser la situation vécue par la famille Zeitoun à toute une société. Elle recourt au discours métaphorique pour expliquer ce qu’endure la société
A aucun moment, l’auteure ne cite les mots « terroriste » ou terrorisme. Elle préfère à ces termes directs des termes plus forts en représentation comme « Ravisseur », « homme sans visage », « homme/femme » pour réduire, railler et marquer la lâcheté de ces personnes en les comparant à des « hommes/femme ».
- Il t’en voudra toujours même s’il s’est acharné à retrouver les coupables. Comment peut-on reconnaître des êtres surgis du tréfonds de la terre ? Comment distinguer des intra terrestres…Tu les reconnaîtras, toi ? p.128
Ces désignations qu’utilise Yasmina dans sa réplique, servent à créer l’opposition entre les être ordinaires et les intégristes. C’est donc un moyen de dénoncer ces individus et leur comportement.
Le récit glisse de la réalité concrète vers l’image poétique, sans qu’elle soit embellie. L’auteure puise dans une terminologie propre au tremblement de terre « tremblements », « secousses », « séismes ».
Aujourd’hui la terre vibrait, tremblait, s’écartelait et engloutissait des humains sous le regard approbateur d’hommes sans visage déclamant des textes d’eux seuls connus. p.15
Elle emploie une série de métaphores pour suggérer l’irruption de la violence. Ces images servent à évoquer l’état du pays, et insistent sur la violence qui couve sous la surface sous forme de « séismes et irruption volcanique ».
La rumeur qui enflait, gonflait. Qui bientôt se déverserait devant nos portes nous annonçant des séismes et les réveils des volcans. p.43
L’image du tremblement de terre et des séismes dévastateurs qui embrasent le pays tout entier signale la peur et de la terreur.
La terre en en vibrait, ses entrailles s ‘en échauffaient. Son bouillonnement n’épargnait même plus les sourds. Bref une histoire d’énergie géothermique guère faste. p.141
Elle suggère aussi de manière puissante le caractère des évènements des années quatre vingt dix en s’appuyant sur la gradation.
Lorsque les volcans rugissaient, rougissaient, vomissaient, répandant leurs laves, ensevelissaient ceux qui vivaient alentour, happant leur vie sans aucune autre forme de remords. (p.132)
De nos jours blinder des issues exigeait une fortune. Mais il fallait absolument ces onéreuses installations. Il était maintenant indispensable de se doter de systèmes antisismiques. p.141
Ils renforçaient persiennes et portes j… personnes n’étaient à l’abri de ce que vous savez -… (p.96)
Dans ce contexte aussi, l’auteure relate des faits concrets réels attribués à ces hommes sans visage. Il s’agit de l’attentat qui a soufflé une maternelle et du viol de Samira. Néanmoins ces récits sont relatés de manière humoristique pour atténuer leurs effets chez le lecteur.
L’attentat de la maternelle est narré par un personnage enfant Noria qui est en même temps un personnage comique et ce pour dédramatiser ce fait tragique.
- Scha m’aidera à eschpliquer, dit-elle en ouvrant le pot.
- Elle était aussi blanche que sa blouse d’écolière. Mais le miel ne l’aida point.
- schéishmes… schecousches… (p. 107)
L’auteure évite de présenter le sujet sous forme de documentaire. Elle ne décrit pas les attentats, mais ce qu’il en résulte comme dégâts matériels
et humains d’une façon comique.
– Il y avait des bras, des jambes, partout, partout, poursuivit-elle, les joues rouges tantôt, tantôt blêmes. J’ai même vu des doigts collés à un morceau de mur tombé de la façade. Je les ai ramassés et donnés au directeur qui cherchait les siens comme un fou. Il a attrapé les doigts, les a comptés, il en manquait un, le pouce je crois, mais il a dit que ça ne faisait rien.
Il les caressait en chialant. Il attendait l’ambulance en tremblant, puis, comme ça, du bout des lèvres, il les a embrassés, et il n’arrêtait pas de dire que j’étais une bonne fille. Quand les larmes n’ont plus troublé sa vue, il n’a plus rien dit et tout d’un coup les veines de son cou ont grossi et bleui, ses yeux sortaient de son visage.
Et il m’a jeté les doigts à la figure en hurlant qu’il n’avait pas besoin des doigts d’une femme. Alors je les ai regardés de plus près, les ongles étaient peints de vernis rouge, très rouge. Je me demande comment je n’ai pas vu tout ce rouge…p.108
Nous apercevons le comique de situation dans le comportement du directeur qui cherche ses doigts, puis les compte, ensuite sa colère lorsqu’il constate qu’ils appartiennent à une femme. Mais le comique est aussi présent dans la question indirecte de Fouzia. Ironiquement elle renvoie au sang qui était sur le lieu : si elle n’avait pas vu ce rouge, c’est parce que tout était rouge.
L’auteur rapporte des évènements en se référant à une réalité vécue mais dans une dimension esthétique pour atténuer leur ampleur.
La narration du viol de Samira ne vient qu’après sa défiguration par le père. Son état psychique était donc atteint, et le viol ne surgit qu’en bribes de mémoires. Ainsi, ce viol n’a pas un grand effet sur le lecteur mais dévoile uniquement les pratiques de ces individus à travers la vision d’une de leur victime.
L’auteur utilise ce que Claude Duchet nomme « le topos de la lumière »8 une technique qui assure une rhétorique du dévoilement qui fait passer de l’inconnu au connu. Par le souvenir, la narratrice relate d’abord son enlèvement à la sortie de l’hôpital, puis c’est son cauchemar qui nous dévoilera la scène du viol collectif.
La thématique du viol est reprise pour montrer l’absence de soutien aux femmes violées ou même de droit de l’avortement. Cette thématique permet à l’auteur d’introduire son discours satirique contre ces fatwas qui nous viennent de l’étranger, contre le mariage temporel, contre une société hypocrite qui accuse la femme d’être responsable de tout ce qu’il lui arrive.
Vu l’ampleur du traumatisme qu’a vécu la narratrice suite à son viol, elle devient amnésique et ne relate cette expérience qu’indirectementpar le biais de cauchemars qui grignotent ses nuits et ne la laissent plus dormir. Certes la mère soutient sa fille mais par peur de se faire répudiée, ses sœurs par solidarité. Mais son frère, sa belle sœur et son père la culpabilisent et estiment qu’elle faisait des escapades.
Les agresseurs ne sont nommés qu’indirectement par l’emploi des pronoms « ils, eux, les autres » ou des substantifs « les ravisseurs, les intra- terrestres, les hommes-femmes-les »
Ces dénominations expriment implicitement la condamnation de l’auteur puisque « dénominer, c’est choisir au sein d’un paradigme dénominatif ; c’est faire « tomber sous le sens », c’est orienter une certaine analytique l’objet référentielle »9
Les passages relatifs au viol ne sont qu’une vue fragmentaire, que quelques souvenirs qui ont ressurgis de la mémoire de la narratrice.
Les paroles des personnages se veulent une confrontation des discours idéologiques « un point de vue contre un point de vue »10.
- Hommes sans visages déclamant des textes d’eux seulement connus. p.15
- Réflexion faite, je ne me voilerais pas. p.132
- Faites-vous belles, les filles. Sortez, bravez les séismes et les volcans. La vie est trop courte p.162
En opposant ces discours, les personnages féminins bravent ces « criminels qui veulent mettre le pays en coupe réglée au nom d’un Islam dénaturé par le vol, le viol et la violence »11
Elle se positionne aussi dans l’imaginaire maghrébin en orientant des fragments du discours des personnages sur les djinns mais aussi la magie, qui d’après Dujardin constitue des « stratégies de résistance » qui « asservissent l’homme à la volonté de la femme »12
La langue joue un rôle dans le positionnement de l’auteur « Le travail d’écriture consiste toujours à transformer sa langue en langue étrangère, à convoquer une autre langue, langue autre, langue de l’autre, autre langue. On joue toujours de l’écart, de la non-coïncidence, du clivage13 »
Leila Marouane écrit dans une langue qui n’est pas sa langue maternelle. Elle utilise trois langues dans son roman. Autre la langue française : langue de l’écriture, sont utilisées la langue anglaise ou la langue de Shakespeare comme elle aime l’appelée, la langue allemande et la langue arabe. Ses langues coexistent pour souligner la richesse linguistique signifiant l’exil qui a arraché l’auteur à sa langue maternelle.
La narratrice utilise un français soutenu, les personnages autant mais parfois utilise un langage familier proche de l’oral (omission de négation, syntaxe, intonation.. ou le dialecte lors des dispute.
L’auteure nous dévoile dans un style métaphorique, les évènements qui ont secoué la société algérienne ; elle ne manque pas de dévoiler la crainte et la peur des citoyens.
Les personnages partagent un destin tragique, ils sont marqués par cette violence qui traverse la société à laquelle ils appartiennent. Ils ne sont pas seulement atteints d’une violence physique mais aussi morale. Néanmoins, chacun résiste et brave les dangers à sa manière. Il est donc question de violence exercée sur des gens sans défense.
Il s’agit par le biais du discours humoristique, d’éveiller l’intérêt du public sans sacrifier son plaisir. Il entreprend les défauts, les erreurs humaines ou les valeurs morales ou esthétiques.
CONCLUSION GENERALE
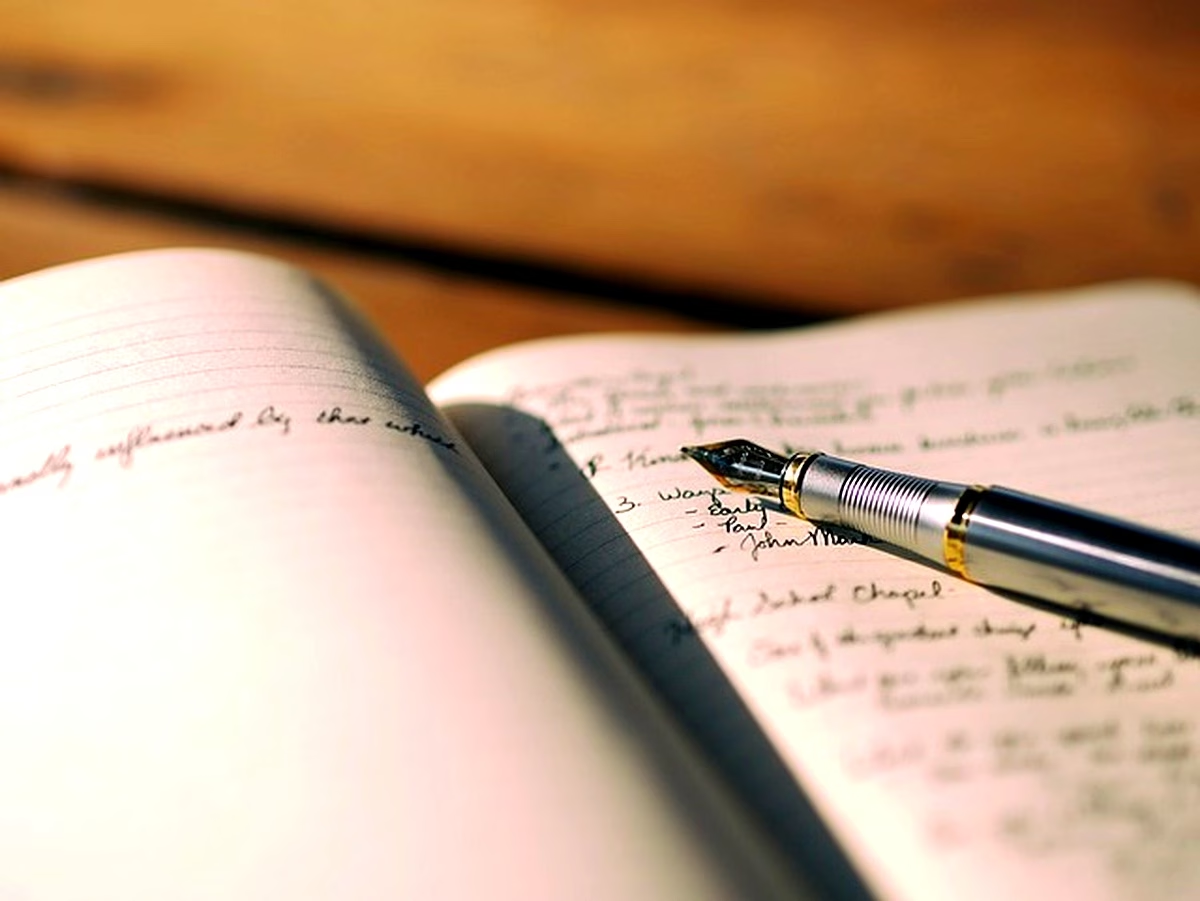
Ravisseur reprend une histoire répandue dans la société algérienne, celle de la répudiation de la mère. Cette histoire prend une tournure tragique et renverse toutes les normes éthiques, sociales et logiques.
Le procédé de dénonciation consiste à se servir du drame vécu par une femme pour le généraliser. Dès lors l’écriture procède à une
généralisation du phénomène et sa banalisation. Dans l’écriture, le regard témoigne d’une relation dysphorique avec le monde, signe d’insatisfaction qui fait écrire. Elle est une mise à nu de travers remarqués, dénoncés et ridiculisés.
L’auteur peint la détresse d’une femme et sa douleur lorsqu’elle est placée sans préavis devant une décision qui la prend de court et contre laquelle ne peut rien.
La narration qui gouverne Ravisseur se sert de procédés divers et se focalise sur le rôle d’une narratrice homodiégétique présentant à sa manière les actions et les évènements et partageant sa voix avec d’autres personnages.
D’ailleurs cette narratrice placée sous le signe du délire court le risque de rendre sa narration sans conséquence. Elle perd sa crédibilité, la vivacité de son témoignage est mise en doute. Cette conscience pourrait livrer des élucubrations sans fondement. D’où la nécessité de recourir à des voix multiples pour relater les différents évènements.
Le premier chapitre de ce travail s’efforçait à répondre aux questions du domaine de la poétique. Nous avons étudié l’insertion du dialogue dans le discours et les effets de ruptures et de rythme qu’il introduit dans le récit, la manière dont la narratrice présente les propos des personnages.
Le deuxième chapitre, faisant appel à la linguistique et lapragmatique, nous a permis de mettre en lumière les relations qui s’installent entre les personnages et les rapports qui régissent leur échange puisque c’est à travers ces relations qui s’y nouent que l’auteur s’inscrit pour glisser ses idées et véhiculer son idéologie.
Le troisième chapitre, nous a amené à cerner les différentes formes du discours tragique qui peuvent se traduire dans une œuvre littéraire, et les moyens utilisés pour instaurer un rempart contre ce discours tragique. Ce chapitre se voulait une analyse pour montrer comment se fait l’inscription du discours tragique dans l’œuvre de Leila Marouane. Et surtout comment écrit-elle et décrit-elle le tragique d’une famille déchirée et désunie qui traduit à l’échelle réduite une société en crise.
Leila Marouane n’écrit pas l’horreur dans son intégralité. Son écriture se caractérise d’une part par le non-dit exprimé par le flou, le vague et l’imprécision, et d’autre part par la stylisation de la violence et du tragique.
Nous avons essayé de décrire, définir et dégager les caractéristiques du discours humoristique à travers deux formes humoristiques indissociables à savoir l’humour et l’ironie.
Le parcours que nous avons réalisé à l’intérieur du récit de Leila Marouane, nous amène à dire que, le dialogue dans son roman a une fonction de structuration de la trame narrative.
Nous sommes aussi arrivé aux constations suivantes :
En premier lieu, au niveau de l’insertion du dialogue dans Ravisseur, l’auteur note avec précision les accompagnements paraverbaux et non verbaux des dialogues, rapprochant ainsi les dialogues de la réalité. Dans chaque dialogue, interviennent successivement des actes verbaux, non verbaux et paraverbaux qui rendent compte des émotions des personnages.Ce sont là des éléments qui s’imbriquent pour transmettre un maximum d’information au lecteur, étant le récit construit sur cette forme.
L’auteur recourt à toutes les catégories de dialogues pour créer des variations de rythme, vu le nombre important de dialogues insérés, et qui pourraient ennuyer le lecteur.
Les dialogues insérés sont de deux types : des dialogues analyseurs et des dialogues catalyseurs. Les premiers sont le lieu de discussions des personnages, leur fonction est phatique ; les seconds font progresser l’action et correspondent à la fonction dramatique et émotive.
En second lieu, la construction des dialogues et l’enchaînement des répliques font apparaître les relations qui se nouent entre les personnages qui se modifient et évoluent au cours d’un dialogue. Ces relations interpersonnelles permettent la compréhension de l’intrigue. Ils rendent compte de la vérité des relations qui lient les membres d’une famille et se penchent sur les relations époux/ épouse – père/enfants – fille/garçon.
Les protagonistes de la conversation peuvent être caractérisés par le biais de la politesse et de l’émotion. Le père est la figure de la colère, Samira de la douleur et la peur. Le langage des émotions relève à la fois du verbal et du non verbal. Elles se manifestent par des indices corporels, intonations, mimiques, gestuelles et ou par des indices linguistiques
En dernier lieu, le dialogue se trouve le moyen par excellence pour véhiculer l’idéologie sous forme de paroles des personnages. L’auteur montre une situation tragique à travers les dialogues des personnages plutôt que de la dire dans un récit pris en charge par une narratrice délirante.
Dans Ravisseur, les dialoguespermettent aux personnages de communiquer pour sortir de l’angoisse. Qu’il s’agisse de l’ordre, de la requête ou de la demande, l’acte de prendre la parole est justifiée par une nécessité d’agir et de faire réagir tant le dialogue est une énonciation à l’intérieur d’un discours adressé par l’auteur au lecteur. Il est le lieu de la diffusion de l’information.
Dans le dialogue romanesque chez Marouane, il suffit de prendre une séquence dialogique pour effectuer un travail sur la construction du dialogue, l’enchainement des répliques, les relations interpersonnelles, les rapports de base, l’expression de l’émotion et de la politesse. Cette richesse est une caractéristique fondamentale dans l’écriture des dialogues chez Marouane.
Leila Marouane traite avec gaieté d’imagination une matière sérieuse et pour instaurer une multiplicité de voix féminines.Elle choisit dès le départ une narratrice amnésique, puis délirante et folle justifiant ainsi le choix de laisser les personnages s’exprimer directement trouvant un espace de parole mais aussi d’écoute.
Le dialogue a permis à l’auteur de présenter les vices et les erreurs de l’homme ou de la société de façon détournée. Il s’agit d’abord de rejeter les attitudes extrêmes, pour ensuite promouvoir la nécessité de la construction d’une famille voir d’une société honnête qui bannit l’hypocrisie et toute sorte d’extrémisme et d’oppression.
Leila Marouane mène un combat par les mots et l’imagination : « Exercice de style » voilà comment elle qualifie son deuxième roman.
________________________
1 Maingueneau Dominique. Le discours littéraire. Op. cit. p. 127 ↑
2 Ducrot Oswald. « Dire et ne pas dire » inSemen n° 17, Argumentation et prise de position : pratiques discursives, 2004, [En ligne], mis en ligne le 29 avril 2007. URL : http://semen.revues.org ↑
3 Kerbrat Orecchioni. L’énonciation de la subjectivité dans le langage. Paris : Armand Colin. 1980. p. 171 ↑
4 Maingueneau Dominique. Les termes clés de l’analyse du discours. Paris : Seuil. 1996. p. 22 ↑
5 Boualit Farida. la littérature des années 1990: témoigner d’une tragédie ? In Charles Bonn- Farida Boualit, paysages algériens des années 1990, témoigner d’une tragédie ? Paris 1999, p.38. ↑
6 Grenaud Pierre. Algérie brillante d’hier. Amère Algérie d’aujourd’hui. Paris : Harmattan. 2006. p.198 ↑
7 Entretien inédit avec Leila Marouane, réalisé par Birgit Mertz-Baumgartner le 15 janvier 2000, Birgit Mertz-Baumgartner, La violence et son contrepoids esthétique dans Ravisseur de Leila Marouane, in Subversion du réel : Stratégies esthétiques dans la littérature algérienne contemporaine, études littéraires maghrébines n°16, L’Harmattan, Paris, 2001. ↑
8 Cité par Goldenstein Jean-Pierre dans Lire le roman,Bruxelles, De Boeck et Larcier, 1999, p.85 ↑
9 ↑
10 Arnaud Jacqueline.La littérature Maghrébine de langue Franceise. Punlisud, 1986. P. 161 ↑
11 Pierre Grenaud, op. cit., p198 ↑
12 Lacoste Camille Dujardin. Op. cit. p.200 ↑
13 Régine Robbin. « La brume-langue ». Le gré des langues, n°4. 1992. p. 132 ↑