Le délire et la folie dans Ravisseur de Leila Marouane révèlent une représentation tragique de l’enfermement, illustrant l’échec des actions et la lutte contre l’aliénation. Cette analyse discursive met en lumière la fonction essentielle des dialogues dans la progression narrative et l’expression des idéologies.
III. 1. 2. LE DELIRE ET LA FOLIE
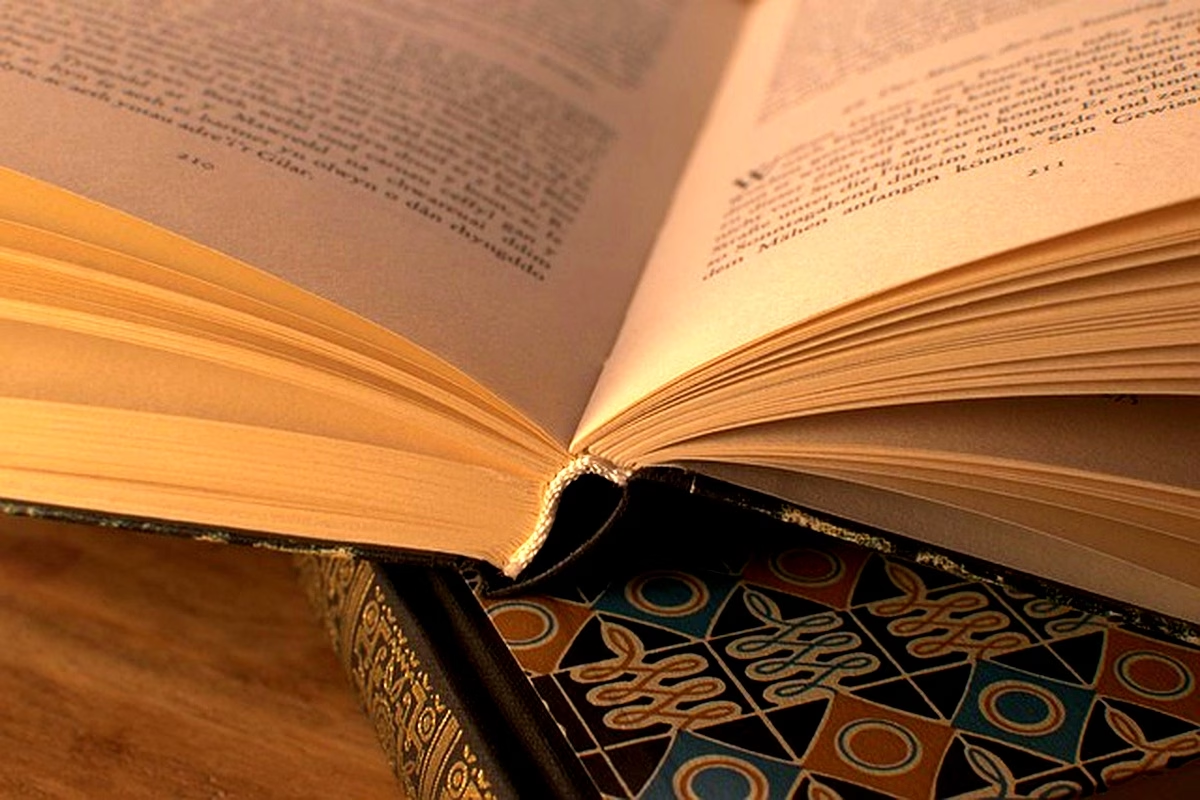
La folie dans la société se déploie dans le registre du tragique. Elle est localisée dans les lieux clos et est circonscrite dans un espace régi par le principe d’enfermement1. Elle témoigne d’une impossible action ou d’une action illusoire. La folie est placée donc sous le signe de l’échec et ne fait que traduire la tentative de résister et de contester.
Quant au délire, il est un signifié qui englobe la notion de folie, ses symptômes ou manifestations. La folie constitue un aspect du délire qui n’est pas seulement un trouble mental mais aussi une sensation désagréable ou un malaise. Il est défini ainsi par le Larousse: « trouble psychique caractérisé par des idées sans rapport manifeste avec la réalité ou le bon ses et entraînant la conviction du sujet »2L’individu qui aspire à conserver sa manière de penser, de se conduire, y trouve refuge.
Certes le délirant domine la situation par l’esprit, il devine les manigances de l’autre mais demeure incapable de concrétiser la lutte ou même l’organiser.
Néanmoins, le personnage délirant n’est pas nécessairement fou et, en ce sens, le délire recouvre certes la folie mais peut aussi être déterminé par d’autres facteurs; être engendré par d’autres phénomènes intérieurs ou extérieurs à la conscience du délirant tels que l’angoisse, les agressions physiques et le désarroi croissant.
Le délire est lié dans Ravisseur à la production des discours, alors que la folie apparaît dans le comportement et traduit un état pathologique dont le personnagen’a pas conscience.
L’auteure fait du délire un élément structurant du texte. L’onirisme, le cauchemar, les hallucinations traversent tout le récit.
Dans Ravisseur nous parlerons de la dichotomie terminologique Délire/Folie. Leila Marouane réserve le mot folie et les mots de sa famille pour diagnostiquer le mal dont sont atteints ses personnages.Les personnages principaux sont présentés comme des personnages fous ou délirants. C’est par ce commentaire que la narratrice clôt son dialogue avec Khadidja
- Dieu est juste, je vais prier pour qu’Il ait pitié de mon mari et de l’âme de ton enfant.
Je la regardai monter l’escalier d’un pas d’outre-tombe. Que répondre au délire ? Qui de nous deux déjantait ? Quelle que soit la réponse, c’est ce jour-là que la folie fit son réelle apparition chez nous. (p. 76)
Puis, elle en fait part à ses sœurs
- Khadidja est en train de perdre la raison. Dis-je. p.77
- Elle est folle, Khadidja a perdu la tête. Prier pour l’âme de mon enfant, je n’en reviens pas, répétai-je, cherchant en vain une cohérence dans les propos de ma belle-sœur. p.78
Le personnage fou est atteint d’une maladie chronique et incurable. Alors que le délirant souffre d’un mal ponctuel, et d’un dérèglement psychologique qui se manifeste temporairement.Aziz Zeitoun sombre dans le délire, les propos de ses filles laissent à entendre que cet état dégradé est définitif
- Il (Aziz) a complètement perdu la raison. p.100
- En tout cas, papa est devenu fou. Vraiment fou. Dans le quartier, les gens ne parlent plus que de ça, dit Fouzia. (p. 123)
- Papa n’est plus papa, dit Yasmina. p.166
- Mis à part l’hôpital, je ne vois rien d’autre. […]
- On ne va comme même pas l’interner, dit Yasmina. Après ce qu’il a subi ! p.167
Quant à Samira, le délire se manifeste après la violence physique qu’elle a subi.
- Nous avons bien conscience de ce que tu as enduré et de ce que tu continues d’endurer, commença Yasmina. p.168
- Nous allons faire venir un médecin. p.169
Il faut souligner que dans Ravisseur, il s’agit d’une évolution progressive du délire à la folie.L’état psychique de Samira comme celui de son père débute par un délire verbal pour atteindre une folie exprimée dans le comportement
Le personnage en proie au délire produit un discours qu’il faut interpréter par rapport aux autres discours existants.
- Je me consumais de remords : que dire à la prude et voilée Khadidja, la vraie Khadidja lorsqu’elle reviendrait chercher son fils ? p.163
- Je regardai ma belle-sœur. Elle ne ressemblait plus du tout à l’amie qu’elle avait été avant de rentrer dans notre famille. Tout d’un coup, je me demandai si Khadidja était bien Khadidja. (p. 162)
La folie dans Ravisseur indique un déséquilibre de la raison. Elle traduit un sentiment de colère contre soi même. Car elle correspond à une impuissance à prendre en main son destin. La folie est alors le dernier refuge.
Après que l’état psychique du père s’est aggravé, il prend sa fille aînée pour sa tante.
- Ma t ante !
Abandonnant son bâton de pèlerin, claudiquant, fonça sur moi.
- J’ai tout de suite vu que c’était toi ! ô ma tante ! Quel bonheur de te revoir !
Puis se jeta à mon cou et le trempa de larmes. Ça dura une éternité.
- Il a complètement perdu la raison, dit Amina
- Il faut faire quelque chose, dit Yasmina
- Papa n’est pas papa, m’écriai-je
- Mais c’est ce que nous disions, dit Yasmina. Papa n’est pas papa. (p.166)
Elle continua de m’appeler ô ma tante.
- Ma tante tu vas guérir. Tu ne vas pas me faire le coup de la dernière fois, dit-elle à chaque visite. Tu vas guérir. Te relever. Prendre soin de moi.(p.192)
Dans ce sens, le délire est lié à la production d’un discours alors que la folie met terme à l’existence des personnages comme le comportement d’Aziz qui « enfilait une robe (de son épouse), rasait de près sa moustache. (p. 177) »
Samira au fur et à mesure de sa rencontre avec son passé et les phénomènes blessants, finit par sombrer dans un monde guidé par son imaginaire proche de la folie. Une sorte de paranoïa, la gagne et la pousse aux extrêmes. Elle prend son père pour une femme djinnia et l’appela « Djidji ».
- Oui, Djidji, tout ce que tu voudras. (p. 151)
- L’imam ou le curé le fera disparaître pour de bon , vu qu’elle commence à se décomposer. Sinon elle renaîtra sous une autre forme et elle nous remettra ça.
- J’ajoute :
- Les djinns, c’est comme les sphinx. Ne l’oubliez jamais. (p. 183)
Elle pense aussi que le retour de sa mère et son mari, son frère et belle sœur, n’est qu’un mensonge préparé par ses sœurs. Elle les considère comme des étrangers
Elles ont donc fait passer une des femmes pour notre mère, l’autre pour ma belle-sœur, un des hommes pour le mari de ma mère, le deuxième pour Omar. Notre soi-disant mère (p 190)
La folie est alors la conséquence des traumatismes infligés aux personnages. La torture et la violence physique sont donc les causes principales de la folie.
L’auteure développe aussi le thème du rêve. Il est un élément ordinaire de la vie psychique. Il permet de revenir sur le passé pour dire comment tout a commencé.
Les souvenirs, jaillissent en hallucinations foudroyantes, en cauchemars terrifiants qui ne laissent aucun répit à la conscience tourmentée de la narratrice. Ces délires sont en accord avec les traumatismes subis.
Le passé de Samira ressurgit par les évènements du présent. Ainsi l’idée du présent ne prend que la forme du passé. Subitement se dévoilent les éléments de son passé, de son viol qu’elle a oublié. C’est à travers un rêve que la narratrice raconte son enlèvement par des « ravisseurs ». Son histoire est délirante, elle parle d’un homme qui ressemble à son père, d’une fille qui était-elle.
Dans un miroir déformant, une fille en blouse blanche, qui me ressemble à s’y méprendre, dit à un homme, le portrait craché d’Aziz Zeitoun, mon père :
- Je n’y suis pour rien….nous avons été enlevées à la sortie de l’hôpital.
La réplique de mon père, sourcils froncés, lèvres pincées :
- Et que vous ont-ils fait, ces ravisseurs ?
- Ils nous ont logées au Triangle….
Mais l’homme s’énerve Il la coupe :
- A part ça, que vous ont-ils fait ? Parce que de demande de rançon, je n’en ai pas eu vent et, de toute façon, je ne l’aurais point payée.
- Ils ne voulaient pas d’argent.
Il tonne :
- Que vous ont-ils fait ?
- Ils ont violé certaines d’entre nous et égorgée les autres.
- Mais à toi ! qu’ont-ils fait, à toi, la soi-disant infirmière au service des faibles ?
- Ils m’ont égorgée, répond alors la jeune fille.
Sans ciller.
L’homme se détend. Il applaudit longuement ; un frémissement de fierté enjolive sa moustache. Tout à coup, voilà qu’il se crispe. L’œil incrédule, le visage fermé, il observe avec ahurissement le ventre de la fille qui grossit de façon surprenante. (p. 79)
Elle se lance dans une narration qui confond son père à un autre homme, elle- même à une autre fille, alors qu’il s’agit de sa propre histoire.
« La réplique de mon père », « Mais l’homme », « s’énerve ».
« Répond la jeune fille », «je voulus aussi regarder à l’intérieur de ce ventre qui n’en finissait pas de s’arrondir.» p.79-80 Puis les détails de ce viol sont livrés à travers un cauchemar vécu quotidiennement par la narratrice.
Lorsque je détournai le regard de cette abominable transfiguration, elle se mettait à déclamer dans un idiome bizarre. Je reconnaissais peu à peu les versets coraniques récités aux enfants pour les apaiser après le cauchemar. Alors qu’un sentiment de sécurité me gagnait, la femme commençait à débiter l’Ouverture du Livre. D’un trait et à l’envers.
Sa cérémonie achevée, elle se jetait sur moi, écrasait ses lèvres sur les miennes, fourrageait dans ma bouche avec sa longue, me serrait étroitement, immobilisant mes membres. C’est alors que je sentais plaquée contre mon bas-ventre la dureté d’un pénis, de la longueur d’une matraque. Mes hurlements ne parviennent qu’à irriter, si je puis dire, la femme-homme, à redoubler ses âpres gémissements et elle me pénétrait avec une force de géant.
1orsque je frôlais l’évanouissement, elle se retirait, hirsute, essoufflée. Puis d’autres hommes femmes, identiques à la première prenaient la relève. A tour de rôle et ab irato. (p.134)
Cette lutte contre ces souvenirs atroces mènera la narratrice aux hallucinations. Elle invente une histoire de djinn, un vieux sage lui rend visite tous les soirs, elle discourt durant des heures. Lorsqu’il disparaît (de son imagination), elle s’enfonce de plus en plus dans la folie en affirmantque c’était une djinnia, l’amante d’Allouchi venue se venger d’elle.
Il se tenait les bras croisés sur sa barbe, le buste droit, ses épaules témoignaient d’une souplesse inhumaine. Il sourit
Que dis-je ?
Qui l’envoyait ? Pourquoi était-il ici ?
(Je ne posai pas de question : j’avais le sentiment de connaître les réponses.) De quelle contrée venait-il ? (p.138)
A mi-chemin, la lumière revint et mon compagnon de nuit n’était plus là.
Je sus tout de suite qui il était. Il était la djinnia déguisée en vieux sage, d’où cette absence de rides. Me confondant avec ma mère, à cause du patchouli, peut-être, elle me prenait pour sa rivale et elle était venue se venger de moi. Démasquée, elle disparaissait. Mais je la soupçonnai de vouloir revenir. Sous quelle forme cette fois ? je n’en savais rien. De toute façon, je la reconnaîtrais et je ne la manquerais pas. (p. 150)
Ses rêves et cauchemars, ses histoires de djinns (le sage et le père unijambiste) ne sont qu’une pure imagination due à l’état psychique de la narratrice ayant souffert et vécu des traumatismes violents.
- Nous avons bien conscience de ce que tu as enduré et de ce que tu continues d’endurer ; commença Yasmina. p.168
Dormir signifiait pour Samira la peur et l’angoisse, puisqu’il il s’agit de rencontrer les êtres effrayants qui l’ont terrorisées, et continuent de le faire dans ses rêves.
- Je lutte en vain contre le souvenir de ces rêves ; mes esprits en demeuraient brouillés, mon corps vidé. Les nuits commencèrent alors à grignoter mes jours et finirent par les dévorer. (p.134)
- Plus question désormais de dormir, de rencontrer ces êtres ceux qui maintenant traversaient mes nuits étaient d’une autre trempe. Ils étaient plus sinistres que le sordide […] abolir le sommeil, seule façon de leur échapper. p.135
Les traitements de son père, ses interdits, ses censures, sa loi avaient refoulé au fond d’elle les horreurs de ce monde.
Mon sommeil se peuplait de visions d’épouvante ; du tréfonds de mon subconscient, surgissaient d’écœurants, de révulsant personnages. p.133
Elle résume à ses petites sœurs toutes ces histoires dont elle a la conviction du réel
Je raconte tout : les visites du vrai faux sage, sa soudaine disparition suivie de l’arrivée immédiate de l’unijambiste, ses confidences, la soi- disant émasculation. Khadidja qui n’est pas Khadidja. Tout, même les femmes- hommes. (p.182-183)
Le discours délirant et le comportement bizarre de la sœur aînéeobligent ses sœurs à engager une infirmière pour s’occuper d’elle. .
Mes sœurs ont engagé une femme pour s’occuper de moi. [..] La femme qui s’occupe de moi est très bien: discrète, souriante, juste ce qu’il faut, toujours de blanc vêtue, mais elle parle peu ou bien seulement le français. D’ailleurs, elle ressemble aux femmes de la télé. p.189
Le délire, la folie et les traumatismes subis par Samira sont résumés ainsi par ses sœurs
- La fièvre ne la quitte plus… plus…plus….
- Elle délire…ire…ire
- Elle parle seule….eule…eule…
- Parfois comme si elle s’adressait à quelqu’un. .. elqu’un….elqu’un…
- Elle appelle notre père Djidji, …
- DJINNIAAA ! DJINNIAAA ! DJINNIAAA !
- Elle se méfie de lui…Dji…Dji…
- Un peu normal, après ce qu’il lui a fait….
- ACCIDENT ! ACCIDENT ! (p.171)
La folie de la narratrice est définitive. Elle passe du délire qui se manifeste temporairement à une folie qui met fin à son existence et à sa raison.
L’homme qui me piquait les fesses cessa de venir. Un autre l’avait remplacé mais espaçait ses visites. Il était plus bavard que le premier ; il posait
des questions sur tout ; il voulait connaître mes rêves, mes peurs, mes désirs aussi… Il se prenait pour Freud ou pour le marabout le plus couru de la région. (p.176)
C’est Yasmina maintenant qui me donne les comprimés roses et blancs. (p.176)
La narratrice n’est pas consciente de sa folie. La mort de son père n’est pas prise au sérieux, elle croit s’être débarrassée d’une djinnia et attend le retour de son vrai père.
Les voisins croient que notre père était en tête du cortège. p.185
Et à la fin du roman lorsque ses sœurs lui annoncent qu’elles devront partir en Angleterre, sa réaction confirme son état de folie.
- Qui va accueillir papa ?
- Là-dessus, elles ne trouvent rien à répondre.
- Il faut toujours que je pense à tout, dis avant de me recoucher. (p. 188)
Des éléments pertinents affirment que la narratrice est presque folle et inconsciente de son état.D’une part, la description de sa chambre, nous laisse penser qu’il s’agit d’un hôpital psychiatrique.
Les murs de ma chambre sont blancs. Très blancs. En plus, ils ont posé des barreaux .Pourquoi des barreaux ? Ai-je protesté. Pourquoi des barreaux alors que les volcans ne rugissent plus ? Que la terre ne s‘ouvre plus. (p.188)
[…] du coup, je ne peux plus regarder la rue. Je n’entends plus les cris des enfants, du marchand ambulant, les chats du muezzin. Seulement les gémissements du vent quand vient la nuit. p.189
L’apparition de la couleur blanche qui est porteuse de sens tel que la mort et le deuil. Cette couche blanche qui l’entoure correspond dans une certaine mesure à la mort lente, mort intérieure par la solitude, mais aussi aux retrouvailles avec elle- même.
D’autre part, elle est isolée et s’enferme dans le silence.
Dés le lever du jour, je me mets devant ma fenêtre. .mes yeux cherchent la mer ruisselante des lueurs du matin mais ne la voient plus. Des heures durant, je me satisfais du mouvement de la rue. ( p.177)
La journée, c’est le silence. Ça m’aide à réfléchir. Je réfléchis beaucoup en regardant au bout du ciel. (p.189)
Mes sœurs et ma fille viennent moins souvent dans ma chambre. Elles ont compris que leur présence me dissipe. J’en perds la parole. (p.189)
.Enfermés dans leur logique délirante, le père croit que la mort de Samira résoudrait tous les problèmes et permettrait le retour de son épouse. De son côté Samira, lasse de lutter contre un père oppressant devient prisonnière d’une seule idée celle de faire disparaître son père. Samira ne pensait
qu’a l’élimination de ce père djinnia. Elle n’aspire plus que jamais à le voir mourir, se débarrasser de ce fardeau qu’est la présence de cette personne oppressante et étrangère chez eux. Mourir permet alors d’échapper à une souffrance partagée des personnes qui sombraient dans l’angoisse et la solitude.
Je verrais ça le moment venu. Pour l’heur, il s’agissait d’évacuer de nos murs la djinnia qui se faisait passer pour Aziz Zeitoun. Qui n’en démordait pas. […] qui voulait ma peau. (p.162)
Nous en étions à user des mêmes ruses, même dans la haine, le côtoiement engendre des ressemblances. (p.177)
Samira relate la mort de son père comme une fête « pour le dîner, il y eut du couscous au mouton.», et affiche son indifférence « les jumelles les faisaient sortir. Elles ne voulaient pas que je sois dérangée. Ces femmes ne me dérangeaient pas. Au contraire je voyais en elles de futures clientes.» p.183
Ravisseur tente de mettre en évidence une tentative de reconstitution d’un moi perturbé. Les personnages principaux sont empêtrés dans des conflits familiaux dont les répercussions sur leur sensibilité et leur psychique se révèlent dramatiques.
Le père pense que ses enfants sont ceux de Youssef Allouchi, que sa femme le trahissait. Délirant, torturé, le père devient fou, de même Samira violée, défigurée par son père devient folle.
La folie permet aux personnages principaux (Samira et son père) de retrouver paradoxalement la raison dans un univers de morts et de vivants sans le savoir. Les personnages vivent solitaires, « soliloquant comme dans les tragédies grecques. »
Dans Ravisseur la tragédie commence lorsqu’Aziz répudie sa femme et organise son remariage, et que Samira, étant l’aînée prend conscience de ses nouvelles responsabilités. La figure paternelle se situe au cœur du roman. Le père définit les règles de la société masculine et oppressive. La première apparition du père l’élève au rang de pivot de la structure familiale. Le tortionnaire connaît enfin l’humiliation, l’agression physique, la folie et la maladie.
Dans cet univers familial régi par le père ne s’établissent que des rapports de force. Les relations sont toutes fondées sur la brutalité et la répression. L’autorité paternelle se décline sur le mode de la violence physique et verbale à l’encontre des enfants et sa domination du père ne rencontre aucun obstacle. La parole répressive du patriarche voue celui-ci à remplir le rôle de représentant de l’insensible.. Toute affectivité
disparaît du comportement du père. Il remplit son rôle de géniteur qui bannit toute affection à l’égard de sa progéniture.
La structure familiale reproduit à l’échelle réduite, le modèle de la société. En tant que reflet original de la réalité sociale, le système romanesque est un instrument créé pour expliquer le réel et le maîtriser. La violence traverse profondément le récit, la répression et la menace sont constamment présentes dans Ravisseur. Cette violence constante plonge la famille et la société dans l’absurde et l’angoisse. Cette atmosphère catastrophique a de grandes conséquences. Elle mène à la déliquescence, au délire et à la folie. Dès lors, le retour à une vie normale ne peut se faire que par la mort de l’antagoniste responsable.
La folie entrevoit les prémices de la contestation. Pratiquer l’examen des dérèglements de conduite des personnages c’est accepter de prendre en considération un parallélisme entre l’état d’une société et de l’état de l’individu. La folie des personnages reflète l’état de crise d’une société.
A travers ce thème de la folie/délire, Ravisseur dénonce à la fois, l’arbitraire du système algérien (la pratique de la torture), et la violence patriarcale (les actes inconscients du père la répudiation).
Bien que ravisseur soit ancré dans la réalité, il laisse une grande place à l’imaginaire et dénonce le tragique par le biais de la métaphore, de l’humour et de l’ironie.
Ces procédés sont les meilleurs moyens pour une distanciation esthétique. Ce qui rejoint l’idée de Mohamed Kacimi qui souligne que « la littérature c’est d’abord l’écriture et l’évènement ensuite, non pas le contraire »3
Ainsi, parallèlement à ce discours tragique, est développé un discours humoristique qui rend ce vécu tragique supportable.
________________________
1 Cf thèse Hajos Katalin. Variations sur le thème de l’enfermement dans la littérature maghrébine d’expression française. Mémoire de master 2, sous la direction de Sylvie Ballestra-Puech, Université de Nice, Sophia Antipolis, 2005. (www.limag.fr) ↑
2 Dictionnaire Larousse, 2007, p. 343 ↑
3 Cité par Dumont Jacques, « Mohamed Kacimi : La nostalgie mise à mort », in Algérie littérature Action6, p12 ↑