Le croisement du discours tragique et humoristique dans ‘Ravisseur’ de Leila Marouane révèle une rupture avec les thèmes traditionnels de la littérature algérienne. Cette analyse discursive met en lumière comment les dialogues structurent l’intrigue tout en questionnant les idéologies sociétales.
Chapitre 3 : Le croisement du discours tragique et du discours humoristique
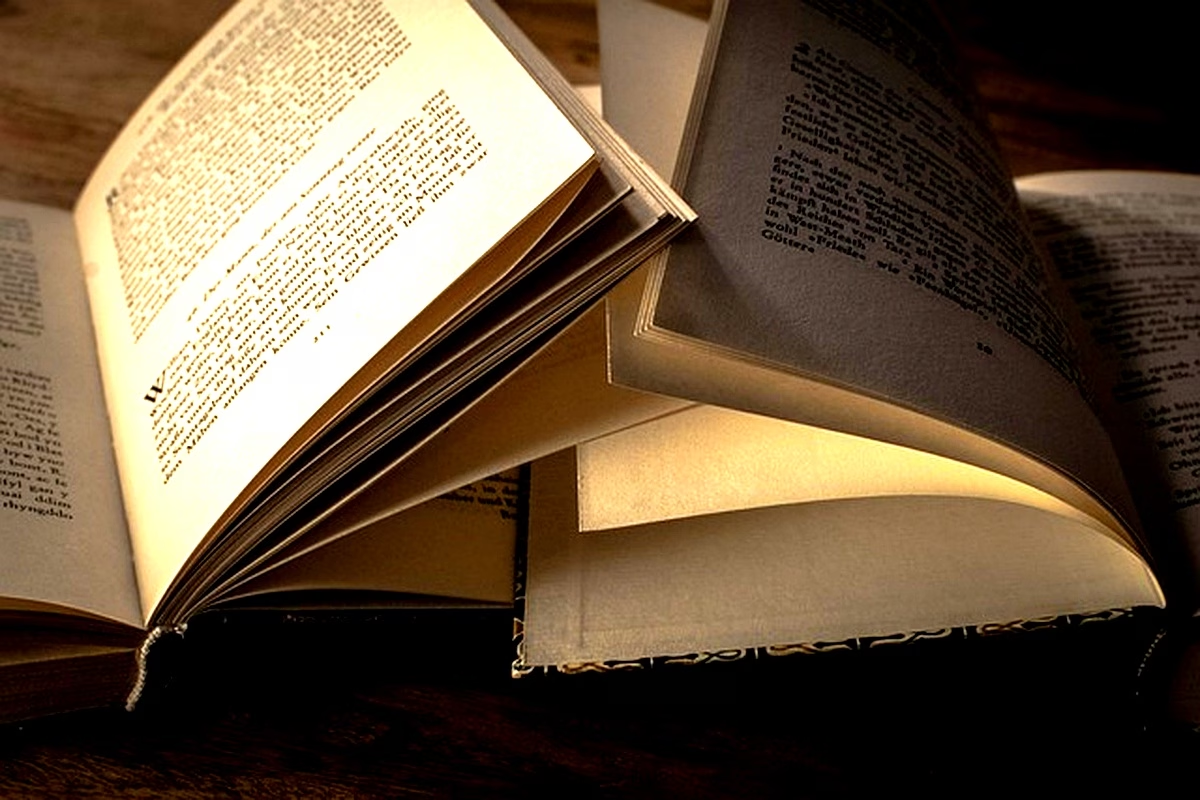
Introduction
Le roman de Leila Marouane est placé sous le signe de la rupture. Son œuvre arrive au moment où la production romanesque algérienne venait à s’essouffler dans une répétition des mêmes thèmes. (Les tueries et les massacres des années 90)
Leila Marouane dépasse le discours commun en multipliant les innovations. Son écriture explicite les structures contraignantes de la société, pour ensuite les bafouer et les tourner en dérision. Elle exhibe les mécanismes du système social, et dans le même temps, elle transgresse les normes admises et imposées.
Son originalité réside dans le croisement de deux discours. Son roman se situe entre tragique et humour. Bien que Ravisseur soit ancré dans la réalité, il laisse une grande place à l’imaginaire et dénonce le tragique par le biais de l’écriture métaphorique, humoristique et ironique. Ces procédés sont les meilleurs moyens pour une dénonciation esthétique.
En lisant Ravisseur, le lecteur bascule constamment du tragique à l’humour parce que les personnages pour tenter de dépasser les situations tragiques et angoissantes se moquent d’eux-mêmes.
Ces deux discours opposés sont présents dans chaque dialogue. Leur objectif est de dévoiler la réalité et de montrer les travers d’une société. Le discours des personnages se veut une forme d’esprit qui met en valeur avec drôlerie le caractère ridicule, insolite ou absurde de certains aspects de la réalité. Ainsi, ils se libèrent de l’angoisse qui les étreigne.
Dès lors, nous essaierons dans ce chapitre de cerner, d’une part le tragique dans Ravisseur, et d’autre part les stratégies de dédramatisation.
Le discours tragique se manifeste par une extrême tension. La crise, l’urgence et l’attente se combinent pour renforcer cette tension et où chaque décision, chaque action devient alors nécessaire et déterminante.
Le discours humoristique est un art de distanciation. Le réel est observé dans son immédiateté, puis il est l’objet d’une réflexion qui le met à distance et le juge. Le discours humoristique se divise en deux étapes. En premier lieu l’accumulation des horreurs. En second lieu la dénonciation des cruautés.
L’humour est une notion qui demeure indéfinissable. Breton affirme que «Le problème [Qu’est-ce que l’humour ?] restera posé.»1 Il révèle à la fois du tragique, du rire et de l’angoisse. Il n’obéit à aucun principe de structuration grammaticale ou sémantique. Il échappe à toute classification littéraire. Il peut être inoffensif ou tendancieux. Le dictionnaire Larousse définit l’humour comme une : «forme d’esprit qui cherche à mettre en valeur avec drôlerie le caractère ridicule, insolite ou absurde de certains aspects de la réalité.»
Le discours humoristique est donc un moyen efficace pour détendre l’atmosphère tendue. Freud avait constaté que le rire permet à l’homme de repousser la souffrance et d’échapper aux conditions malheureuses de la réalité qui l’entoure. Notons que le fondateur de la psychanalyse, va même jusqu’à en faire une devise « supporte et fais semblant de ne pas connaître les maux, qu’ils viennent de toi ou d’ailleurs»2
Dans le cadre d’une situation la plus tragique, plusieurs moyens sont utilisés pour y remédier ou pour montrer sa supériorité en se moquant de l’autre. Les personnages possèdent alors des stratégies discursives variées pour contrer les malheurs qu’ils vivent ou subissent
L’humour repose sur une distance prise à l’égard du sérieux de l’existence. C’est-à-dire dans le cadre le plus tragique de l’existence vient s’insérer une sorte d’espoir en permettant la mise à distance du caractère tragique de l’existence.
Dans ce chapitre, nous proposons d’étudier d’abord deux aspects du discours tragique à savoir la violence et la folie, puis nous aborderons deux formes du discours humoristique : l’humour et l’ironie, et enfin le positionnement idéologique de l’auteur.
Le discours tragique
I. La violence dans Ravisseur
Etymologiquement, le mot violence vient du latin « vis » qui signifie la force. La violence caractérise ce qui se manifeste avec une force intense, extrême et brutale.
Les dictionnaires définissent la violence comme un état, une force intense et destructrice. Elle est aussi un fait caractérisé par l’abus de force avec un caractère brutal pour contraindre quelqu’un contre sa volonté.
« Actes par lesquels s’expriment l’agressivité et la brutalité de l’homme dirigés contre ses semblables et leur causant des lésions ou des traumatismes plus ou moins graves »
Parmi les définitions proposées dans la littérature, nous trouvons celle de Michaud qui présente diverses situations dans lesquelles la violence peut s’exercer et les différentes atteintes qui en résultent.
« Il y a violence, quand, dans une situation d’interaction un ou plusieurs acteurs agissent de manière directe ou indirecte, massée ou distribuée, à des degrés variables, soit dans leur intégrité physique, soit dans leur intégrité morale, soit dans leurs possessions… »
Cette définition prend compte des trois formes de violences physique, symbolique et morale. En effet, la violence a pour but de détruire l’humain. Toute personne qui se sent niée, détruite, sidérée, par une attitude, une conduite, une parole provenant d’un individu, d’un groupe est soumise à un acte de violence.
Le concept de violence sociale implique une force dévastatrice et destructrice sans projet et d’autant plus difficile à contrôler qu’il n’y a rien à négocier.
Karli3 range la violence en deux axes :
- Le premier, celui des mobiles de l’action a trait au caractère utilitaire ou non utilitaire de l’acte d’agression
- Les agressions utilitaires qui visent à s’approprier un objet convoité, à satisfaire un désir
- Les agressions non utilitaires, à visée défensive, qui visent à mettre terme à une émotion douloureuse en agissant sur la situation intolérable qui l’engendre.
- Le second relatif au statut de la victime par rapport à l’auteur de l’agression
Dans le récit de Leila Marouane nous décelons deux types de violence : la violence de la famille et la violence du groupe social. En se basant sur les travaux de Timsit Berthier4, nous pouvons établir les catégories suivantes :
Crime utilitaire / Victime étrangère : c’est le cas du terrorisme
Crime non utilitaire / Victime proche : c’est le crime légitimé par la vengeance, l’humiliation, le sujet à l’impression d’être menacé : c’est le cas de la violence de famille
Crime non utilitaire / Victime étrangère : c’est le crime légitimé, le sujet à l’impression d’être menacé : c’est le cas de la torture.
________________________
1 Breton André. Anthologie de l’humour noir. Grasset, Coli. Biblio. 1984. p. l 2. ↑
2 Cité par Cazeneuve Jean dans sa communication, « L’Humour dans le sérieux ». Académie des Sciences Morales et Politiques. Paris. Séance du lundi 21 juin 1999. ↑
3 Karli, référence à préciser. ↑
4 Timsit Berthier, référence à préciser. ↑