Le discours direct dans Ravisseur de Leila Marouane révèle une structure dialoguée complexe, où les systèmes énonciatifs hétérogènes s’entrelacent. Cette analyse met en avant la fonction cruciale des dialogues dans l’évolution de l’intrigue et la représentation des idéologies au sein du récit.
I. 2.1.4. Le discours direct
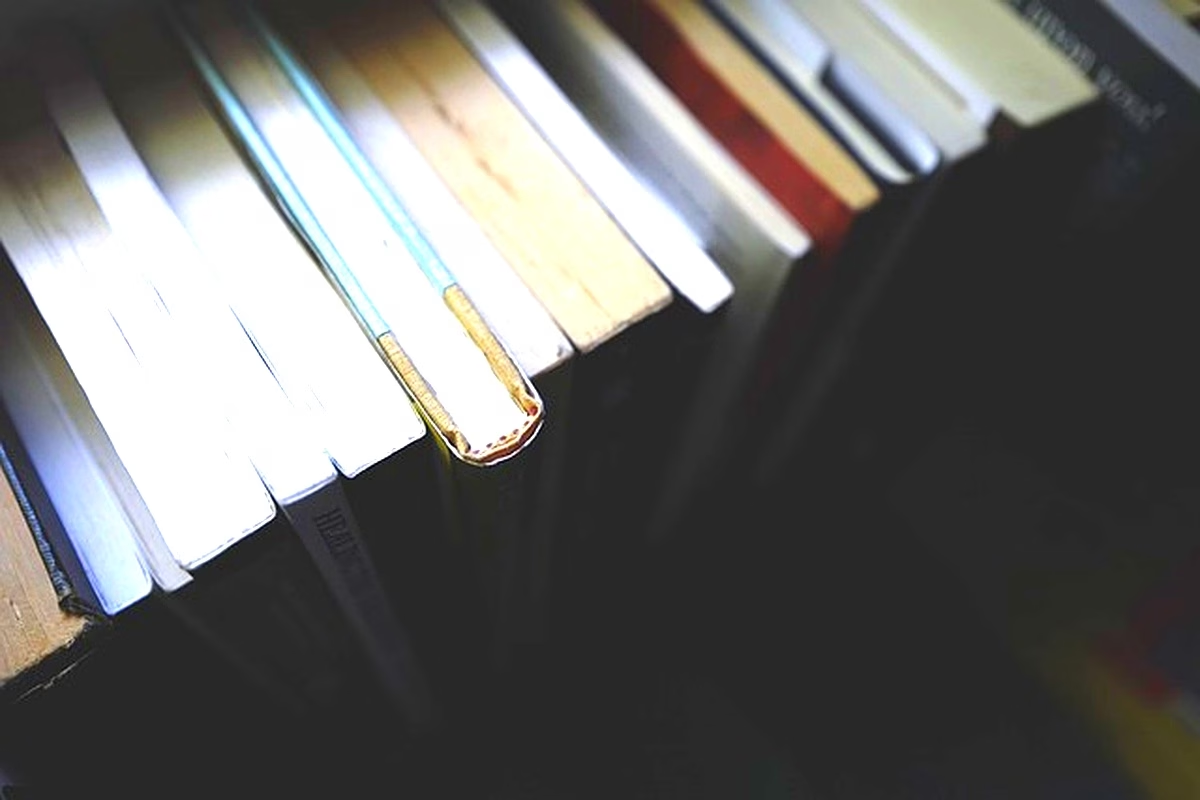
Nous avons jusque là, vu que l’auteur utilise les formes traditionnelles du discours rapportés, mais nous avons dès le début de ce travail signalé que le roman de Leila Marouane est une forme dialoguée qui se déploie sous le mode du discours direct. Le discours direct (mode de la citation) juxtapose deux systèmes énonciatifs hétérogènes.
Le changement d’espace énonciatif dans les dialogues insérés est explicite.Le passage de parole s’effectuant par tirets et incises, annonce que les propos cités n’ont pas le même statut que le reste du texte. L’emploi du discours direct implique un effet de mimésis.
La répartition des temps du discours direct et de la narration recouvre la séparation opérée par les linguistes entre deux groupes de temps verbaux. Benveniste oppose les temps du discours qui se rapporte au système déictique aux temps du récit. Les temps employés dans les dialogues sont ceux du discours.
Voici un exemple qui montre l’usage du discours direct chez Marouane :
Dans la faible lueur de la chambre, je distinguai à peine le visage de ma sœur et le rêve avait déjà rejoint les limbes de ma mémoire.
- Ça va ? dit-elle
- Oui.
- On s’est prises à trois pour te coucher pourtant tu es maigre comme un clou. A mon avis tu dois faire des chutes de tension, ou quelque chose comme ça, dit-elle. En tombant, tu as failli blesser Zanouba ; elle s’en est sortie avec une petite bosse sur le front.
- Et Omar ?
- Toujours pas rentré et papa est encore dans la salle de bains.
- Des nouvelles de la maison d’en face ?
- Il y a eu quelques secousses. Rien de grave, mais le quartier est dans le noir absolu : panne générale. On n’a même pas entendu la prière du soir. Seule notre maison est éclairée, et notre générateur commence à faiblir. En plus, il pleut des cordes.
- Appelons chez Allouchi, dis-je en quittant le lit.
- Le téléphone est coupé.
- Alors sortons, allons voir ce qui se passe chez lui.
- Tu n’y penses pas…
- Si, si, j’y pense.
- Et papa ? que fais-tu de papa ? et il faut que manges, tu n’as rien avalé de la journée. Tu vas retomber dans les pommes.
- De papa, je fais mon affaire et je mangerai plus tard. (p 80-81)
L’auteur n’utilise pas les guillemets pour introduire le discours dialogué. Les paroles des personnages sont introduites sans incises, créant l’illusion d’une conversation réelle, excepté dans la première réplique pour indiquer le locuteur qui ouvre l’échange, dans troisième réplique et dans la huitième réplique pour introduire un comportement non verbal, où nous avons un verbe introducteur(dire) utilisé 3fois.
La narratrice en tant que partenaire de la conversation s’efface et n’introduit aucun commentaire. Au plan thématique et enchaînement des répliques, ce dialogue, illustre déjà la déchéance de la famille Zeitoun et le renversement de position (Omar disparu, le père retiré, la mère disparue, l’état de santé de la narratrice se dégrade)
Nous observons, dans Ravisseur, une abondance de dialogue au style direct où, avant ou après chaque réplique, l’auteur indique au lecteur, dans un discours attributif, la manière dont les paroles sont prononcées, les gestes,le rythme, l’intonation (glapit, hurle, brusquement)
- Un colis de maman ! glapit-elle.
– […]
- Laissez ce paquet où il est, et éloignez-vous d’ici, dis-je brusquement. Allez dehors, dans le jardin, le plus loin possible. N’oubliez pas Zanouba. Yasmina dodeline de la tête. Elle est lasse.
- C’est moi qui ouvre ce paquet, dis-je. Puis j’explique
- Il est sûrement piégé.
- Il ne peut pas être piégé, rétorque Yasmina, il vient de maman. (p .178) L’expression de Yasmina révèle bien ce qu’elle pense de moi.
- Je ne suis pas folle.
- Ce colis ne peut être piégé, insiste Yasmina.
- On n’est jamais trop prudent, murmuré-je.
- S’il est piégé, tu sauteras avec, dit Amina. Je hurle :
- Ça ne te regarde pas !
- Et les mandats sont aussi piégés, eux aussi ? hurle à son tour Amina.
- Quels mandats ?
- Les mandats qui nous nourrissent, qui paient les médicaments et les médecins.
- Je ne suis au courant de rien dis-je.
- Il y a une perruque pour toi, dit Amina.
J’expire. J’ouvre les yeux. Je vois une tignasse rousse qui dépasse de sa boite.
- Tu veux l’essayer ? demande Yasmina.
- Je n’en veux pas, dis-je. C’est sûrement fabriqué avec les poils d’un caniche. D’ailleurs ça sent le chien. (p. 179) Puis
- Qui nous envoie des mandats ?
- Maman et Allouchi, voyons !
- A la place des décrets Crémieux ?
- Dans une des lettres, ils disent que c’est pour bientôt, dit Amina en farfouillant dans le paquet.
- Pour quand ?
- Ils ne précisent pas.
- Je savais que cette femme nous racontait des salades.
Je simule un bâillement. Mes sœurs quittent ma chambre. Elles n’oublient pas le paquet. (p. 180)
Ce dialogue laisse voir la psychologie des personnages : devant la méfiance et prudence de la narratrice, ses sœurs expriment une grande joie de recevoir un colis de leur mère.
Il est à préciser que Leila Marouane combine souvent les différents styles dans un même dialogue.Prenons cet exemple :
Elle m’embrassait sur le front, puis sur le dos de la main, murmurait d’interminables mercis, louait ses aïeux, bénissait les miens. Elle s’inquiétait de ma santé, me demandait plusieurs fois par jour la cause de ces horreurs sur ma pauvre tête.
Un accident, je répondais, laconique.
Alors elle répétait, fixant sa jambe de bois :
- Ah ! les accidents…D’où je viens, il n’arrive que ça, des accidents. Et c’est de loin que je reviens, vous pouvez me croire.
Mon manque d’appétit, en réalité, il n’y avait pas grand-chose à manger, semblait aussi la tourmenter…
- Il faut vous nourrir si vous voulez vous battre avec moi contre cette armada, disait-elle.
Puis me jugeant :
- Vous êtes bien maigre … c‘est parce que vous manquez de dents que vous ne mangez pas. C’est aussi un accident ?
- Sché auschi un acchident…
(…) Mais du matin au soir et jusqu’à épuisement, elle soutenait mordicus son appartenance à la famille des Zeitoun, s’en enorgueillissait, évoquait notre défunt et pieux grand-père, sa générosité, son sens de l’honneur, sa fortune acquise à la sueur de son front, ses dons aux pauvres…Puis revenait à la déchéance d’Aziz Zeitoun, aux trahisons et à ses dessins de vengeance.
- Je ne sais pas qui vous êtes, ni vous envoie, me disait-elle. Mais sans vous elles m’auraient déjà dépecée. Dès que je me remettrai, vous m’aiderez, n’est- ce pas ?
J’opinais.
– […] (p. 165-166)
Nous voyons ici l’utilisation de trois styles différents. D’abord le discours narrativisé survolant le discours du père. Puis le discoursdirect libre, pour marquer la réaction de la narratrice. Pour enchaîner au discours direct avec les interrogations et assertions du père. Pour reprendre
aussitôt, au narrativisé, puis au direct. Face au père qui monopolise la parole, la narratrice en est privée mais exerce un jugement sur son interlocuteur. Elle considère son père comme une démente venue se venger des enfants de Nayla, d’où l’emploi du pronom « elle » 9fois, du début à la fin du dialogue. En outre l’emploi de ce pronom, souligne d’ores et déjà l’état psychique de Samira qui sombre dans le délire mais également la folie du père qui pense s’adresser à sa tante.
Nous avons souligné dans le début de ce chapitre que les dialogues dans Ravisseur se répartissent en séquences, en échanges et en interventions.
Dans le cas de la séquence(dialogue long), des commentaires narratifs séparent les répliques. Leur fonction est d’apporter des informations supplémentaires ou d’introduire un discours intérieur.
À titre d’exemple le dialogue qui réunit Aziz et la veuve s’étend sur 4 pages, présente peu d’interruptions se résumant en un commentaire narratif de 9 lignes après la première réplique de la femme. A la vingtième réplique, un autre commentaire narratif est introduit pour décrire la posture de la femme. Puis à la 28 pour introduire un autre commentaire.
- Ah ! c’est vous, sidi… pardonnez-moi, je craignais… avec toutes ces secousses…vous savez…
Elle fit jouer des verrous, sauter des cadenas, nous ouvrit enfin et nous reçut comme on accueille l’affliction. La flamme de sa bougie en grelottait. Dans la pénombre de son unique pièce, ses enfants dormaient en enfilade sur des matelas jetés sur le sol. Une odeur de friture collait aux murs. Reniflant avec bruit, mon père fouilla la pièce du regard. Espérait-il trouver ma mère ici ? Mais elle n’y était pas. Non plus l’effluve de son tenace parfum.
- Alors, la veuve ? quelles sont les nouvelles ?
– […] (p. 87-88)
- On dit qu’Allouchi et Nayla…Eh bien, on dit que c’est une histoire qui ne date pas d’hier, qu’on les aurait souvent vus ensemble…Que ce qu’on croyait être l’œuvre de la djinnia n’est autre que celle de votre …enfin de…
Pour s’empêcher de prononcer le nom de ma mère, elle posa brusquement deux doigts sur sa bouche et une main sur sa poitrine, une façon de signifier, à elle-même plus qu’à nous, qu’elle l’avait échappé belle
– […] (p. 89)
- Personnellement, je les ai vus prendre un taxi, l’hiver dernier, je crois. Allouchi arrêtait le taxi, et elle paraissait très inquiète, mais ne se souciait pas de se cacher, comme si nous autres n’existions pas. J’ai mis du temps avant de la reconnaître. Ensuite je l’ai reconnue à ses cheveux, son voile glissait tout le temps, elle semblait avoir perdu l’habitude de s’en servir. Parfois, elle négligeait de le remettre.
- Je m’en doutais, marmonna mon père, l’air absorbé.
J’avais une vague idée de l’histoire du taxi, Omar aussi le savait, qui démêlerait ces méprises. Ce n’était qu’une question de temps et certainement pas ses affaires.
– […] (p. 90)
La première interruption explique d’une part, le temps mis par la femme pour répondre et ouvrir sa porte, et d’autre part, ouvre le dialogue en orientant les questions d’Aziz qui, après avoir fouillé, du regard la chambre, est sûr que Nayla n’y est pas. Le deuxième commentaire, peint un comportement non verbal de la femme terrorisée, qui n’ose pas prononcer le prénom de l’épouse d’Aziz. Dans le troisième commentaire, la narratrice veut élucider la scène du taxi, telle que relatée par la mère, et l’opposer au récit de la veuve.
Dans ce dialogue, nous remarquons l’absence de la narratrice. En tant que témoin, elle précise dans des commentaires les comportements non verbaux et paraverbaux des locuteurs.
Mais dans d’autres dialogues, l’auteur attache une importance aux commentaires qui jouent le rôle d’une pause narrative et ralentissent le dialogue.
Considérons cet exemple dans lequel la fonction des commentaires est de transcrire les comportements non verbaux et paraverbaux des locutrices qui jouent le rôle de réponses :
- C’est déjà les vacances ou est-ce qu’on entame sa petite carrière de romancière ? dis-je pour les mettre en confiance.
Noria et Fouzia hochent frénétiquement la tête. Elles ont les yeux rouges.
- Vous êtes malades, alors ? Une grippe ?
- Non, c’est papa qui est très malade. Il ne se lève plus. Il a du mal à respirer. Il y a plein de vers qui sortent de sa chair.
- Le docteur appelle scha des escharres.
Le papier peint de ma chambre gondole ; il se décolore ; les fleurs ne sont plus que des taches sans forme ; les tentures qui pendent à ma fenêtre me révulsent aussi. Je les remplacerai par d’autres que je borderai moi-même : elles seront de velours bleu orné de fil d’or et d’argent. J’enlèverai le papier des murs et les ferai peindre en blanc ivoire.
Fouzia réprime un sanglot.
- Des escarres, dit-elle.
- Pardon ?
Elles ne répondent pas. Elles se frottent les yeux et reniflent un peu. Bizarrement je ne me gargarise pas de ce premier pas vers la victoire. Il me faut attendre un peu.
- Vous pleurez ?
- Non…
- C’est qu’on a du chagrin.
Je ne veux pas qu’elles aient du chagrin. Je ne veux pas que ma famille ait de la peine. Elle a déjà eu son lot de souffrance. Suffit !
- Il ne faut pas, dis-je.
Alors elles éclatent franchement en sanglots. Leur dire la vérité les consolera. Tant pis si elles ne sont que des enfants. D’ailleurs, je trouve qu’elles mûrissent bien vite. Et puis les histoires de génies, surtout les mauvais, ne leur sont pas étrangères.
- Je vais vous confier un secret. (p. 180-181) Puis :
- Si vous acceptez mes conditions.
Elles cessent de pleurer.
- D’accord ?
Elles acquiescent. Mais le secret semble les laisser indifférentes. Croient-elles que je ne le dirai pas ? Ou alors appréhendent-elles les conditions ? J’attends un signe d’impatience qui ne vient pas. Aujourd’hui la soupe est très bonne. J’avale la dernière cuiller, racle le fond de l’assiette.
– […] (p. 182-183)
Dans cette séquence les coupures plus longues et plus nombreuses permettent de voir les stratégies déployées par la narratrice pour construire son discours et de voir les réactions paraverbales et non verbales de ses sœurs. L’enchaînement des répliques entrecoupées de commentaires illustrent le parcours que suit la narratrice pour atteindre son objectif (convaincre ses sœurs de l’aider.)
Nous voyons qu’après la quatrième réplique annonçant la maladie du père, la narratrice introduit un fragment narratif qui n’a aucune relation avec le discours de ses sœurs. Plus loin elle ignore aussi ce que réitère sa sœur concernant la maladie du père. La narratrice se montre indifférente lorsque ses sœurs évoquent la maladie du père, puisqu’elle le considère comme un étranger. Cela indique une absence d’écoute : la narratrice personnage désire que ses sœurs accomplissent sa requête et n’est pas prête à entendre ce qu’elles racontent.Ce qui constitue en effet le thème et l’objectif de ce dialogue amorcé avec ses sœurs.
Les autres commentaires qui fournissent des informations non verbales et paraverbales ont une valeur communicative et sont destiné au lecteur.
Dans le cas del’échange (nous les avons soulignés dans le cadre dialogique) les commentaires sont peu nombreux
(…) C’est alors qu’un papillon de nuit vint se poser sur son épaule. Son visage s’illumina et, de tout son corps, il se raidit.
- Hé, vous deux, siffla-t-il. Approchez. Dou-ce-ment. Noria et Fouzia obéirent, devinant la requête qui allait venir.
- Attrapez-le, chuchota-t-il. Attrapez ce papillon…dou-ce-ment. (p. 62)
Noria se mit alors à ânonner :
- Maman est schortie, maman est partie, gros schel pour le bébé, bébé a l’œil mauvais, fallait pas le peger.
- La ferme, dit Fouzia, la gorge nouée, mordillant une tartine beurrée dont elle n’avait visiblement plus envie.
- Ma schoeur est jalouge de mes fers, répliqua Noria, se levant de table et courant vers sa chambre. Elle fut bientôt suivie par Fouzia qui, libérant ses cordes vocales, cria :
- Ça va être de ma faute si le fils d’Omar attrape le mauvais œil ! ça va encore être de ma faute si maman a désobéi. De ma faute ! toujours de ma faute ! tu entends ? (p. 37)
Dans le premier échange, un seul locuteur parle, il s’agit donc d’une intervention et la réaction des interlocutrices se lit dans le commentaire narratif. Ces paroles sont des actes illocutoires (des ordres : utilisation de l’impératif, l’apostrophe, l’articulation)qui exercent une force perlocutoire (l’exécution de la requête). Le deuxième exemple, quatre actes illocutoires sont insérés, trois actes d’assertions et un acte d’autorité qui marquent un désaccord entre les deux sœurs.
Ces échanges retenus montrent bien le mécanisme d’élaboration du non-dit. L’auteur oriente les discours des personnages pour exprimer l’inquiétude et l’angoisse suite à la désobéissance de la mère.
Dans cet échange nous pouvons observer le type de relations qu’entretient le père avec ses filles. Une complicité éphémère se dessine entre le père et sa fille dont l’objectif est de consoler le père inquiet mais il décide aussitôt d’y mettre terme.
(…) Chez Youssef Allouchi, la fête était à son plein.
- Le traître, maugréa mon père.
- Ça ne veut rien dire, dis-je, esquivant les coups de pied de ma sœur.
Elle m’intimait de me taire, car était-ce bien la peine de communiquer avec un homme au bord de la crise de nerfs et qui plus est ne se livrant jamais à ses filles.
Portant la voix fluette, le roi Salomon ronronna :
- Tu crois ?
Au-dessus de nous, la lune s’arrondissait, rosissait, comme une femme enceinte, et souriait de la béatitude des anges.
- Ils font la fête pour écarter les soupçons, fis-je
- Bon, bon, fit mon père, mettant ainsi un terme à cette ébauche de complicité. (p.64) Il referma le balcon (…)
Mon père s’allongea sur le canapé, inerte comme la mort. Ma mère convolait. (p. 63-64)
L’échange reflète les relations entre Samira et sa mère.
Zanouba entama ses gazouillements. J’allai préparer un biberon et décidai de rester à la maison pour aider ma mère. Je le lui dis.
- Il n’en est pas question ! répliqua-t-elle en écartant les rideaux.
- Je peux sauter un cours…
- Tu as déjà loupé tes études d’infirmière, tu ne vas pas rater une malheureuse formation de dactylo, dit-elle.
Puis sur un ton d’une antienne :
- A ce rythme, tu ne travailleras jamais et les temps sont durs. Ton père ne va pas toujours vous nourrir… (p. 30)
La narratrice reproche à sa mère son manque d’affection et l’absence d’émotion lorsqu’elle lui reproche ses échecs. L’échange bref se limite à deux interlocuteurs relatant en peu de mots une situation tendue et mettant en lumière les relations interpersonnelles.
L’auteur choisit parfois de rapporter au discours direct une seule phrase d’un échange. Ces répliques isolées «prétendument détachées du contexte conversationnel elles constituent un élément de preuve irrécusable des dires du narrateur. »1. Sylvie Durrer parle aussi de « sa fonction prémonitoire et son rôle dans la description d’un personnage »2. Cette réplique isolée concentre en quelques mots une façon de penser, ou un regard porté sur une situation.
Au début du roman, c’est avec ces quelques mots qu’Allouchi répond aux questions indiscrètes. Quelques mots qui cachent un non-dit « Les obligations du travail, vous savez…»(p. 14)
Cette réplique placée en début du récit a un aspect fondateur car elle nous installe dans l’équivoque, caractéristique fondamentale du roman de Marouane.
La narratrice tentera d’analyser cette phrase et d’expliquer les causes de ces disparitions répétées (préparer un coup d’état, écrire des tracts, préparer une révolution).
La réplique isolée résume également une situation de tension. C’est le cas dans cet exemple :
Nous prenions conscience de l’attraction que nous exercions sur la ville à la cadence des coups de téléphone anonymes, et des mises en garde des voisines. Car nos voisines, les veuves, les vieilles ou les infortunées qui, comme nous, n’étaient pas sous une autorité ou une quelconque tutelle (…). Ces voisines donc n’hésitaient plus à frapper chez nous.
Certaines assouvissaient une curiosité.
- Mon nouveau visache, quel dommache ! une fille dans la fleur déclamait Noria après leur départ.
D’autres soupiraient d’admiration :
- Ces oisillons qui, ma foi, s’en tirent fort bien.
Toutes enfin voulaient fouler religieusement le sol battu par celle qui avait osé transgresser, notre mère, qui maintenant se délectait des plaisirs de l’amour… (p. 142)
3Barthes Roland. L’effet de réel. Communications n°11, 1968.
4Durrer Sylvie. Le dialogue romanesque. Droz. 1994. p. 95-105
Les paroles des visiteuses sont transmises en deux répliques. Samira supportait les regards à la dérobée de ces femmes, leur répugnance, leur feinte compassion. Ces répliques isolées, montrent la situation qu’endurent les filles de Nayla et sont détachées d’un contexte conversationnel. La première réplique rapportée par Noria résume les regrets des visiteuses, la seconde est une réplique isolée rapportée tel que prononcée.
La réplique isolée reflète aussi les pensées de la narratrice sans recours à un type précis de discours. En forme d’un écriteau elle délivre sa pensée au moment où elle croit voir un sage apparaître dans sa chambre.
Ce n’était pas un produit de mon imagination. Non.
C’était un homme. En chair et en os. Grand et fin. (p. 138)
Ces répliques isolées révèlent le début du délire de la narratrice qui sombre dans un monde fantastique. Pour lutter contre les cauchemars, la narratrice recourt à la parole etinvente ce confident
Outre les formes traditionnelles du discours rapporté, des situations intermédiaires sont très fréquentes dans Ravisseur. Nous citons à titre d’exemple une forme entre le discours direct et le discours direct libre. Dans ce cas les propos du locuteur sont rapportés comme au discours direct mais ils ne sont pas isolés par des marques typographiques, mais ils sont signalés par un verbe introducteur postposé.
Puis, à mots couverts, et indiquant l’endroit de son sexe, elle parlait de castration. Plus rien, disait-elle. Niet, camarade. Ça lui arrachait des sanglots secs. Niet. Niet. Enfin, ça l‘obnubilait, etc. mais que faire ? (Cela au cas où nous viendrons à découvrir son intimité, forcément féminine.) Elle collectionnait les diversions dans ce goût-là, Djidji.
Les rares fois où elle évoquait notre mère, elle parlait de meurtre. Un meurtre prémédité. Donc un assassinat. Il lui fallait amasser suffisamment de preuves pour les envoyer sur l’échafaud. Ah ! ça oui… (p. 155)
Cette instabilité énonciative est telle que « les caractéristiques du discours des personnages ont une influence déterminante sur celle du discours du narrateur »5. Samira qui considère le discours de son père comme des tactiques de guerre, déploie elle aussi ses propresstratégies toutes les fois qu’elle évoque ce père « démente ».Dans ces discours, elle emploie le pronom « elle », tente d’accumuler les indices et les preuves pour convaincre le lecteur qu’il s’agit effectivement d’une personne étrangère et devient obséder par une seule idée : le faire disparaître.
6Stolz Claire. La polyphonie dans Belle du Seigneur d’Albert Cohen. Pour une approche sémiostylistique. Paris : Honoré Champion. 1998. p. 225
Nous rencontrons également deux structures dialogales dans ce récit : la répétition et l’enchaînement isotopique.
La répétition sert à mettre en relation deux types de discours rapportés d’un même énonciateur ou à établir une relation dialogale entre le discours rapporté et le récit.
(…) il exposa un nouveau plan d’avenir pour les jumelles…
- Vous serez coiffeuses. Je vous achèterai un salon que les meilleurs architectes de la capitale transformeront en un salon digne des coiffeuses de Paris. (p.
69)
Nous avons déjà mentionné que le discours direct succède au discours indirect ou précèdele discours indirect libre.
– Amen. Très amen.
Mais qu’était-ce donc cela qui m’habitait ? Quelle faute devais-je expier ? Mon père ne tenait décidément pas le vin. (p. 71)
Cette structure dialogale montre une opposition entre le dit et le pensé de la narratrice.
La narratrice laisse entendre dans son discours le discours d’autrui, mais souvent elle affiche une position d’adhésion ou de distanciation. Son récit se réalise et s’accomplit par l’introduction des voix des autres personnages.Les paroles des personnages au discours direct sont souvent accompagnées d’incises qui les encadrent et qui répondent aux exigences du texte romanesque.
________________________
1 Barthes Roland. L’effet de réel. Communications n°11, 1968. ↑
2 Durrer Sylvie. Le dialogue romanesque. Droz. 1994. p. 95-105 ↑
3 Barthes Roland. L’effet de réel. Communications n°11, 1968. ↑
4 Durrer Sylvie. Le dialogue romanesque. Droz. 1994. p. 95-105 ↑
5 Stolz Claire. La polyphonie dans Belle du Seigneur d’Albert Cohen. Pour une approche sémiostylistique. Paris : Honoré Champion. 1998. p. 225 ↑
6</sup