La symbolique de la mère patrie en Algérie est centrale dans l’œuvre de Mohammed Dib, où l’image de la femme reflète à la fois l’imaginaire collectif et la réalité sociale. À travers ‘La Grande maison’ et ‘Un Été africain’, l’étude révèle l’évolution du statut de la femme algérienne.
06- Symbolique du personnage féminin : L’image de la mère patrie :
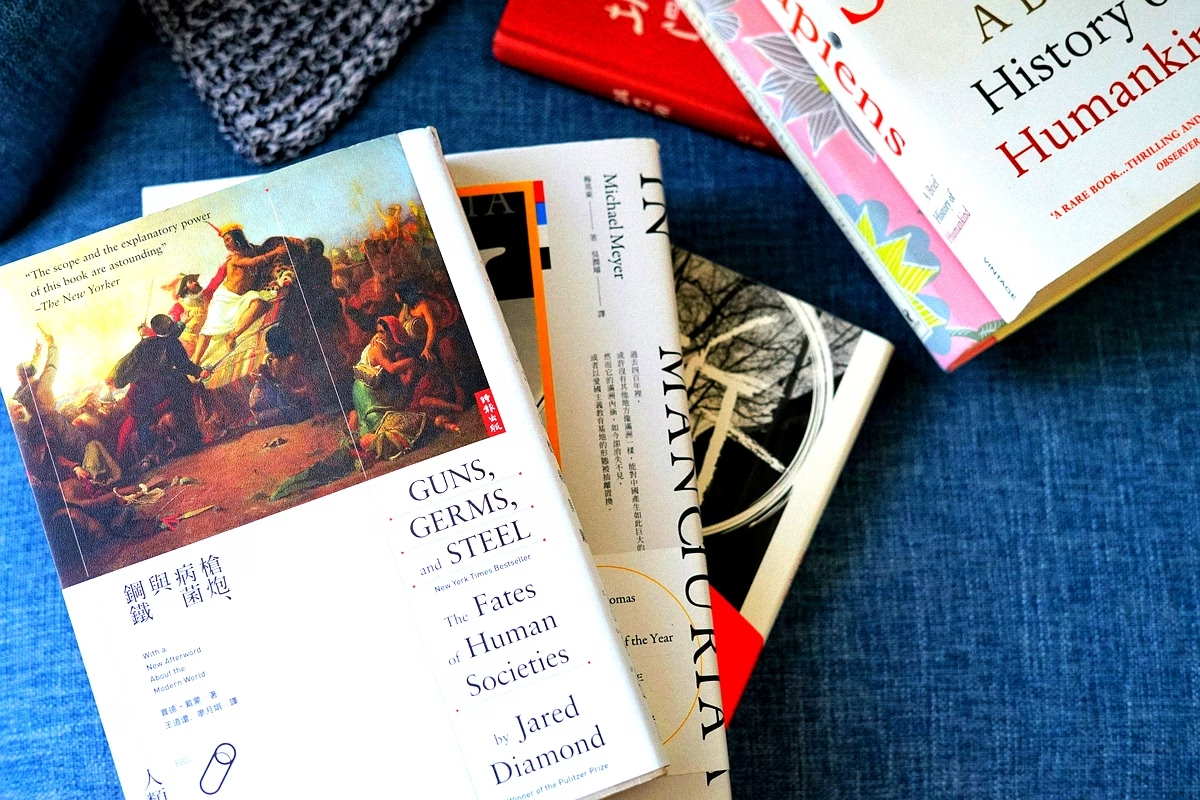
Il est vrai que le réalisme domine dans l’œuvre dibienne, toutefois, cela n’empêche pas que l’écriture dibienne prend d’autres aspects importants dont l’aspect symbolique. Du fait que Dib a eu recours à des images symboliques pour mener à bien la présentation du réel de la femme algérienne comme celle de la mère-patrie ou « la mère-terre »1. En fait, la terre et la mère portent les mêmes caractéristiques qui incarnent la vie, la fertilité et la création. Les deux sont les garantes de l’éternel recommencement, comme l’affirme Charles BONN :
La «Terre » au sens large où nous l’entendons, est l’espace maternel celui des racines. (…) La mère et la terre sont les garantes de l’ancienne loi. Mais aussi celles de l’éternel recommencement qu’elles symbolisent.2
Dib est façonné par les événements de son pays, de ce fait il a choisis de combattre sur le terrain de la littérature. Sa mère la patrie exige qu’il l’écrive, comme une sorte de remerciement, qu’il l’enfante comme elle l’a enfanté.
Dans La Grande maison quand le maître Hassan ouvre sa leçon de moral en posant la question « Qu’est d’entre vous sait ce que veut dire : patrie ? (G.M p.20) », Brahim Bali l’un des élèves redoublants répond : « La France est notre mère patrie. (G.M p.20) ». Une telle réponse ambiguë et non convaincante pour Omar lui fait réfléchir : « Comment ce pays si lointain est-il sa mère ? Sa mère est à la maison, c’est Aïni ; il n’en pas deux. Aïni n’est pas la France. Rien de commun. (G.M p.20) ». Cette réponse pour Omar n’était qu’un mensonge, il n’ya aucune ressemblance entre Aïni sa mère et la France coloniale.
Aïni symbolise l’existence car elle donne la vie. Elle est la terre et la mère patrie car elle donne l’existence et l’assurance et cherchant le bien pour sa famille et son pays. Elle est symboliquement la mère patrie fougueuse, pacifique, nourricière et protectrice célébrée comme la « première mère ». De même, dans le passage qui montre Omar surpris par le mugissement de la sirène qui annonce la deuxième guerre mondiale, effrayé, il courut partout cherchant l’existence de sa mère Aïni près de lui. Il ne réussit à se calmer que dans les bras tendres de sa mère, ce pays singulier :
Aïni le prit dans ses bras et l’attira vers elle. Son agitation tomba d’un coup. Un vide bienfaisant l’envahissait (…) Il se retrouvait à l’orée d’un pays singulier. (G.M p.180)
Dib symbolise la patrie par Aïni la mère tendre qui se sacrifie pour défendre le rassemblement de sa famille, où Omar sent la nécessité de son appartenance à ce pays différent des autres et unique. Ainsi, Aïni est choisie comme mère-patrie car elle concrétise et véhicule les mêmes caractéristiques et valeurs de la souffrance, de la compassion, de la sensibilité, et de la patience dont souffre la patrie algérienne. Les deux souffrent et luttent contre leur réel amer.
À vrai dire, la femme représente un sujet primordial dans les événements, la structure et la vision totale dans les travaux et les œuvres de Dib. Il lui donne un rôle qui mêle sa nature féminine et ses devoirs humains comme symbole de fertilité et de patrie, comme hommage de ce qu’elle a fait dans le trajet de la libération algérienne, et de ce qu’elle fait encore dans le réel vécu dans tous les domaines. D’ailleurs, le fait d’intéresser de la femme et de lui donner le statut qu’elle mérite représente une dimension humaine avant d’être sociale et civilisationale.
Au terme de cette étude, nous sommes bien loin d’avoir abordé tous les aspects du sujet dont la richesse nous a obligé à faire des choix et à laisser certains points pourtant intéressants qui nécessitent des études avenirs. Loin d’être épuisé, ce travail de recherche se veut avant tout un fondement pour toute autre étude ultérieure. Signalant que chaque axe peut faire à lui-même l’objet d’une étude approfondie.
L’étude que nous avons menée à travers la présentation du statut de la femme algérienne dans l’imaginaire collectif et dans le réel algérien vécu, nous a montré que l’image de la femme en Algérie est pareille à celle des femmes vivant dans une société où prédomine l’éducation traditionnelle, qui joue un rôle majeur dans la survie et la reproduction de pratiques sociales ségrégationnistes et dévalorisantes, où l’omniprésence et l’enracinement des lois et des valeurs louant et légitimant la suprématie de l’homme.
La femme est enfermée dans un statut d’être mineur, image fortement ancrée dans l’imaginaire collectif algérien qui construit la mémoire collective, la forme ou la déforme, selon l’objectif qui lui a été assigné. Toutefois, le rôle de la femme algérienne était déterminant pour relever les défis. Aujourd’hui, la femme algérienne est partout, et a le mérite et la position sociale qu’elle a dignement arrachée après des sacrifices interminables.
Ce que lui permet d’être fort présente dans les écrits littéraires.
Par ailleurs, nous avons découvert à travers l’incarnation littéraire de l’être féminin que la femme algérienne était l’épicentre dans l’écriture romanesque d’expression arabe ou française. La reconstruction de l’image de la femme d’après les éléments essentiels donnés par ces écrivains nous a montré deux types d’image : traditionnelle où la femme est souvent dévalorisée, réduite à une ménagère, où elle incarne l’ignorance et l’immaturité, alors que l’homme représente la sagesse et la clairvoyance.
Une image qui persiste encore comme symbole d’une permanence dans la vision que se fait l’écrivain du féminin et d’une représentation sociale de la femme encore traditionnelle. En outre, une autre image moderne défendue par des écrivains et des féministes, mais qui demeure loin de répondre aux aspirations et interrogations de la femme algérienne.
Dans leur approche de l’image de la femme, les procédés adoptés par les romanciers maghrébins sont différents de ceux employés par Mohamed DIB qui réussit à refléter le réel et la réalité de la femme algérienne toute au long de ses œuvres littéraires. Afin de limiter notre étude nous nous sommes intéressée qu’aux deux romans La Grande maison et Un Eté africain. Cependant il est à signaler que la difficulté majeure que nous avons eu à affronter est celle de la combinaison entre l’analyse de ces deux œuvres ; beaucoup d’informations sur le premier volet de la trilogie d’Algérie, peu de documents sur l’autre œuvre Un Eté africain.
La description analytique et interprétative des images données de la femme algérienne dans les deux œuvres dibiennes, nous a montré que Dib offre un rôle et une représentation de la femme différents de celle qu’en donnent les écrivains maghrébins. Elle n’est plus seulement la mère respectée en tant que telle, mais c’est l’épouse, l’aimable, l’instruite et la travailleuse.
Des femmes assumant pleinement leur destin, leur parole étant sujet, objet et action pour s’affirmer et dénoncer la situation et le réel qu’elles vivent. Ainsi, à travers les deux romans Dib marque un processus de changement dans le statut de la femme algérienne, l’image traditionnelle de la femme que donne La Grande maison a subit un changement et une mutation, représentée dans l’image de Zakya l’instruite militante d’Un Eté africain, qui a su donné une voix / voie à toutes les femmes algériennes privées de parole. Il nous apparaît aussi que le vécu collectif social de la femme façonne la vision de la condition féminine. Dib procède par décrire la situation de la femme au sein d’une société colonisée qui est, semble-t-il, l’origine de sa marginalisation, de son animalisation et de sa souffrance.
Tous les personnages féminins qui sont mis en scène sont ancrés dans le même contexte linguistique, historique et culturel, ainsi l’intrigue des deux œuvres étudiées tourne autour de problématiques communes comme la colonisation, l’émancipation et la fatalité sociale. Dib rassasié de sa culture arabo-musulmane, et influencé de sa société algérienne décrit dans son approche de la femme algérienne la réalité la plus vraisemblable avec tous ses aspects.
Il nous procure un tableau d’une société dans toute sa totalité, par son imaginaire, ses traditions et ses mœurs pour révéler tant de réalités sur une féminité qu’était celle de toutes les Algériennes à l’époque de la colonisation. Et c’est le rôle de l’écrivain audacieux qui doit se libérer de toute menotte et affronter tous les obstacles pour présenter le fait vécu, et mettre en lumière les problèmes réels de la société dont il est membre.
Ainsi, au monde entier, y a-t-il une réalité et un problème social plus brillant que la situation de la femme ? Dib incite les écrivains à s’intéresser de près et de traiter les problèmes qui entourent cet être qui a vécu longtemps dans l’ombre. Il déclare dans une interview :
Des problèmes capitaux n’ont pas encore été abordés par les écrivains algériens : l’analyse de la vie sentimentale, par exemple. Or, la femme est l’être psychologique par excellence, et son étude a permis l’analyse et la création, même du genre romanesque et de la psychologie en général.3
Certainement, pour Dib la valeur de la femme s’amplifie jusqu’en fait la base, et l’inspiratrice de toute création littéraire et scientifique. Et c’est cette vision que s’est fait Dib de la femme dans toutes ses œuvres.
Ce point d’aboutissement, nous permet de conclure que la question de la femme et son incarnation romanesque était et demeure un champ fertile pour beaucoup d’écrivains qui prennent en leur charge la libération de la femme de toutes les formes d’asservissements qui tendraient à la maintenir dans l’ignorance éternelle. Aujourd’hui, comme sujets ou comme objets et entre être et devenir, les femmes algériennes continuent encore à frayer leur chemin vers un avenir meilleur.
________________________
1 Mohamed DIB, Préface à la traduction bulgare (Octobre 1961), Un été africain, p.04. ↑
2 Charles BONN, La Littérature algérienne de langue française et ses lectures. Imaginaire et discours d’idées, Naaman, Sherbrooke, 1974 in : http://www.limag.refer.org. ↑
3 Interview par C.Acs, L’Afrique Littéraire et artistique, n°18, aout 1971, p.10. ↑