L’image de la femme dans l’œuvre de Dib est analysée à travers les romans ‘La Grande maison’ et ‘Un Été africain’, mettant en lumière la représentation de la femme algérienne dans l’imaginaire collectif et son évolution au sein de la réalité sociale. Cette étude révèle les tensions entre tradition et modernité.
Chapitre 02
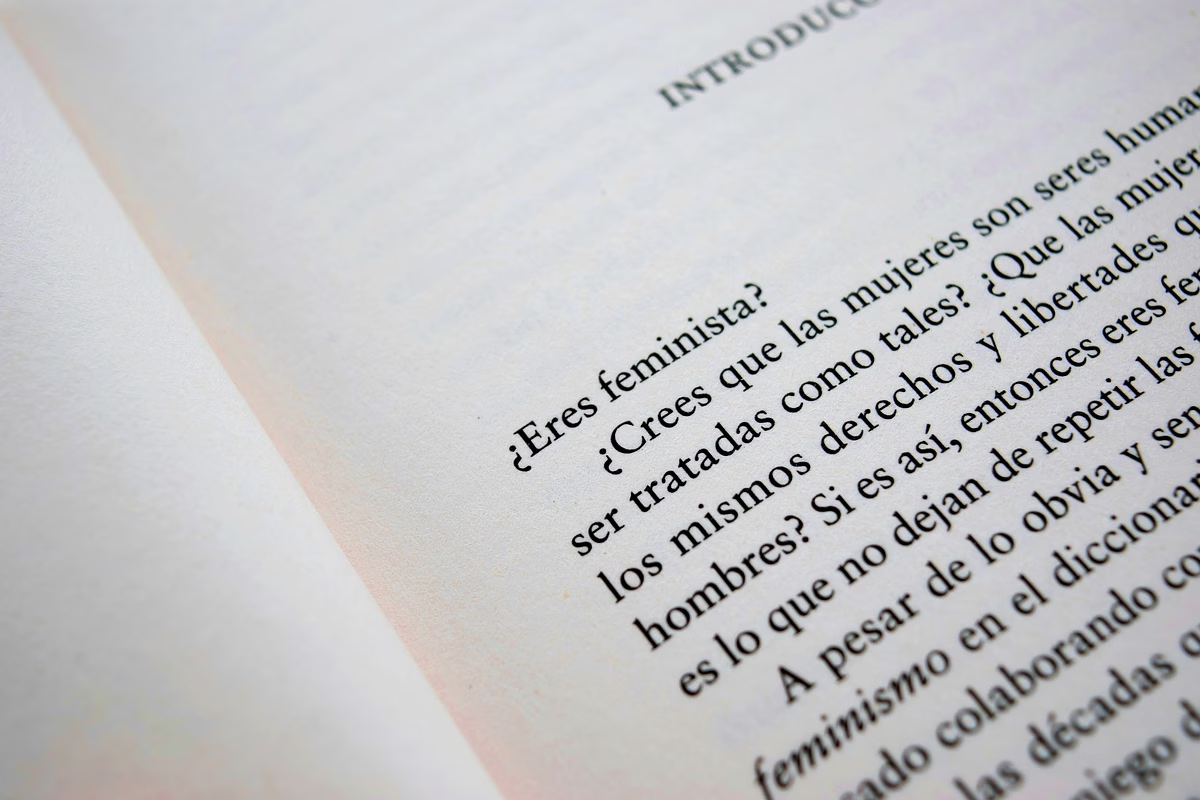
L’image de la femme dans l’œuvre dibienne.
Biographie de l’auteur :
Mohamed DIB est sans conteste le père du roman algérien contemporain. Il fait partie de cette génération d’écrivains maghrébins d’expression française qui ont pris en leur charge de défendre la pureté et la liberté de leur pays. Mohammed DIB est né le 21 juillet 1920 à Tlemcen, dans l’Ouest de l’Algérie, au sein d’une famille modeste.
Il fut élevé par sa mère après la mort de son père en 1931. Il poursuit ses études primaires et secondaires en français et dès l’âge de douze ou treize ans, tout en continuant à étudier, il s’initie au tissage et à la comptabilité. La mort de son père l’oblige à travailler très tôt, il exerce plusieurs autres métiers : instituteur, employé des chemins de fer, interprète auprès des armées alliées en français-anglais, journaliste et dessinateur de maquettes de tapis.
Il étudie les lettres à l’université d’Alger durant la deuxième guerre mondiale et à partir de 1949 il fréquente des réunions d’intellectuels et côtoie les écrivains de l’école d’Alger qui gravitent autour d’Albert CAMUS. De 1950 à 1952, Dib travaille comme journaliste à l’Alger Républicain à travers lequel il participe activement au débat culturel et politique de son pays.
En 1951, il se marie avec une Française Colette BELLISSANT dont il aura quatre enfants.
Mohammed DIB a commencé son carrière littéraire dès l’âge de quinze ans par des nouvelles et des poèmes du genre surréaliste, mais le contexte que vivait l’Algérie à l’époque l’oblige à être réaliste en écrivant le roman national. Commençant par son premier roman La Grande maison en 1952, suivi de L’Incendie en 1954 et Le Métier à tisser en 1957, ces premières œuvres romanesques forment sa célèbre trilogie où Dib brosse un tableau vivant de la vie quotidienne des Algériens opprimés et dévoile leur prise de conscience. Aragon disait : « l’audace de Mohammed DIB c’est d’avoir entrepris comme si tout était résolu, l’aventure du roman national de l’Algérie »1.
Toutefois, dès les premiers écrits et les activités militantes de Dib, son talent de jeune romancier fut vite reconnu et ne plaît pas aux autorités françaises qui l’expulsent en 1959. Mohamed DIB quitte son pays natal et s’installe en France, il s’exile tout en portant avec lui la voix de l’Algérie, son pays, à l’étranger où il continue à publier avec une régularité exemplaire et une exigence esthétique remarquable, et après l’indépendance, l’écriture de Mohammed Dib retourne au surréalisme et à la mythologie. Ainsi, depuis 1970 Dib fait des séjours dans différents pays, notamment aux Etats-Unis et en Finlande dont ses dernières œuvres portent une forte empreinte ; il continue à produire et publie des articles et des interviews qui témoignent d’une véritable réflexion critique de l’écrivain.
Sa carrière d’écrivain poursuivie en France garde toujours avec son pays natal des liens profonds proclamant toujours son algérianité jusqu’à sa mort. À cet égard le docteur Rachid RAISSI écrit :
M. Dib qui non seulement a pu écrire avant, pendant et après la révolution de manière toujours plus éloquente et plus recherchée mais, de plus, il s’est toujours attaché à défendre sa différence de maghrébin en refusant farouchement l’assimilation à la culture de l’autre et le dépouillement de ses spécificités culturelles.2
Dib est mort le vendredi 02 mai 2003 à son domicile de La Celle Saint-Claud en France, laissant derrière lui une trentaine de romans, des recueils de poèmes et des nouvelles, et deux contes pour les enfants. Ainsi, la littérature algérienne a perdu l’une de ses plus grandes plumes, dont le parcours dans ce monde où « chaque mot que tu traces sur la page blanche est une balle que tu tires contre toi.» écrit-il un jour, a dépassé le demi-siècle.
L’œuvre de l’écrivain :
Nul ne peut nier que l’œuvre de Mohamed DIB est le miroir qui reflète son âme rassasiée de sa culture arabo-musulmane et ses origines algériennes. Cette culture qui n’a cessé de l’accompagner même après son exil et jusqu’à sa mort, se dressant toujours comme le caractère inévitable et la source inépuisable dont nourrit son écriture, comme l’indiquent tous les chercheurs et les écrivains qui sont intéressés à son parcours. Ainsi Naget KHADDA écrit :
Mohammed Dib manifeste à travers son oeuvre une sensibilité et un imaginaire pétris de culture arabo-musulmane que sa vie d’exilé a sérieusement réactivés. Culture puisée dans la vie quotidienne de sa cité natale: capitale intellectuelle et religieuse de l’Ouest algérien.3
Abordant plusieurs thèmes, Dib a toujours parlé des préoccupations de son peuple même loin de lui, et l’ensemble de son œuvre se donne comme un témoignage de sa fidélité envers la patrie mère.
Dès sa première trilogie composée de La Grande maison (1952), L’Incendie (1954) et Le Métier à tisser (1957), en passant par Un Été africain (1959), un recueil de nouvelles Au Café (1955) et jusqu’à son recueil poétique Ombre Gardienne (1962), l’écriture de Mohamed DIB fut réaliste et engagée témoignant du contexte socio-historique qu’a vécu l’Algérie à l’époque. Ainsi, dès l’indépendance, Mohamed DIB entame un nouveau style d’écriture qui peut s’appelée surréaliste en ce sens que la réalité se trouve convertie dans le monde du mythe et du rêve ; c’est le cas des œuvres Qui Se souvient de la mer (1962), Cours Sur la rive sauvage (1964), et du recueil de nouvelles Le Talisman (1966).
Ensuite, DIB adopte un néo-réalisme teinté de symbolisme dans La Danse du roi (1968), Dieu en barbarie (1970) et Le Maître de chasse (1973). Enfin, depuis Habel (1977) qui représente une nouveauté thématique chez DIB du fait qu’il s’inscrit dans l’écriture de la migration qui dit l’émigration et l’exil, la scène romanesque se déplace hors d’Algérie, à Paris d’abord puis dans les pays nordiques qui lui inspirent sa dernière trilogie Les Terrasses d’Orsol (1985), Le Sommeil d’Ève (1989) et Les Neiges de marbre (1990).
Dib continua son trajet romanesque en publiant avec une régularité extrême plusieurs autres romans, L’Infante Maure (1994), Si Diable veut (1998) lors de la décennie de la violence qu’a vécue l’Algérie. Dans Simorgh (2003) et Laëzza, ses derniers romans terminés quelques jours avant sa mort, DIB revient sur ses souvenirs de jeunesse.
Mohammed DIB a reçu plusieurs Prix littéraires, notamment le Prix Fénéon en 1952, le prix de l’Union des Écrivains Algériens en 1966, le prix de l’Académie de poésie en 1971, le prix de l’Association des Écrivains de langue française en 1978, le Grand Prix de la Francophonie de l’Académie française en 1994, accordé pour la première fois à un écrivain maghrébin et en 1998. Dib a obtenu le Prix Mallarmé pour son recueil de poèmes L’enfant-jazz.
L’œuvre dibienne se caractérise par la diversité de ses thèmes (la condition humaine, la mort, l’amour fou, l’émigration, l’exil et la féminité) et par la multiplication de ses genres (poésie, roman, conte, nouvelle et théâtre), ce qui lui rend incontournable une œuvre dont « chaque lecture n’est qu’un parcours possible et d’autres chemins restent toujours ouverts […] L’œuvre ouverte à tous les vents et à tous les hasards, celle qu’on peut traverser dans tous les sens.»4 L’œuvre de Mohamed DIB a suscité un très grand nombre d’études et d’ouvrages critiques, livres, thèses et articles ; c’est l’écrivain contemporain le plus étudié car c’est un écrivain sincère et engagé. Il a laissé une série d’œuvres où de l’une à l’autre s’affirme un incontestable tempérament de romancier.
Bibliographie de l’auteur :
La Grande maison, roman, Le Seuil, 1952.
L’Incendie, roman, Le Seuil, 1954
Au café, nouvelles, Gallimard, 1955
Le Métier à tisser, roman, Le Seuil, 1957
Un Été africain, roman, Le Seuil, 1959.
Baba Fekrane, contes pour enfants, La Farandole, 1959.
Ombre gardienne, poèmes, Gallimard, 1961.
Qui se souvient de la mer, roman, Le Seuil, 1962.
Cours Sur la rive sauvage, roman, Le Seuil, 1964.
Le Talisman, nouvelles, Le Seuil, 1966.
La Danse du roi, roman, Le Seuil, 1968.
Formulaires, poèmes, Le Seuil, 1970.
Dieu en barbarie, roman, Le Seuil, 1970.
Le Maître de chasse, roman, Le Seuil, 1973
Le Chat qui boude, contes pour enfants, La Farandole, 1974
Omnéros, poèmes, Le Seuil, 1975.
Habel, roman, Le Seuil, 1977.
Feu beau feu, poèmes, Le Seuil, 1979.
Mille Hourras pour une gueuse, théâtre, Le Seuil, 1980.
Les Terrasses d’ Orsol, roman, Sindbad, 1985.
O Vive, poèmes, Sindbad, 1987.
Le Sommeil d’Ève, roman, Sindbad, 1989.
Neiges de marbre, roman, Sindbad, 1990.
Le Désert sans détour, roman, Sindbad, 1992.
L’Infante maure, roman, Albin Michel, 1994.
Tlemcen ou les lieux de l’écriture, essai, La Revue noire, 1994.
La Nuit sauvage, nouvelles, Albin Michel, 1995.
L’Aube Ismaël, poèmes, Tassili Music, 1995.
Si Diable veut, roman, Albin Michel, 1998.
L’Enfant jazz, poèmes, La Différence, 1998.
L’Arbre à dires, nouvelles, essai, Albin Michel, 1998.
Le Cœur insulaire, poèmes, La Différence, 2000.
Salem et le sorcier, contes pour enfants, Yomad, 2000.
Comme un bruit d’abeilles, Albin Michel, 2001.
L’Hippopotame qui se trouvait vilain, contes pour enfants, Albin Michel, 2001.
L.A. Trip, roman, Paris, La Différence, 2003.
Simorgh, nouvelles, essai, Albin Michel, 2003.
Laëzza, nouvelles, essai, Albin Michel, 2006.
Poésies, Paris, « Œuvres complètes », La Différence, 2007.
________________________
1 Louis ARAGON, cité par Olivia MARSAUD in : http://209.85.135.132/search?q=cache:JyzNkgYnGKcJ:www.arab- art.org/arts.php%3FartisteID%3D30682+dib+et+aragon&cd=2&hl=fr&ct=clnk&gl=fr ↑
2 Rachid RAISSI, La Part du sacré dans le texte maghrébin d’expression française, cité in : http://www.licence-2eme.new.fr ↑
3 Naget KHADDA, La Littérature Maghrébine de langue française, ouvrage collectif, sous la direction de Charles BONN, Naget KHADDA et Abdallah MDARHRI-ALAOUI, Paris, EDICEF-AUPELF, 1996, in : http://www.limag.refer.org/Textes/Manuref/DIB.htm ↑
4 Note de lecture. ↑