L’image de la femme dans le roman algérien d’expression arabe :
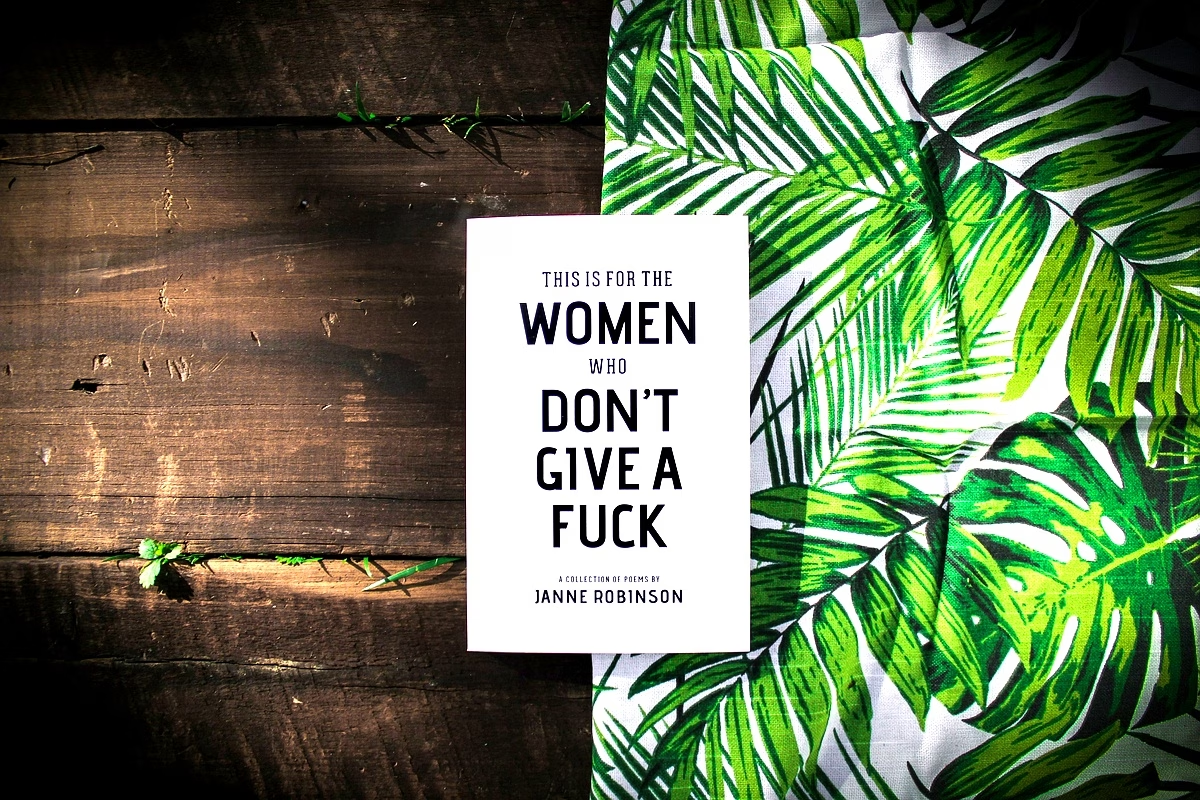
Il faut signaler que le roman est un genre tout jeune dans la littérature algérienne d’expression arabe, tout comme dans la littérature arabe dont le premier roman est né en Egypte au début du siècle en 1914. En effet, le retard de ce genre dans la littérature algérienne peut s’expliquer par le fait de la domination et l’assimilation coloniale qui a favorisé la langue française au détriment de l’arabe.
D’où la prédominance de la littérature algérienne d’expression française surtout dans le domaine du roman, alors que l’univers favorable de la langue arabe était la poésie. En fait, la littérature algérienne de langue arabe demeura vivante même à l’époque coloniale avec plusieurs figures telles que Cheikh Ben BADIS, Bachir IBRAHIMI, Malek BENNABI et d’autres qui ouvrent à travers leurs revues et journaux Al-Shihab (1935-1936) et Al-Bassair des colonnes consacrées à des écrivains comme Ahmed BENACHOUR, Zhor OUANISSI pour publier leurs nouvelles qui s’articulent généralement autour des problèmes sociaux, en particulier celui de la femme. Dans cette perspective Ahlam Mostaghanemi affirme :
La littérature algérienne de langue française n’a servi en rien la cause de la femme jusqu’au déclanchement de la guerre de libération en 1954. Par contre, celle de la langue arabe s’employait dès le début du siècle à changer les mentalités figées en se référant tantôt à la religion, tantôt à l’Orient et tantôt aux progrès réalisés ailleurs.1
Toutefois, il est incontestable que le premier écrivain qui a eu l’audace d’écrire le premier roman algérien arabe en 1947 est Réda HOUHOU en s’essayant dans tous les genres tels que la nouvelle, le roman et le théâtre. L’écrivain algérien Waciny LAREDJ affirme :
Lui [Houhou] qui par son instinct d’homme de lettres, par sa culture cosmopolite, a donné vie en 1947, à tout un genre littéraire, le premier roman de langue arabe : Ghada Oum El qora (La Belle de Mecque). […] il s’agit de la toute première expérience tentée en direction d’un genre littéraire foncièrement occidental qui était considéré à l’époque comme un sous-genre par rapport à la poésie arabe.2
Ahmed Réda Houhou s’illustra par la thématique de ses romans où il s’intéresse à la condition de la femme algérienne et à la question de l’émancipation féminine notamment avec Ghada Oum El qora (La Belle de La Mecque) qui représente l’image de la jeune fille arabe claustrée. À travers ce roman dont les événements se déroulent en Arabie Saoudite, Houhou essaye de nous brosser un tableau esthétique de l’image de la femme algérienne à l’époque en s’inspirant du réel vécu de la femme arabe. À travers ce roman tragique puisque le personnage principal Zakia meurt dans le désarroi, Houhou condamne les mœurs corrompues en mettant en évidence le préjudice causé aux femmes par des coutumes obsolètes.
Houhou aborde aussi le thème de l’amour dans ses nouvelles Fatat Ahlami (La Fille de mes rêves), Sahibat El Ouahy (La Femme inspirée) qui raconte l’amour d’un poète pour une jeune fille ; à l’origine de son inspiration, cette thématique de l’amour impossible conduit l’âme romantique de l’amant vers un profond désarroi.
Ce thème de l’émancipation de la femme est fort présent dans les romans d’Abdelhamid BENHADOUGA, qui s’articulent généralement autour de ce thème. Son roman Rih El Djanoub (Vent du Sud) paru en 1975 se proclame le premier roman algérien d’expression arabe répondant aux critères littéraires du genre, après la première tentative romanesque d’Ahmed Réda Houhou.
Dans ce roman, l’écrivain traite le statut de la femme algérienne de l’indépendance en lui attribuant plusieurs images représentées par le personnage de Nafissa. Cette dernière incarne l’image de la femme instruite qui se trouve partagée entre la capitale où elle mène ses études et son entourage traditionnel, qui voit que l’objectif ultime d’une femme est le mariage et la construction d’une famille.
Nafissa est encore l’image de la femme cloîtrée, objet du désir assidu et de harcèlement continu.
Ainsi dans son roman La Mise à nu où se mêlent différents registres culturels et sociaux, Benhadouga nous décrit l’image de la femme émancipée, révoltée incarnée par le personnage de Dalila, qui refuse le diktat familial de son père et se révolte contre les valeurs et les traditions de son entourage. Toutefois il n’en demeure pas moins que l’image de la femme algérienne donnée par Dalila demeure négative, du fait qu’elle nous montre une déviation négative dans le concept de l’émancipation de la femme en nous donnant l’image de la femme libertine qui se trouve au centre de la perdition, où elle paye dans sa chair son désir d’émancipation et sa volonté d’être.
De même Ahlam MOSTAGHANEMI en tant qu’emblème de l’écriture féminine arabe, peint tout au long de son trajet romanesque plusieurs images qui appellent à l’émancipation féminine. À travers ses différents romans Le Chaos des sens, Mémoires de la chair, Passager du lit et autres, elle a eu l’audace de traiter plusieurs thèmes tels que la politique, la religion, l’amour, le couple, l’incommunicabilité, la maladresse de l’homme vis-à-vis de sa femme.
48
L’écrivaine affirme : « chaque algérien cache sous ses apparences un type déséquilibré en carence affective »3. Cette carence est renforcée par l’incommunicabilité dans un milieu sclérosant et contraignant ; c’est pourquoi la littérature féminine devient une nécessité, une arme de résistance pour casser les tabous d’interdiction de l’expression féminine qui demeura longtemps éteinte. De ce fait, les écrivaines dans les deux langues arabe et française se feelent impliquées et appelées à combattre pour créer des nouveaux regards sur la réalité et le vécu social et culturel de la femme algérienne dans un monde régi par les hommes, en prenant également en considération les aspirations de ces femmes en matière de leur émancipation et de leur liberté.
D’après les images citées ci-dessus, on peut déceler que la femme était au centre de l’incarnation romanesque d’expression arabe ou française. Les images que les écrivains lui ont attribuées s’articulent généralement autour deux axes, traditionnel et moderne, avec une forte focalisation sur le milieu traditionnel. Suivant leur perception dans ce milieu, tous ces écrivains présentent des nombreux traits communs de l’image de la femme comme un profil identique.
Une dégradation physique et psychologique des femmes par les méfaits conjugués du patriarcat et du colonialisme puisait ses ressources dans les stéréotypes misogynes les plus injustes. La femme est représentée comme objet, soumise et enfermée dans le désarroi, la folie et le délire, comme un être critiqué au centre des mutations socioculturelles.
Ainsi, le milieu décrit souligne toujours la suprématie de l’homme sur la femme, et on réduit le rôle de la femme seulement à l’entretien du foyer et à des tâches purement ménagères en méconnaissance de ses aptitudes et de ses aspirations. La seule femme à qui on attribuait une image sacrée et valorisée comme être idéal était la mère, la maîtresse chez elle qui constitue la source d’enracinement de chacun et le lien du passé avec le présent.
Des images héritées de l’imaginaire collectif dont la littérature semble être le lieu privilégié. Ainsi, il s’avère que plusieurs écrivains notamment les féministes ont pris en charge la situation que vit la femme algérienne en lui accordant plusieurs images qui appellent à son émancipation. Subséquemment, apparaît l’image de la femme émancipée, la femme militante pour ses droits, la femme instruite qui revendique sa liberté et son corps.
Plusieurs images modernes sont adoptées pour accélérer le processus du changement du statut réel de la femme, et pour répondre à un besoin majeur qui est la représentation de la femme en tant qu’un être idéal. Toutefois, il n’en demeure pas moins que plusieurs images modernes données par ces écrivains restent négatives, du fait qu’elles ne respectent pas la dignité, l’honneur et la chasteté de la femme algérienne en lui attribuant des images empreintes de cultures étrangères qui réinjectent les idées de la bâtardise et de la prostitution, et qui ne correspondent pas aux aspirations de la femme algérienne. Toutefois ce n’est pas du tout le cas de l’écrivain algérien Mohamed DIB, qui reste le premier à brosser une image authentique de la femme algérienne dès la colonisation et à travers toutes ses œuvres qui témoignent d’une véritable concrétisation de la condition de cette femme, surtout dans ses premières œuvres inspirées de la situation coloniale, La Grande maison et Été africain.
49
________________________
1 Ahlam MOSTAGHANEMI, La Femme dans la littérature algérienne contemporaine, Paris, thèse 3° cycles, Ecole des hautes études, 1980, p.161, cité par Sonia RAMZI- ABADIR, Op.cit. p.80. ↑
2 Waciny LAREDJ, Le Roman Algérien de langue arabe : Un parcours difficile, El Watan 14/04/2005. ↑
3 Ahlam MOSTAGHANEMI, cité par Keira Sid Larbi ATTOUCHE, Op.cit. p.29. ↑