Le statut de la femme en Algérie est profondément influencé par les enjeux politiques et sociaux, comme l’illustre l’œuvre de Mohammed Dib. Cette étude analyse la représentation de la femme algérienne dans ‘La Grande maison’ et ‘Un Été africain’, mettant en lumière son évolution dans l’imaginaire collectif.
Chapitre 02
Le réel vécu de la femme algérienne
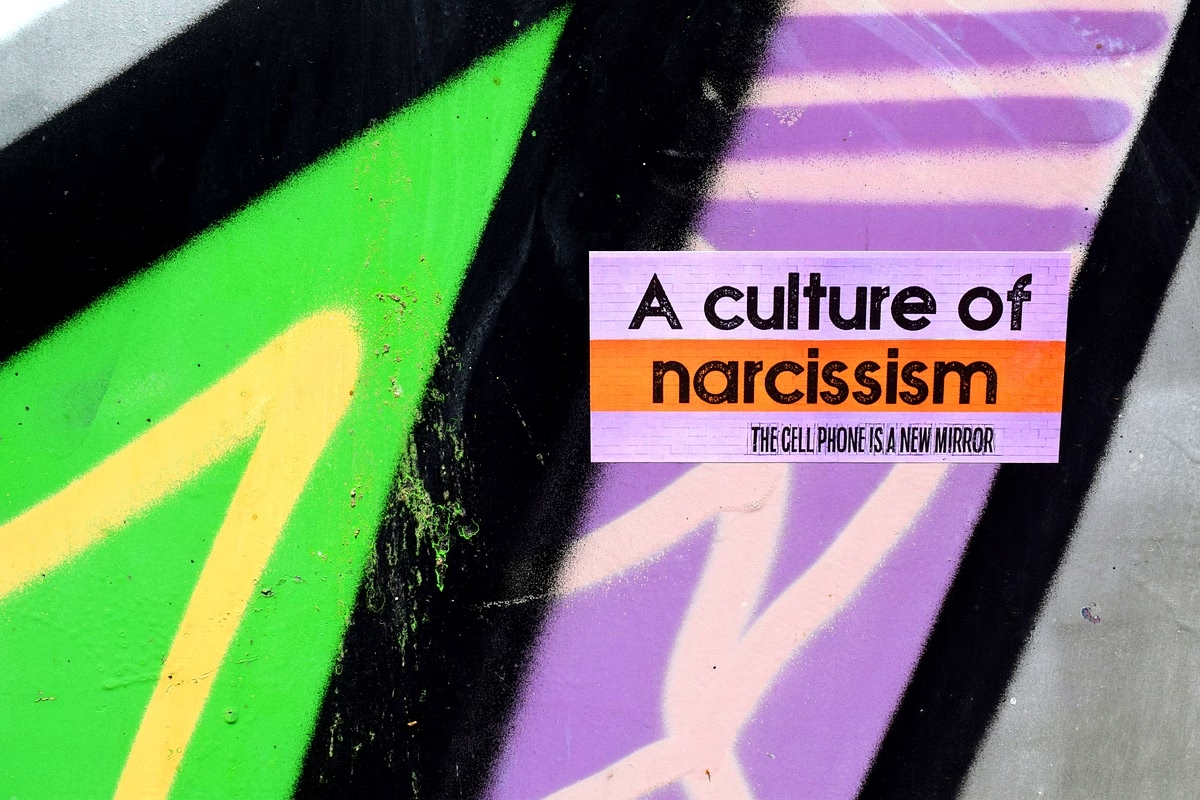
En Algérie plus qu’ailleurs, la place de la femme a été fortement liée aux enjeux politiques et sociaux du pays. Ici, la compréhension de la condition et du rôle que joue la femme algérienne dans la société moderne ne peut pas s’accomplir sans tenir compte du rôle et du statut qu’a occupé cette femme durant ces évolutions politiques et sociales passées. Il convient de faire un retour sur l’évolution du statut de la femme en retraçant son trajet pour s’émanciper.
Le statut traditionnel de la femme algérienne (L’éternelle mineure) :
La société algérienne traditionnelle est caractérisée par une très forte intégration sociale qui tend au maintien des traditions. Dans ces traditions sont accrochés des idées, des symboles, des mythes et des préjugés qui fondent la suprématie des hommes sur les femmes. En effet, la société algérienne à l’époque était une société colonisée, humiliée où le colonisateur français accordait une place de premier plan à la femme algérienne comme vecteur très important des traditions algériennes qu’il cherchait à bouleverser.
En effet la femme est considérée comme le noyau central de la société algérienne, de ce fait le colonisateur a vu que s’emparer de la femme algérienne est la meilleure voie pour détruire la famille et la société de son authenticité arabo-musulmane. C’est pourquoi il fallait pour la société et pour l’homme algériens de maintenir la femme dans un rôle de gardienne de la maison, de la tradition et de la mémoire de peur qu’elle se détourne de ses valeurs, de ses mœurs et de son identité nationale.
La femme gardienne de la maison :
La société algérienne se caractérise par l’honneur comme loi que personne ne peut transgresser et où la famille occupe un statut hautement valorisé. Sonia RAMZI-ABADIR affirme que :
La famille doit traverser les siècles le front haut et les mains pures. Elle doit sauvegarder « l’honneur », mélange d’amour-propre, de dignité, de moralité, de fierté, de solidarité. C’est comme un feu intérieur qui oblige l’individu à ne pas perdre la face. […] chaque atteinte à l’honneur sera vengée. La famille représente le sang des ancêtres, la vie même dans sa permanence. On la défend donc parce qu’on défend son propre sang et sa vie.1
Et dans la mesure où l’honneur de cette famille n’est que le reflet de l’honneur de la femme qui la fonde, la préservation de cette femme était l’objectif primordial de l’homme. Et là, se trouve sans doute la raison pour laquelle la femme s’est trouvée limitée aux tâches domestiques et souvent effacée du monde extérieur.
L’homme essaye dans la mesure la plus possible de couper toute relation entre la femme et la société européenne, car « dans une société en péril le premier réflexe est de sauver les femmes et les enfants ».2
Alors, la maison était le lieu par excellence où la femme peut respirer, mais aussi où le pouvoir de l’homme était total et absolu, il y eut un rapport de domination et de subordination entre les deux. Dans cet édifice social et culturel bâti par les hommes et pour eux, la femme algérienne traditionnelle vivait dans un état hétéroclite, injustement manipulée, maltraitée et réduite au stade des domestiques.
Privée de toute sorte d’instruction et de formation, elle doit seulement rester à la maison et apprendre dès l’enfance comment assurer ses fonctions domestiques pour être l’épouse modèle qui s’occupe de son mari et de ses enfants toute sa vie. Et malgré son existence en tant que mère, sœur, épouse et fille, la femme restait dans le coin sombre de la société enterrée dans le silence, parce que la parole était un droit qui n’appartient qu’à l’homme.
Lui seul avait le droit d’exprimer, de donner des ordres, d’être écouté dans la maison, sa petite colonie. Naffissa ZERDOUMI dans son roman Enfants d’hier décrit ce milieu fermé en ces termes :
Ici, [la demeure] est un lieu féminin. Pour la femme parce qu’elle est le lieu normal de son existence. La maison est conçue pour elle, pour protéger son intégrité, pour qu’elle y soit à l’aise pendant la plus grande partie de son existence sur terre où elle y vit. Pour l’homme la maison est l’endroit où il vient s’unir à son épouse et manger la nourriture que les femmes préparent.
Se coucher et manger c’est entrer dans le mystère du monde des femmes qui engendrent et allaitent. C’est peut être pourquoi on se couche et on mange en silence. Et dans cette maison l’homme n’est pas tout-à- fait à l’aise, un peu comme s’il n’était pas chez lui. C’est le domaine exclusif des femmes et il ne convient pas qu’un homme flâne au milieu d’elles.
La famille étant patriarcale, l’homme règne sur la maison, mais du fait de ses absences, il ne gouverne pas.3
Etant dans l’impossibilité de parler, et du fait d’absences plus fréquentes des hommes, les femmes parvenaient à construire une place dans le coin le plus restreint de l’ordre dominant. Elles adoptent d’autres manières pour briser les murs du silence et dévoiler leur existence à savoir les contes, la poésie, la danse ; tout un réservoir de traditions que chaque femme engendre en elle-même.
La femme gardienne de la tradition et de la mémoire :
Le mode de vie des milieux traditionnels met en évidence une société uniquement masculine où la femme algérienne a connu toutes sortes d’infériorisation et d’oppression, mariage arrangé et forcé par les familles, soumission au père, au mari, au frère, répudiation pour stérilité ou simplement pour incapacité de donner un fils. En fait, l’exclusion de la femme du champ productif et du monde extérieur renvoie d’une part à l’ensemble des préjugés à l’encontre de la femme, d’autre part au projet colonial qui vise la dislocation des composantes nationales à savoir la langue, la religion, les structures traditionnelles et l’identité nationale à travers la femme pour la construction d’une Algérie- française.
Ainsi, parmi les structures nationales les plus ciblées était l’Islam en tant que la source de toutes les relations sociales. Aux yeux de l’occupant les femmes algériennes souffrent de l’oppression imposée par les lois et les coutumes musulmanes comme le voile qu’il fallait combattre parce qu’il représente une partie intégrante des traditions nationales.
Frantz FANON explique le secret qui cache le port du voile. Loin d’être seulement l’adhésion à la tradition ancestrale, le voile forme aussi une arme de combat signifiant un refus de la structure coloniale. « On se voile par tradition, par séparation rigide des sexes, mais aussi parce que l’occupant vient dévoiler l’Algérie ».4
Pour la femme algérienne le maintien du voile constitue un mode de résistance à une modernité qui n’est pas la sienne, un mode de défense pour le maintien de son identité menacée d’être effacée une fois dévoilée.
Face à cette résistance le pouvoir colonial concentre toutes ses capacités, mobilise toutes ses institutions et organise ses rangs pour l’affronter. Chaque femme qui se dévoile représente aux yeux du colonisateur un signe d’effacement de l’identité algérienne. Dans cette optique Frantz FANON écrit :
Chaque nouvelle femme algérienne dévoilée, annonce à l’occupant une société algérienne aux systèmes de défense en voie de dislocation, ouverte et défiante. Chaque voile qui tombe, chaque corps qui se libère de l’empreinte traditionnelle du haïk, chaque visage qui s’offre au regard hardi et impatient de l’occupant, exprime en négatif que l’Algérie commence à se renier et accepte le viol du colonisateur.5
Alors, le voile est rapidement devenu un symbole de lutte. Il fallait renforcer toutes les conduites traditionnelles qui maintiennent la femme à l’abri de la société, parce qu’elle représente l’instrument de la tradition et la mémoire révélatrice de l’histoire collective. Et en tant que gardienne d’un savoir et d’un héritage ancestral, et responsable de son prolongement et de sa transmission, elle devait rester attachée à ses traditions comme l’arbre à sa terre.
Et même s’il y avait quelques cas de femmes qui travaillaient durement comme femmes de ménage, ouvrières agricoles aux champs, leur situation n’était pas différente de celle des autres femmes attachées à leurs logis. En mettant l’accent sur la condition de la femme qui travaille traditionnellement, Djamila AMRANE écrit :
Dans les familles modestes ou pauvres, lorsque la femme est obligée de travailler, elle essaie toujours dans une première étape de trouver un emploi domicile. Elles cousent, brodent, crochètent, tricotent sous-payées. […] lorsque contrainte par la misère une femme décide de travailler hors de la maison, son premier souci est de rester à l’écart du monde masculin.6
En conséquence, la femme algérienne traditionnelle a vécu dans une situation insupportable et dramatique dans un double colonisation, extérieure représentée dans le pouvoir colonial, et intérieure sous le règne de l’homme.
Il fallait attendre le 01 novembre 1954 pour qu’un autre soleil brille dans le ciel de la femme algérienne et de toute l’Algérie.
Un tableau représentatif du statut de la femme algérienne par rapport à l’homme s’avère nécessaire pour la compréhension de leur réel traditionnel vécu :
| Tableau comparatif des statuts traditionnels | |
|---|---|
| Statut traditionnel de l’homme | Statut traditionnel de la femme |
|
|
________________________
1 Sonia RAMZI-ABADIR, La Femme arabe au Maghreb et au Machrek, fictions et réalités, Alger, ENAL, 1986, p.92. ↑
2 Jean-Paul CHARNAY, La Vie musulmane en Algérie, Paris, PUF, 1965, p.20. ↑
3 Naffissa ZERDOUMI, cité par Lotfi MAHERZI, in Le cinéma algérien, Alger, SNED, 1985, p.264. ↑
4 Frantz FANON, cité par Lotfi MAHERZI, Op.cit. p. 265. ↑
5 Frantz FANON, cité par S. RAMZI ABADIR, Op.cit. p. 59. ↑
6 Danièle Djamila AMRANE, Femmes au combat, Alger, Rahma, 1993, p. 25. ↑