La valeur de l’être féminin en Algérie est analysée à travers l’œuvre de Mohammed Dib, mettant en lumière les représentations de la femme dans ‘La Grande maison’ et ‘Un Été africain’. Cette étude révèle les tensions entre l’imaginaire collectif et la réalité sociale, ainsi que l’évolution du statut féminin.
4 – Valeur de l’être dans l’imaginaire algérien :
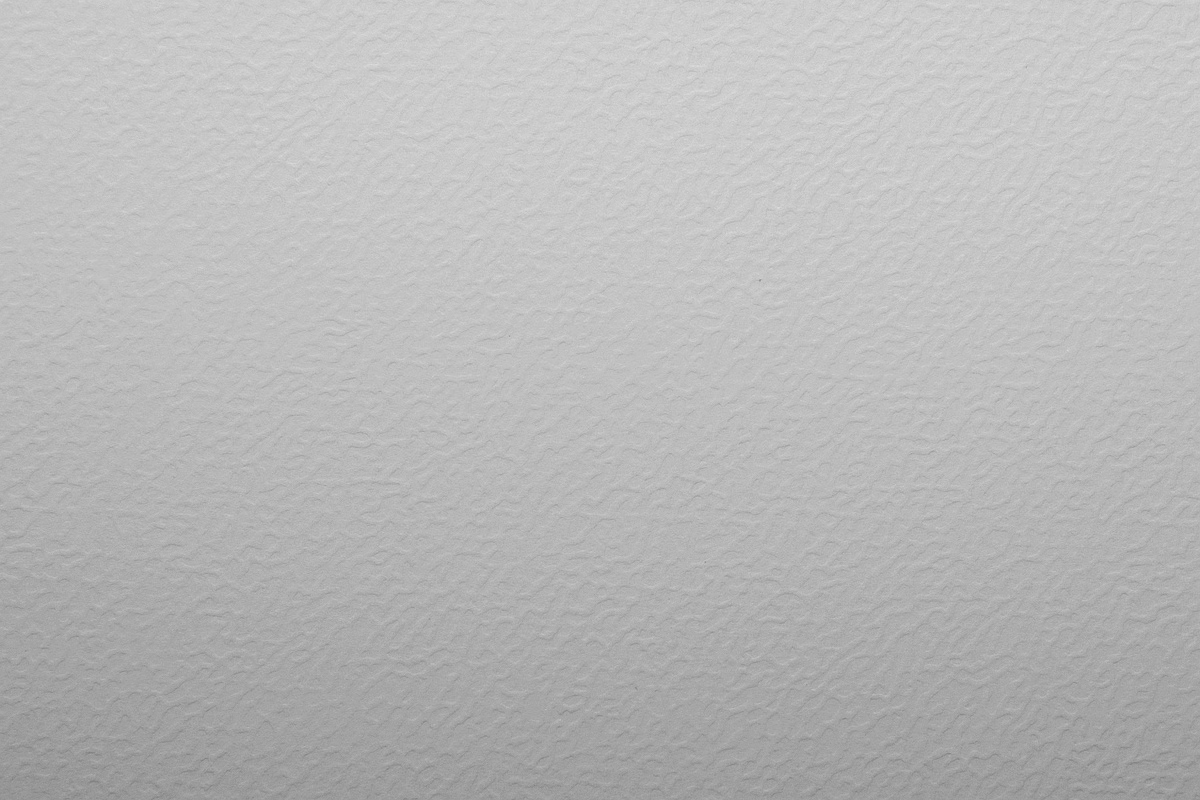
L’univers de l’être algérien reste un monde aux contours strictement définis par un réseau très complexe de valeurs et de représentations qui gèrent et structurent les relations de cet être avec ses semblables.
À tort ou à raison, il est admis dans les contingences du moment présent que l’être féminin dans sa communication avec l’être masculin est le plus souvent soumis à des visions antinomiques et disparates, qui s’inscrivent dans la mouvance continue du tissu charnel d’une culture dite populaire et collective et qui puisent leur sève dans ces représentations, péjoratives, dévalorisantes et dangereuses comme les préjugés, les stéréotypes qui déprécient, et excluent les femmes en référence à leur sexe. Réflexion et différenciation hâtives, car le plus souvent fondées sur la seule distinction biologique et physiologique.
4 -1- Image / valeur de l’être masculin dans l’imaginaire algérien :
Celui qui franchit l’imaginaire collectif algérien, remarque qu’il accorde un espace et une valeur trop importants à l’être masculin.
En effet, dès qu’une femme se marie, le premier vœu pour elle, et l’ultime devoir qu’elle doit accomplir c’est d’accoucher d’un garçon, qui va conquérir ce monde avec un réservoir de chance. Et depuis sa naissance, cet être doté de force, d’amour va changer le devenir et l’avenir de sa famille parce qu’il est le symbole de l’honnêteté et la dignité, et celui qui va porter le flambeau de la pureté et l’éternité de sa famille, de sa race.
Ainsi, pour annoncer la naissance d’un garçon on emploie plusieurs locutions pour signifier le mérite du père dont le nouveau-né est «un vrai homme » ; ce mérite s’amplifie au fur et à mesure que grandit sa descendance masculine. De même, on trouve dans l’imaginaire collectif algérien plusieurs images et représentations glorifiant cet être tels que « le logis sans moustache, le bien en s’enfuit.
». Autrement dit, tout le bien est d’avoir un homme dans la maison, car la maison où manque l’existence d’un homme, d’un sexe masculin va être un logis où le bien n’existe plus. Aussi, au moment où les ennuis s’entassent, il vaut mieux se réfugier sous l’ombre d’un homme car : « l’ombre d’un homme est mieux que l’ombre d’un mur.», dans la mesure où l’homme est le symbole du courage, de la force, il est plus dur qu’un mur.
D’ailleurs, il est dit dans l’univers collectif algérien que la femme qui n’enfante que des garçons est un porte- bonheur pour sa famille, alors que celle qui n’enfante que des filles ou qu’est stérile demeure un porte malheur qui finit généralement par être répudiée comme l’affirme Radia TOUALBI :
En Kabylie, par exemple et jusqu’à l’heure actuelle, il est assez courant que soit répudiée une épouse qui n’enfante que des filles, cependant qu’en règle générale l’est automatiquement la femme stérile, incapable d’assurer à la famille de l’époux une descendance vitale à la pérennité du sang.1
Dans cette optique, il s’avère tout à fait clair et évident que l’homme se taille la part du lion dans l’imaginaire collectif algérien, au détriment de la femme qui reste toujours culpabilisée sans pour autant impliquer l’homme, comme si elle était autre chose que le complément et le compagnon de l’homme sur terre.
4 -2- Image et valeur de l’être féminin dans l’imaginaire algérien :
L’univers de la femme algérienne demeure une voie longue, opaque, bornée par les valeurs et les représentations que lui dessine l’imaginaire collectif. Un univers dans lequel sont échangés des rapports de violences et de discriminations entre les hommes et les femmes. En effet, cette séparation et cette fracture entre la femme et l’homme incombent surtout aux représentations symboliques dispensées par l’imaginaire collectif, comme le précise Farouk Beloufa :
Il est impossible de parler dans la société arabe du nœud le plus violent de la contradiction, sans passer par le point névralgique, sans parler des femmes. Elles construisent le monde le plus riche, le plus complexe et le plus productif des transformations, ce sont elles qui vivent dangereusement l’oppression et la décadence dans laquelle les a plongées la société et les représentations depuis des siècles.2
Dans cette perspective, le monde féminin représente le miroir qui reflète et avec loyauté le malheur et le chagrin que vit toute femme à cause des représentations de l’imaginaire collectif. Ce dernier véhicule des images stéréotypées et tronquées instituant l’infériorité de la femme, et incarnant un véritable obstacle à sa participation au développement humain. C’est pourquoi dans la plupart des cas, le sexe masculin opte pour des préjugés et des attitudes antinomiques et hostiles envers le sexe féminin défavorisé, comme concrétisation de ces représentations.
En outre, les proverbes algériens dessinent des images assez négatives et archaïques dans lesquelles la femme est souvent dépréciée, chosifiée et minorée. Telles que « la mère des filles est dans les soucis jusqu’à la mort. » ou « le pauvre et le père d’une fille doivent baisser le nez » autrement dit, celle ou surtout celui qui a au moins une fille, est condamné à mort par les soucis, par la honte. De ce fait, il faut élever la fille dès qu’elle est petite – tout comme une rose- pour en faire une femme idéale, obéissante, travailleuse et discrète, pour ne pas se blesser par ses épines. Ainsi, c’est à la maison qu’elle doit travailler, car « la femme qui se ballade ne file pas la laine ». L’imaginaire collectif fait de la maison le meilleur et le seul milieu natal de la femme, car en dehors ce n’est qu’une traînarde inutile.
De leur côté, les hommes s’échangent entre eux d’intéressants conseils comme : « demande l’avis de ta femme, mais méfie-toi d’en tenir compte », parce que l’avis d’une femme est évidement une conduite d’échec. De même, en crachant son hypocrisie et ses flatteries, « le marché des femmes est un marché perfide, tu y entreras, et tu en sortiras les mains vides. », donc il ne faut pas mettre le nez dans tout ce qui concerne l’univers féminin.
Aussi, parmi les contes étiologiques3 qui engendrent cette idée d’hypocrisie et de flatterie des femmes citons le mythe de la femme et le hérisson qui raconte qu’il y avait une fois, une femme qui vit un hérisson roulé en boule de piquants, elle lui demanda de lui montrer son beau visage et quand il lui obéissait, la femme le cautérisait sur le front pour qu’il ne se roule plus jamais, et pour qu’elle puisse l’égorger. Mais le hérisson s’enfuit malgré les brûlures en criant : « les femmes, les femmes et leurs brûlures ne s’oublient pas. ». Depuis ce jour-là, sur le front du hérisson resterait cette cicatrice blanche.
Il y a plusieurs mythes qui racontent l’inimitié entre la femme et l’hérisson. Ainsi un jour le hérisson dit au loup : « méfie-toi de la femme ! », le loup lui répondit : «est-ce la petite ? Ou l’adulte ? » Le hérisson dit : « les deux…les deux. ». C’est l’un des mythes qui confirme qu’il ne faut pas se confier à la femme quelque soit son âge, petite ou âgée car elle est toujours malfaisante et traître, et c’est pourquoi : « frappe ta femme, si tu ne sais pas pourquoi ? Elle sait pourquoi ? ». Comme si toute femme cachait sous son minois la laideur et la trahison.
D’ailleurs, cette image négative de la femme ne relève pas seulement de l’imaginaire collectif algérien, puisqu’elle est à l’image de beaucoup de cultures et de nombreuses époques, où la femme était marginalisée et soumise à l’homme. Ainsi à Athènes, aux Vème et IVème siècles, les femmes étaient considérées comme des machines qui n’ont aucun rôle, sauf le ménage et la reproduction de l’espèce.
À Sparte, écrit M. Troplong : On mettait à mort cette malheureuse créature qui ne promettait pas à l’État un soldat vigoureux.4
Elles doivent se tenir à l’écart de la vie de la cité, Jean-Marie PAILLER écrit :
Les Grecs veulent que les jeunes filles vivent comme la plupart des artisans, qui sont sédentaires, et qu’elles travaillent la laine entre quatre murs.5
Laquelle situation a été vécue aussi à Rome, où :
Les femmes romaines sont exclues de tout pouvoir et confinées dans un rôle de subordination et de dépendance en matière religieuse comme dans les domaines de la vie privée et de la vie politique.6
De même, les hindous, les grecs et les romains, n’étaient pas plus pitoyables avec la femme, d’où la loi indienne de Manou proclame :
La femme pendant son enfance dépend de son père, pendant sa jeunesse de son mari ; son mari mort, de ses fils ; si elle n’a pas de fils, des proches parents de son mari, car une femme ne doit jamais se gouverner à sa guise.7
D’ailleurs, les proverbes de tous les peuples témoignent de cette réalité amère que vit la femme, ainsi le Chinois conseille : « Il faut écouter sa femme et ne jamais la croire »8. Le Russe assure « qu’en dix femmes il n’y a qu’une âme. »9. L’Italien de sa part voit que « l’emploi de l’éperon pour un bon comme pour un mauvais cheval, et du bâton pour une bonne comme pour une méchante femme»10. Au moment où l’Espagnol recommande de « se garder d’une mauvaise femme, mais de ne pas se fier à une bonne »11.
La femme subissait incessamment les sarcasmes de l’homme jusqu’au domaine religieux où elle constituait même un bon sujet de moqueries. Ainsi, BAUDELAIRE s’interroge encore pour savoir si la femme a le droit de pénétrer dans l’église et faire ses prières en disant : « j’ai toujours été étonné qu’on laissât les femmes entrer dans l’église. Quelle conversation peuvent-elles tenir avec Dieu ? »12 Comme si la femme était une mare de péchés qui ne mérite pas d’être purifiée, ou un diable qui ne peut pas supplier la miséricorde divine et seulement promis à l’enfer.
Le clivage social faisait de la femme l’être méprisé, apparent sous toutes ses formes et dans les divers milieux, enseignement, travail et pratiques religieuses. Ainsi, privée de liberté, d’instruction et même de ses droits et devoirs religieux, la femme reste dans de nombreuses sociétés et depuis des siècles, enfermée dans les images et les représentations qui entravent sa possible libération.
Et malgré l’existence de quelques proverbes qui apprécient la femme et se vantent de sa valeur, comme « celui qui n’a des filles, les gens ne savent pas quand il est mort. » pour montrer le mérite de celui qui a une fille, car c’est elle qui reste à la maison et gère toutes ses responsabilités alors que le garçon se trouve toujours en dehors de la maison. Toutefois, cette image positive de la femme demeure rare dans l’imaginaire collectif algérien, car le plus souvent c’est l’image négative qui est la plus répandue.
À tort ou à raison, il est perçu aujourd’hui que certaines voix dénoncent la condition malheureuse de la femme algérienne et de la femme arabe d’une façon générale, en culpabilisant l’Islam d’être le responsable et le gérant de cette situation, et le propagateur de ces images négatives, tout en se référant dans leurs jugements à la question de la polygamie, de l’héritage, du divorce, et de l’égalité entre l’homme et la femme dans l’Islam. Toutefois, l’étude contextuelle et sociale de la condition de la femme avant et après l’avènement de l’Islam, ainsi du statut que réserve ce dernier aux femmes, sert bel et bien à montrer le rôle que joue l’Islam dans la valorisation et l’avancée de la femme.
________________________
1 Radia TOUALBI, Les Attitudes et les représentations du mariage chez la jeune fille algérienne, Alger, ENAL, 1984, p. 51. ↑
2 Noël Burech, La Drôle de guerre des sexes du cinéma français1930-1956, Paris, Nathan, 1996, P. 04, in http://www.Limage.refer.org/thèses/Darmoni/Darmoni.htm. ↑
3 Conte étiologique : récit oral ou écrit qui explique les origines et le pourquoi des choses en y répondant d’une manière imagée et fantaisiste. ↑
4 Gustave LE BON, La Civilisation des Arabes, Livre IV : Les Mœurs et les institutions des Arabes, Paris, Le Sycomore, 1980.p.92 Cité in : http://classiques.uqac.ca/classiques/le_bon_gustave/civilisation_des_arabes/civilisation_arabes.html ↑
5 XENOPHON, La République des lacédémoniens, in http://ugo.bratelli.free.fr/Xenophon/ XenophonLa RepubliqueDesLacedemoniens.htm ↑
6 Jean-Marie PAILLER, Marginales et Exemplaires. Remarques sur quelques aspects du rôle religieux des femmes dans la Rome républicaine, Ed Clio, numéro 2-1995, Femmes et Religions, in : http://clio.revues.org/index487.html ↑
7 Gustave LE BON, Op. Cit. p.93 ↑
8 Ibid. ↑
9 Ibid. ↑
10 Ibid. ↑
11 Ibid. ↑
12 Charles BAUDELAIRE, cité par Mohamed MESLEM, in Op. Cit. P.33. ↑