La représentation de la femme en Algérie est analysée à travers l’œuvre de Mohammed Dib, notamment dans ‘La Grande maison’ et ‘Un Été africain’. Cette étude met en lumière l’évolution du statut féminin dans l’imaginaire collectif et la réalité sociale algérienne.
PARTIE I
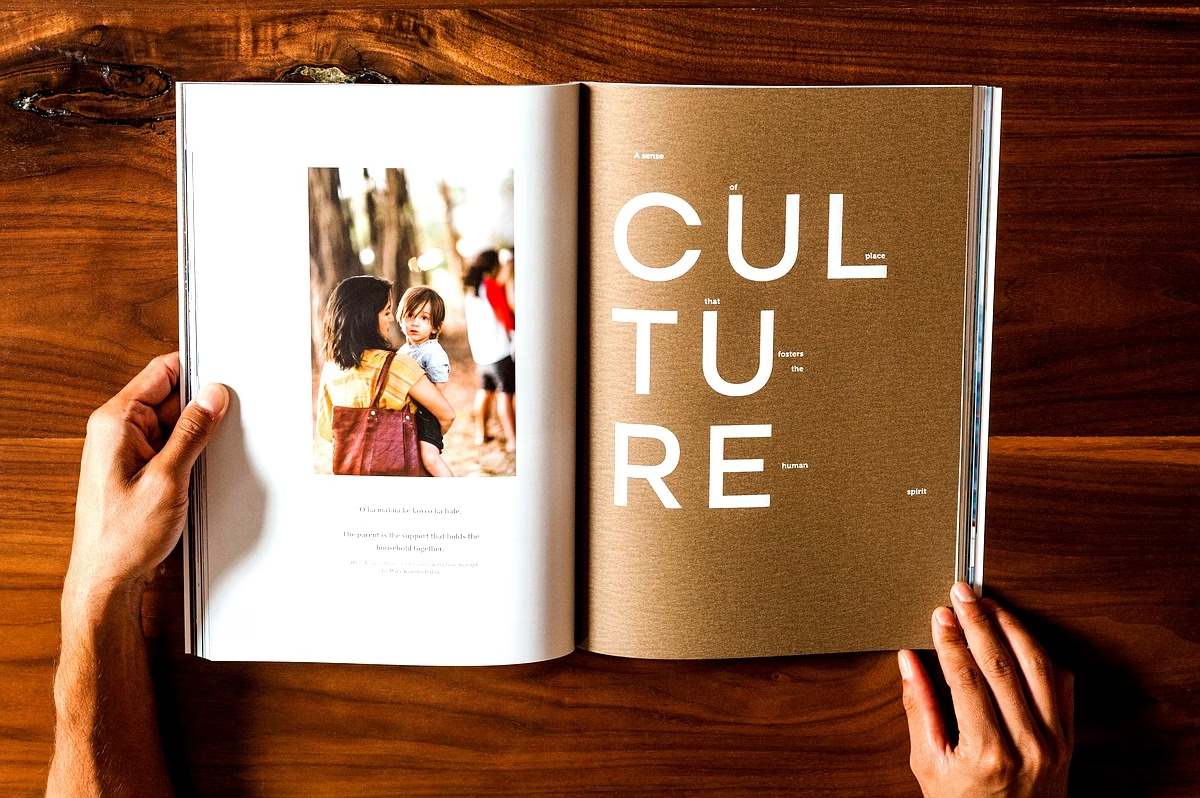
L’ETRE : DE L’IMAGINAIRE COLLECTIF AU RÉEL VÉCU
Chapitre 01
De L’imaginaire collectif
Depuis des millénaires, les civilisations s’élèvent, s’épanouissent, s’influencent, puis s’éteignent, en donnant naissance à des nouvelles civilisations qui se définissent par leurs spécificités propres (Histoire, croyances, religion, culture).
En fait, l’élément qui reste le plus considérable, le plus instituant de toute civilisation est sans doute la culture, définie dans son sens ethnographique le plus large par Edward Burnett Tylor dans son ouvrage La Civilisation primitive comme : «un tout complexe qui englobe les connaissances, les croyances, l’art, la morale, la loi, la tradition et toutes autres dispositions et habitudes acquises par l’homme en tant que membre d’une société »1.
Or dans la mesure où il est par définition un être culturel et social, l’être humain, cet être doué ne peut pas vivre en isolement éternel et il prévoit la nécessité de communiquer avec l’autre pour s’exprimer. Il construit ainsi un groupe auquel il appartient, partageant les mêmes valeurs, coutumes, traditions.
Ainsi, chaque groupe humain en tant qu’unité sociale construit un imaginaire qui lui est propre. Ce dernier apparaît comme une unité spirituelle, marquant par sa naissance et son évolution, les différentes étapes par lesquelles passent les sociétés depuis leur naissance.
De ce fait, qu’est-ce qu’on entend par l’imaginaire ? D’où vient-il ? Qu’est-ce qu’un imaginaire collectif ? Peut-on parler d’un imaginaire personnel ?
Définition de l’imaginaire :
La notion d’imaginaire est une notion polysémique trop vague, parce qu’elle renvoie à une multitude de sens, selon les points de vue adoptés par les différents écrivains, ou selon les champs théoriques qui y renvoient. En fait, on peut considérer l’imaginaire dans son sens le plus large, comme la capacité d’un groupe ou d’un individu à se représenter le monde par le biais d’une mosaïque d’images qui lui donnent un sens. Selon Joël Thomas l’imaginaire est conçu comme :
Un système, un dynamisme organisateur des images, qui leur confère une profondeur en les reliant entre elles. L’imaginaire n’est donc pas une collection d’images additionnées, un corpus, mais un réseau où le sens est dans la relation ; comme le disait, dans une belle intuition, le peintre G. Braque, je ne crois pas aux choses, mais aux relations entre les choses. 2
Autrement dit, l’imaginaire forme un réseau d’images bien organisées et reliées entre elles, où chacune ne peut avoir un sens à l’écart de l’autre. Il peut être ainsi considéré comme un produit de la psyché humaine, dans la mesure où il est constitué par une image mentale qui se substitue à la réalité.
L’imaginaire comme une production d’images peut avoir deux activités fondamentales : d’une part, il peut être considéré comme un conservateur de la mémoire, d’autre part, il peut jouer le rôle d’un anticipant de l’avenir comme l’affirme Valentina GRASSI :
L’imaginaire comme une production d’images peut avoir deux fonctions fondamentales : la première de conservation de la mémoire, lorsqu’on évoque des images du passé ; la deuxième d’anticipation de l’avenir, lorsqu’on produit des images qui n’ont pas de référent dans le réel mais qui donnent une vision possible du futur. Cette dernière fonction est ce qui permet à l’imaginaire d’être créateur, et de rendre possible le changement et la mutation soit au niveau individuel soit au niveau social. C’est dans ce sens que l’imaginaire est intimement lié au vécu : imaginaire du passé et imaginaire du futur s’entremêlent et président à l’expressivité et aux conduites sociales.3
D’ailleurs, quand on parle d’imaginaire collectif ou d’imaginaire individuel, on fait appel à deux notions évidemment différentes, mais qui sont tout à fait complémentaires.
- L’imaginaire individuel :
Sur le plan individuel, chaque être humain possède un réservoir d’images stockées dans son esprit, et qui appartiennent à la propriété de son histoire individuelle (fantasmes, rêves). L’ensemble de ses représentations mentales forme l’imaginaire ancré dans la psyché personnelle de l’être et témoigne de sa subjectivité. Notant que cet imaginaire est analysé par la psychologie clinique à des fins thérapeutiques.
Ainsi, l’imaginaire nécessite un échange continu entre la dimension individuelle et la dimension collective, et l’une ne peut pas être sans l’autre. En effet tout imaginaire individuel est enraciné dans l’imaginaire collectif, qui représente un tout composé de divers imaginaires individuels. D’ailleurs, l’univers imaginaire et symbolique d’un groupe ou d’une société est toujours cerné symboliquement par ses sujets.
Et à partir de l’individu, de son imaginaire, s’élève la dimension collective de l’imaginaire.
L’imaginaire collectif :
La notion d’imaginaire collectif et celle d’imaginaire social sont généralement utilisées indifféremment. Même si F. Giust-Desprairies vise par l’imaginaire collectif celui qui se réfère au groupe social, alors que l’imaginaire social est celui qui renvoie à la masse, à la société. Toutefois, les distinctions terminologiques ne sont que des reflets d’un même phénomène complexe.
Lorsqu’on parle d’imaginaire collectif, selon F. Giust-Desprairies, on « se réfère aux constructions imaginaires des groupes socio-réels». À cet égard, l’imaginaire collectif peut être considéré comme l’ensemble des significations imaginaires émises par un groupe et qui sont conservées et transformées tout au long de l’histoire humaine. F. Giust-Desprairies ajoute :
L’imaginaire collectif désigne un ensemble d’éléments qui s’organisent en une unité significative pour un groupe, à son insu. Signification imaginaire centrale qui constitue une force liante, un principe d’ordonnance pour le groupe dans le rapport que ses membres entretiennent à leur objet d’investissement commun, en situation sociale.4
Chaque groupe humain construit et partage un imaginaire collectif qui lui est propre. Il engendre toutes les représentations imaginaires communes qui trouvent leur source dans cet imaginaire collectif, et qui peuvent être transmises socialement et mentalement, comme les symboles, les gestes, les pratiques symboliques, les croyances, les traditions, les valeurs, les coutumes, les mythes. Ces derniers naissent également d’un besoin capital pour le groupe pour construire son imaginaire collectif. Dans ce sens Émile Durkheim affirme que :
« les mythes expriment la façon dont la société se représente l’humanité et le monde, et constituent un système moral, une cosmologie et une histoire »5. De ce fait et en tant que garant de la moralité, l’imaginaire collectif peut être compris comme une fonction essentielle de la société humaine, destinée à guider l’individu pour exprimer ses idées, et pour s’affirmer.
En outre, l’imaginaire collectif est un phénomène humain entièrement symbolique, c’est un système de communication très complexe de représentations symboliques, structurées par des relations et des valeurs : traditions, religion, loi, politique, éthique, qui seront gravées dans la conscience profonde de chacun et qui dirigeront son comportement dans toutes ses relations. Autrement dit, chaque imaginaire met en exergue un ensemble spécifique de symboles en lequel s’identifient l’individu et la société entière. C’est ce qu’affirme Serge MOSCOVICI : « Les représentations sociales sont des modalités de pensée pratiques orientées vers la communication, la compréhension et la maîtrise de l’environnement sociale, matériels et idéal. »6.
À cet égard, l’imaginaire doit se référer au symbolique, c’est-à-dire aux significations que la société donne à ses éléments, pour passer du fictif au réel. Ce rapport établi entre le symbolique et l’imaginaire constitue l’univers de l’imaginaire collectif d’une société quelconque et il est en fait le complément de son ordre social.
L’imaginaire collectif algérien :
Comme toute société, la société algérienne, depuis son passé millénaire se caractérise par le fait d’être une société plurielle, qui détient un imaginaire collectif très riche, résultant de l’interférence de l’imaginaire des groupes sociaux qui la constituent. Il y a autant d’imaginaires algériens que d’ethnies, de régions, de classes et chacun possède son propre imaginaire comme les kabyles, les Chaouis, les Arabes, les Touaregs… Ce qui fait que l’imaginaire collectif algérien apparaît insaisissable tant son visage est multiple.
Toutefois, il peut être vu comme le moule social, qui regroupe l’ensemble des idées, signes, images, coutumes, habitudes, gestes et dispositions largement répandues et partagées au sein de la culture algérienne, de même que la symbolique commune, l’idéologie sociale et les autres systèmes de signification.
D’ailleurs, la présence de ces composantes humaine, historique, et culturelle trop variées, peut se voire comme une arme à double tranchant. D’une part, elle représente une richesse, une force liante et résistante infinie qui lie une société entière pour exprimer sa façon de concevoir sa relation à l’altérité, et au monde entier.
Comme s’était le cas pendant la période de la colonisation française, où la société algérienne colonisée, exploitée et humiliée durant 132 ans, c’est vue comme une masse révoltante contre l’aliénation et pour l’affirmation de sa liberté. C’est la communauté humiliée qui revendique et libère son imaginaire collectif. D’autre part, cette diversité de groupes, en fait d’imaginaires peut mettre la société algérienne en cause, parce qu’elle peut influencer les comportements des individus et peut instaurer des rapports imaginaires gênants entre les différentes personnes, comme le sexisme.
Elle incarne l’image d’une société de contrastes sans unité, sans noyau, une société morcelée, minée par les tensions raciales instaurées par l’imaginaire. C’est ce qu’affirme Valentina GRASSI :
L’univers imaginaire d’un groupe, comme celui d’une société, peut produire des dérives perverses et dangereuses et nous avons des témoignages historiques exemplaires de ce grand pouvoir, souvent oublié (les exterminations de masse au nom d’idées abstraites d’origine imaginaire). Mais, comme G. Durand affirme, c’est surtout l’absence d’une pédagogie diffusée de l’imaginaire qui laisse la place au pouvoir destructeur des principes imaginaires incontrôlés, ou plutôt aux mythes totalitaires.7
À vrai dire, ce mythe de l’opposition des races dont les répercussions sont vécues jusqu’à présent, puise sa sève beaucoup plus dans l’idéologie coloniale, qui l’enflammait dans le but de diviser pour régner, pour obtenir un consensus pour légitimer son pouvoir. De même, un phénomène largement répandu dans l’imaginaire collectif algérien consiste à établir des distinctions entre les sexes, entre être masculin et être féminin.
C’est là, une des structures profondes de l’imaginaire collectif algérien qui occupe au plus haut degré le plus grand nombre de collectivités nationales. Or cette problématique de l’être, de la distinction et la différenciation entre les deux sexes, n’est pas relative seulement à l’imaginaire collectif algérien, car elle est née de l’histoire et répandue dans toutes les sociétés.
Problématique de l’être :
À vrai dire, la question de l’être humain est depuis toujours un champ privilégié d’études et de recherches pour les différents écrivains et disciplines, ce qui fait naître toute une discipline qui s’en occupe : c’est l’ontologie ou la science de l’être, dont les interrogations s’articulent généralement autour la spécificité de cette espèce humaine : à savoir qu’est ce qui fait la particularité de l’être humain ? Est -ce particulièrement la « doxa » ou la « praxis » ? L’histoire humaine n’a-t- elle pas spécifié ou réduit la conception de l’être aux critères d’ordre physiologique (la force à titre d’exemple) ; et par la même privilégié l’être masculin au détriment de l’autre sexe “féminin” ?
Toutefois, et dans la mesure où l’être féminin est à la fois identique et différent de l’être masculin, toute la difficulté consiste à définir ce qui constitue leur identité et leur différence. Luce Irigaray affirme : « La différence est un principe existentiel qui concerne les manières de l’être humain […].La différence entre femme et homme est la différence fondamentale de l’humanité »8.
À cet égard, la différence entre l’être masculin et l’être féminin est la source de l’humanisation. Les spécificités de chacun d’eux, apportent le bien commun de l’humanité. A ce bien commun, tous deux, l’homme et la femme font également leur contribution propre, en échange et en complémentarité comme affirmation de leur égalité ; tous deux sont pareillement des personnes.
De même, l’identité des sujets s’inscrit plus dans un univers d’hétéronomie que dans un univers d’autonomie. Dans ce sens, Luce Irigaray va plus loin encore :
« Vouloir supprimer la différence sexuelle, c’est appeler un génocide plus radical que tout ce qui a pu exister comme destruction dans l’histoire »9. C’est pourquoi la dichotomie Masculin/Féminin se présente comme le paradigme originaire de toute différence. Ils représentent deux pôles d’une même sphère et c’est dans l’articulation de leurs rapports que la dynamique sociale s’accomplit. En revanche, la relation de l’être masculin à l’égard de l’être féminin est généralement gérée par les valeurs et les représentations que l’imaginaire collectif donne à voir de chacun d’eux. Ainsi, l’imaginaire collectif algérien est assez riche de représentations et d’images, où être femme ou être homme a dans la plupart des cas ses avantages et ses inconvénients au sein de ces représentations.
________________________
1 Edward Burnett TYLOR, La Civilisation primitive, Paris, Mauss, 1995, cité par DENIS Laborde, « Editorial », Socio-Anthropologie, N°8, Cultures-Esthétiques, 2000 in : http://socioanthropologie.revues.org/document116.html. ↑
2 Thomas JOEL, Introduction aux méthodologies de l’imaginaire, Paris, Ellipses, 1998.In http://fr.wikipedia.org/wiki/Imaginaire. ↑
3 Valentina GRASSI, Rationalité et Imaginaire dans la pensée humaine, in : http://www.ceaq-sorbonne.org/node.php?id=1121&elementid=804&PHPSESSID=dae3a5f91f36bb1f62c29773a685a829 ↑
4 Ibid. ↑
5 Émile DURKHEIM, in : »Mythologie. » Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008. ↑
6 Serge MOSCOVICI, La Psychanalyse, son image et son public, Paris, PUF, 1961. p. 46 in : http://perso.orange.fr/jacques.nimier/livre_imaginaire_collectif.htm ↑
7 Valentina GRASSI, Rationalité et Imaginaire dans la pensée humaine, in : http://www.ceaq-sorbonne.org/node.php?id=1121&elementid=804&PHPSESSID=dae3a5f91f36bb1f62c29773a685a829 ↑
8 Luce IRIGARAY, Je, tu, nous, Paris, Grasset, 1990, in http://www.philo5.com/Mes%20lectures/Bosio-Zancarini_FemmesEtFieresDeL’Etre.htm ↑
9 Ibid. ↑