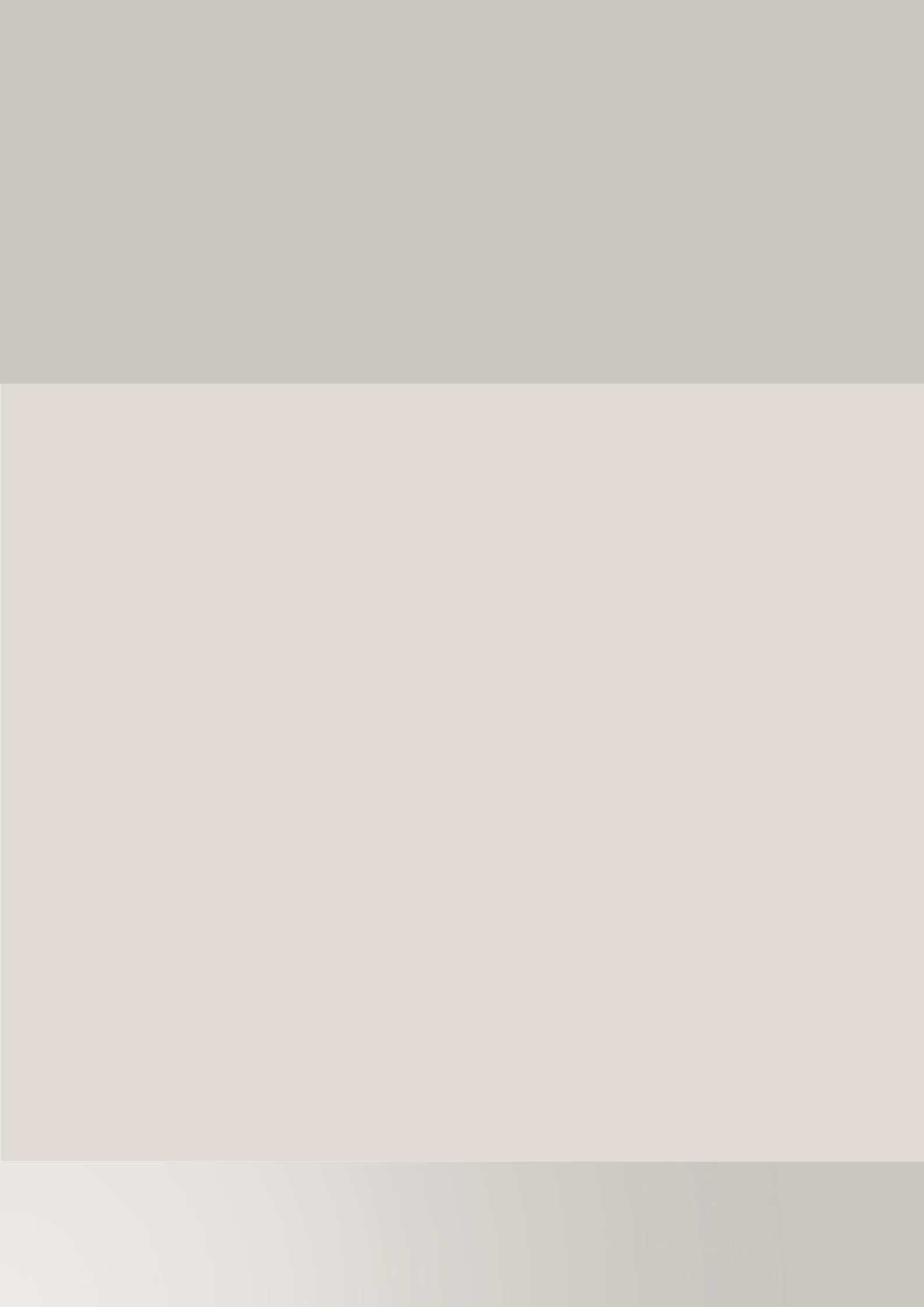Les risques environnementaux en entreprise sont analysés à travers la définition et la classification des impacts sur les écosystèmes. Ce mémoire propose une méthodologie pour les responsables QSE afin de mettre en place un système de management intégré, tout en respectant les normes juridiques et l’économie circulaire.
PRÉVENTION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX 52

[img_1]
DÉFINITION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX
Toute organisation, par le simple exercice de son activité, produit un impact sur son environnement naturel et humain.
Le risque environnemental comporte deux types de risques distincts :
- le risque environnemental au sens strict d’« écosystème », qui porte atteinte au milieu naturel (faune et flore) et à la biodiversité du fait de la présence de substances dangereuses dans l’air, l’eau ou le sol
- le risque pour la santé des populations humaines, potentiellement exposées à la présence de polluants dans leur environnement quotidien, appelé aussi risque sanitaire
Le concept de risque environnemental se fonde sur une approche structurée autour des impacts potentiels, générant une place importante accordée à la logique de réparation.
Chaque entreprise, du fait de son activité, peut être à l’origine d’une pollution, même si son activité semble à moindre risque.
Où qu’elle se situe, l’entreprise peut générer des émissions polluantes qui seront diffusées ou se disperseront dans l’environnement pour atteindre une cible.
Ces risques liés à l’environnement ne concernent donc pas uniquement les entreprises soumises à autorisation qui doivent impérativement mettre en place des mesures de prévention et de protection pour pouvoir exercer leur activité.
Par conséquent, les risques environnementaux concernent aussi bien les TPE et PME que les grands groupes ou les collectivités et ce, quelle que soit leur activité.
En France, c’est d’abord la notion de « risques majeurs » qui structure les politiques publiques de gestion, à laquelle est associé ensuite le concept de « risque environnemental ».
Le risque majeur structure la gestion autour de la source du risque, c’est-à-dire l’événement dangereux qui peut survenir.
La politique française concernant la gestion des risques majeurs s’appuie sur une réflexion principalement centrée sur la maîtrise supposée du risque, pour éviter que ne surviennent des catastrophes industrielles ou pour en limiter les conséquences.
Les 7 principes de prévention des risques majeurs :
- La connaissance des phénomènes, de l’aléa et des risques
- La surveillance, la prévision et l’alerte
- L’information préventive et l’éducation des populations
- La prise en compte des risques dans l’aménagement et l’urbanisme
- La réduction de la vulnérabilité
- La préparation et la gestion de crise
- La gestion de l’après-crise et le retour d’expérience
Quant au risque technologique majeur, dû à l’activité humaine, il correspond à la menace d’un événement de grande ampleur lié à la manipulation, au stockage ou au transport de substances dangereuses et dont on craint des conséquences graves, immédiates ou différées, pour l’homme et l’environnement, à savoir :
- le risque nucléaire
- le risque industriel (principalement généré par l’utilisation de substances chimiques)
- le risque de transport de matières dangereuses
- le risque de rupture de barrage
Section II :
RESPONSABILITÉ PÉNALE DE L’EMPLOYEUR EN CAS DE POLLUTION
En complément des notions abordées en page 37(#SANCTIONS), il convient d’apporter des précisions quant aux sanctions propres à l’environnement.
En France, la règlementation environnementale repose sur une réglementation internationale et Européenne (Code de l’Environnement), des textes sectoriels (par activités) et des arrêtés ministériels et préfectoraux.
Elle fixe des exigences strictes sur les infrastructures, les modes transport et stockage des matières ; et la gestion des déchets.
L’infraction environnementale est l’acte qui enfreint la législation environnementale et entraîne un dommage ou un risque grave pour l’environnement ou la santé humaine.
Le Code de l’environnement précise les sanctions par type d’impact. 53
En cas d’atteintes à l’environnement, ces atteintes sont sanctionnées de façon sectorielle, en fonction des biens environnementaux concernés (eau, air, sol, parcs nationaux, sites classés, réserves naturelles, etc)
C’est à la fin de chaque livre que sont indiquées les sanctions (ou dispositions)
(Ex : Livre IV Patrimoine Naturel – Titre Ier Protection – Chapitre V Dispositions pénales – Section 2 Sanctions)
Les sanctions pénales concernent 4 types de comportements dangereux, régis par les articles suivant :
- la pollution des eaux : article L432-2, articles L216-6 et L216-8
- la pollution atmosphérique : articles L220-1, L226-9 et 10
- la production ou la détention de déchets industriels : articles L541-46 et 541-47, R541-76 à R541-82
- les installations classées pour l’environnement : articles L514-9 et suivants (10, 11, 12 et 18)
En ce qui concerne le bruit, le Code de la Santé Publique prévoit les sanctions à cet effet.
Les infractions de chacune de ces réglementations conduisent à une sanction pénale propre allant de la simple amende (contravention) à une peine d’emprisonnement (délit ou crime) : 54
[img_2]
En vertu du principe « pollueur-payeur », la responsabilité environnementale oblige l’exploitant pollueur à réparer les dommages écologiques qu’il a causés à l’environnement du fait de son activité professionnelle.
En cas de menace imminente de dommage, ou lorsqu’un tel dommage est survenu, l’exploitant est tenu d’informer le Préfet et de prendre, à ses frais, les mesures de prévention ou de réparation appropriée ; car l’obligation de l’exploitant est une obligation d’agir.
Cependant, cette réparation en nature n’exclut pas la possibilité pour le juge de fixer un montant d’indemnisation, soit pour compléter la réparation en nature, soit parce que les atteintes à l’environnement sont irréversibles, ayant entraîné, par exemple, la disparition de certaines espèces.
Pour considérer qu’une entreprise peut être à l’origine d’un risque environnemental, trois éléments sont étudiés :
- Une activité source : par exemple du stockage d’hydrocarbure ou tout simplement l’exploitation d’une usine
- Au moins un vecteur qui va contribuer à diffuser la pollution. Les principaux vecteurs sont l’air, le sol et le sous-sol, les eaux souterraines et les eaux de surface.
- Une cible, soit des victimes potentielles. Il peut s’agir du voisinage, mais aussi de la biodiversité ou plus largement du milieu naturel.
Le préjudice écologique est aussi inscrit au Code civil.
Il est donc essentiel d’intégrer les risques environnementaux dans la stratégie et le management de l’entreprise.