La redistribution du pouvoir linguistique est au cœur de l’analyse du Dictionnaire des francophones, qui se positionne comme un outil politique contre la glottophobie. Cet article explore comment le DDF favorise une nouvelle approche du savoir et interroge les enjeux de gouvernance linguistique.
Redistribuer le pouvoir linguistique : fer de lance du DDF
L’objectif de notre recherche est d’interroger la propension du DDF à se positionner contre la glottophobie. Nous tâcherons ici de vérifier l’hypothèse selon laquelle le DDF permettrait une redistribution du pouvoir linguistique, tout en développant une nouvelle approche du savoir. Le DDF introduit des changements qui peuvent être scrutés au prisme du principe de « régime de vérité », élaboré par Michel Foucault (Wetherell, Taylor et Yates, 2001). Le sociologue théorise le fait que la production de savoir par les acteurs forts du système international représente une forme spécifique de pouvoir, utilisée en leur faveur pour maintenir un certain ascendant sur les pays non-occidentaux.
L’extension linguistique du « régime de vérité » a été soulevée sous le nom de « regime of language » et mobilisée récemment par Costa (2019) dans sa recherche Regimes of language and the social, hierarchized organization of ideologies. Enfin, une dernière notion à mentionner est celle d’« altérité périphérique », imaginée par Dervin and Keihas (2008) pour désigner les « anciennes colonies françaises, pays francophones et immigrés en France », qui auraient, de par leur position socio-géographique, une place secondaire dans les manuels de FLE (français langue étrangère) et donc, par extension, dans la production du savoir.
Par conséquent, il sera recommandé de nous questionner sur le DDF en tant que produit de savoir. Cette littérature nous permettra, plus largement, d’initier une réflexion sur la mise à mal des rapports de domination linguistique par le DDF. Notre intention étant de comprendre si le DDF permet l’émancipation des cultures francophones stigmatisées comme étant « périphériques » , et s’il permet véritablement de « mettre sur un pied d’égalité les variétés du français » (Villers, dans Ernoult, 2021).
L’utilité du DDF dans le basculement vers une francophonie horizontale est véhiculée par la sphère médiatique. Pour Nadeau, « Le DDF aura plusieurs utilités, à commencer par légitimer des usages locaux et réduire l’insécurité linguistique » en promouvant « le véritable “français commun” (par opposition au français standard) » (2021). Ernoult s’accorde à relayer la conception de Nadeau.
Il apparaît que le DDF exerce un rôle d’orientation en incitant à « lutter contre le “sentiment de faute” très fort dans la francophonie » (2021). Tel est l’objectif présenté dans le Compendium du DDF établi par l’équipe lyonnaise. Nous relevons que les discriminations subies au sein du monde francophone n’ont pas été omises : « Certaines valeurs associées à la langue française font perdurer des discriminations à l’encontre des accents ou des particularités expressives. » (Gasparini et al, 2021, p. 11)
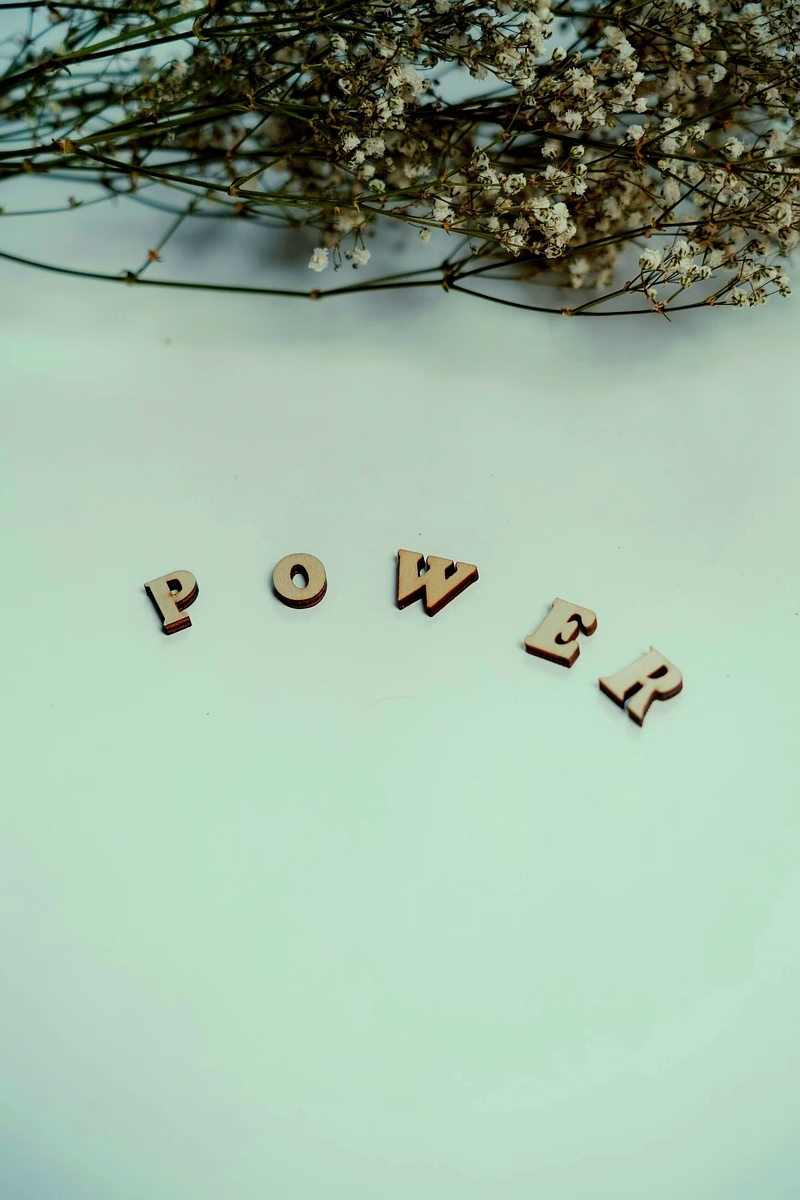
Cette reconnaissance traduit une démarche militante : rendre visible les variétés géographiques de français. Ils mettent en évidence l’engagement du DDF « pour l’égalité entre les francophones et pour le respect de la diversité des usages en promouvant une égalité de traitement entre les mots d’ici et de là-bas » (Idem).
Il apparaît clairement, à l’issue du discours émis par Emmanuel Macron à Ouagadougou, que le DDF s’enracine dans un projet de revalorisation des français et du capital linguistique de ses locuteurs :
Mais le français d’Afrique, des Caraïbes, de Pacifique, ce français au pluriel que vous avez fait vivre, c’est celui-là que je veux voir rayonner, portez-le avec fierté, ne cédez à aucun discours qui voudrait en quelque sorte renfermer le français dans une langue morte. (2017)
Le cadre conceptuel du projet se confirme par les témoignages que nous avons récoltés. Il est marquant de voir que le chef du projet – Noé Gasparini – s’est positionné en faveur de la diversité : « nous voulons légitimer tous les parlers et montrer qu’ils se valent » (dans Nadeau, 2019).
Cette prise de parole semble confirmer notre hypothèse selon laquelle le DDF joue un rôle symbolique dans la lutte contre les inégalités sociolinguistiques. L’analyse de notre enquête montre que le combat contre la glottophobie a été évoqué lors de la mise en place du projet. Plus précisément, l’établissement d’une politique linguistique sociale est présenté comme un des ciments du projet : « On a besoin de la langue pour travailler, pour apprendre, pour vivre et si on vit dans l’insécurité en considérant que son français est mauvais, on ne peut pas assurer pleinement sa citoyenneté. Et donc il y avait derrière le DDF des idées de cet ordre, je crois. » (Cerquiglini, 2022, p. 16)
Si la lutte contre la glottophobie est une volonté qui apparaît clairement, l’inclination du DDF à influencer les francophones n’est pas assurée. Il s’agirait, selon Jean-Marie Klinkenberg, d’une retombée indirecte. L’objectif pourrait être atteint par l’inclusion du dictionnaire au sein des systèmes scolaires (Francard, 2022, p. 135). Nos conclusions placent la lutte contre les inégalités sociolinguistiques comme un objectif à long terme.
Il convient également de prendre en compte le coût représenté par la mise à jour du dictionnaire afin de ne pas engendrer de « disproportion phénoménale » (Klinkenberg, 2022, p. 38) entre les moyens réunis et les retombées sociolinguistiques : « Le dictionnaire peut avoir comme retombée finale de faire en sorte que le locuteur lambda ait un peu plus confiance en lui-même. Mais c’est très mince. » (Ibid., p. 39)
Les prédictions quant à la portée pédagogique du DDF sont nuancées. Maxime Somé estime que les probabilités de voir un impact à moyen terme sont assez fortes :
J’aime à dire que – pour employer le jargon culinaire –, il ne faut pas une grande quantité d’épices pour faire une bonne sauce. Il en faut un peu de chaque, c’est suffisant. Donc le DDF est comme qui dirait “Un si petit pas mais un grand pas pour l’humanité”. Ce sont des actions comme ça qui vont faire avancer les choses. Parfois, il faut voir ça sur court terme et parfois, plus à moyen/long terme. (2022, p. 75)
Le DDF dispose donc d’un potentiel sociolinguistique important. Il est aujourd’hui question de valoriser au mieux la pluralité de référentiels dont il est le détenteur. Pour redistribuer le pouvoir linguistique, il apparaît clairement que l’ajout de fichiers audios est à prioriser : « Et vivement que le DDF ait du son. On va enfin pouvoir entendre aussi tous les accents de la Francophonie. » (Cerquiglini, 2022, p. 16)
