Le décentrement linguistique en francophonie est au cœur de l’analyse du Dictionnaire des francophones, qui se positionne comme un outil politique innovant pour promouvoir un français pluriel. L’article aborde les enjeux de gouvernance linguistique et la lutte contre la glottophobie dans le contexte de la Stratégie internationale pour la langue française.
Partie Ⅱ
Gouverner la diversité linguistique : pierre angulaire du DDF
Chapitre 1
Instituer un français pluriel et décentré : enjeu clé du projet
Section 1. Reconfigurer la Francophonie : la polycentration comme point de bascule
[img_2]
Source : Gasparini, N. (2021b, 3 mars). Gouverner la diversité linguistique [Diapositive]. Formation « La langue est politique », Masters Francophonie, Université Jean Moulin Lyon 3.
A-Articuler le DDF autour de concepts capitaux : étude critique
Définir le décentrement : approche épistémologique
Les dictionnaires en ligne Le Larousse, Le Robert ainsi qu’Encyclopédie Universalis entendent tous trois par « décentrement », l’action de déplacer un objet du centre qui lui a été assigné. Le mot est emprunté à la photographie, où l’on décentre un objectif afin que son axe ne soit pas au cœur du cliché. Dans la production scientifique, nous avons inventorié un article disséquant la notion de décentrement.
Dans Qu’est-ce que le décentrement ? Moralité individuelle et justice sociale (Ethica, 2017), Pierre-Etienne Vandamme applique le décentrement – théorisé en anthropologie et psychologie du développement – au domaine de la philosophie politique. Nous tâcherons à notre tour – à partir de l’état des lieux dressé – d’établir des passerelles avec les relations internationales.
Selon la définition avancée, le décentrement « […] consiste en cette capacité à prendre distance d’avec soi, ses repères, ses convictions, sa vision du monde, pour aller à la rencontre d’autrui. » (2017, p. 1) Il s’agit de prendre en considération – dans une dimension raisonnable – ce qui se distingue de soi chez les autres.
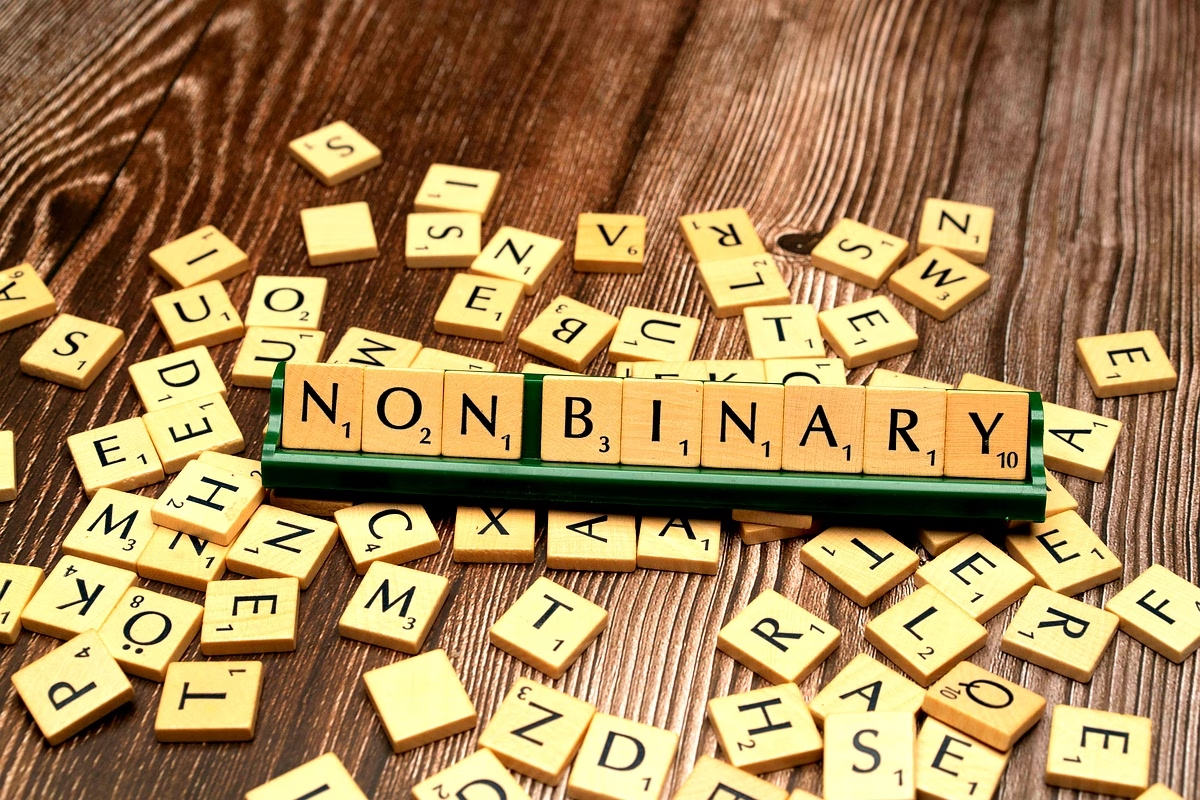
La capacité de décentrement requiert un intérêt communicationnel – défini en opposition à l’intérêt stratégique comme le développe Habermas (1981) –. L’auteur le définit comme « […] une volonté de compréhension plutôt que d’instrumentalisation de l’autre. » (Idem.) Appliqué à la linguasphère francophone, le décentrement retranscrirait donc la volonté – de la part de la France – de prendre en considération la réalité sociolinguistique de chaque territoire francophone.
Il s’agirait de s’inscrire dans une démarche postcolonialiste et non néocolonialiste. Pour cela, la prise en compte des besoins de tous prévaudrait sur la profondeur stratégique qu’incarne la francophonie.
Le « décentrement » s’inscrit dans la démarche scientifique émise par Emmanuel Mounier et Paul Ricoeur en ethno-anthropologie dans les années 1940. Leur approche manifeste la volonté de se départir d’une conduite ethno-centrée afin d’atteindre une meilleure compréhension des cultures qui ne sont pas siennes :
Il s’agit donc de concevoir l’objet d’étude anthropologique comme un alter ego, à savoir un autre radicalement différent, singulier, et pourtant notre semblable. Pouvoir déceler des structures fondamentales de l’humanité sans étouffer la différence dans l’assimilation à nos codes et coutumes propres, telle est la tâche complexe de l’anthropologue. (Ibid., p. 2)
La francophonie incarne parfaitement cet « […] autre radicalement différent, singulier, et pourtant notre semblable […] » (Idem). Fédérée autour de la langue française, elle accueille en son sein une mosaïque de cultures et relève plus de la communauté de communautés que d’une entité unique.
Pour Pinker, le décentrement s’évalue selon le contexte social dans lequel sont plongés les individus (2011, pp. 590- 591, dans Vandamme, 2017, p. 2.). Il établit que plus la société est homogène et isolée, plus le décentrement est important. Les individus se déplacent dans un ensemble collectif au risque de basculer vers « l’autocentrement collectif » (Idem).
Selon sa pensée, il est surprenant que la France fasse preuve de décentrement puisqu’il ne s’agit en aucun cas d’un État-nation ostracisé. Pour le reste, l’auteur affirme que le décentrement est permis par « l’interaction, la communication ». (Vandamme, 2017, p. 4) La présente observation rejoint celle de Ferry, qui analyse l’histoire des peuples au prisme des « rencontres communicationnelles ».
Il nous enjoint à considérer le décentrement comme une clé d’ouverture à l’identité d’autrui (1991 ; 1996, dans Vandamme, 2017, p. 4). Le DDF réverbe cette perspective comme nous l’avons démontré dans la partie de notre analyse nommée « De restriction à inclusion : légitimer tous les usages » (Partie I, Sect. 1, B).
En outre, l’auteur établit un rapprochement entre le décentrement et la philosophie morale impartialiste des Lumières (Vandamme, 2017, p. 4.). Il serait le prolongement de la théorie du spectateur impartial. Formulée par David Hume et Adam Smith, elle consiste en « la prise de distance d’avec soi » afin d’observer ses sentiments « avec les yeux des autres » (Smith, 1759, pp. 171-172, dans Vandamme, 2017, p. 4 ).
Néanmoins, l’autrice considère le décentrement moins inflexible et plus compréhensible que « l’exigence d’impartialité » (Ibid., p. 7). Il entre davantage en résonance avec la conscientisation des biais positionnels de chacun et les intérêts de connaissance, rempart à l’objectivité scientifique.
Les phénoménologues avaient notamment démontré l’impossibilité pour un individu de disposer d’un point de vue omniscient « du fait de [son] inscription corporelle dans le monde » (Ibid., p. 6). Le DDF, tout en faisant état de la diversité des français dans le monde, n’occulte pas le biais positionnel de chaque locuteur.
Enfin, l’inscription d’un individu au sein d’une communauté est – selon l’auteur – la manifestation d’un décentrement. Elle prend l’exemple du sentiment national et statue que « […] si cette capacité se manifeste à un niveau de solidarité géographiquement donné, historiquement contingent, rien n’empêche théoriquement la possibilité de sa réalisation à un niveau plus élevé. » (Ibid., p. 8) Ce postulat inclut la possibilité d’opérer un décentrement à l’échelle de la francophonie.
On retrouve également – dans les discours prononcés autour de la langue française – le substantif synonyme « décentration ». Il a été proposé par le psychologue Jean Piaget pour parler de la distance graduelle prise par un enfant avec son « égocentrisme originel » (Ibid., p. 2). Cette approche théorique du développement moral a été reprise par Habermas mais également Cohen-Émérique (1993, pp. 71-91, dans Vandamme, 2017, p. 2 ), qui traite de l’interculturalité – la relation entre les cultures francophones étant un axe structurant du DDF, mentionné par Mona Laroussi au cours de notre entretien –.
À contrario, il convient de distinguer « décentrement » et « a-centrement », qui renvoie à une « absence de centre » (Vandamme, 2017, p. 9).
L’autrice conclut sa réflexion en invitant à promouvoir une « éthique du décentrement », mettant « en avant une disposition humaine universelle plutôt qu’une conception culturelle particulière de la personne » (Ibid., p. 10).
Dans les domaines de la linguistique, sociolinguistique et géopolitique, nous n’avons, malgré nos recherches, trouvé aucune littérature scientifique qui viendrait expliquer les nombreuses mentions faites du terme. Notre enquête a cependant fait état d’une bonne connaissance du terme au sein de la francophonie.
Ainsi, Jean-Tabi Manga établit que le « décentrement » est une notion ancienne, favorisée par « le contexte de la mondialisation actuelle avec ses aspects multipolaires » (2022, p. 54). Pour Adeline Simo-Souop, le décentrement s’oppose à « Une centralisation forte [qui] veut dire que la décision est prise dans un lieu de pouvoir et que les autres se contentent de la mettre en application. » (2022, p. 63) Pour la sociolinguiste, l’idée directrice du décentrement est la participation de tous les locuteurs au processus décisionnel relatif à une langue donnée.
À l’issue du corpus théorique et empirique collecté, nous proposon la définition suivante : le décentrement désigne l’intention de ne plus faire de la France, et particulièrement de Paris, le point de référence de la linguasphère francophone dont la gouvernance se partage désormais entre plusieurs centres décisionnels.
Selon la formulation de Ferry, le décentrement permettrait à la France de développer une attitude plus « compréhensive à l’égard d’autrui et plus réflexive à l’égard de soi » (1996, p. 111, dans Vandamme, 2017, p. 9).
