Les caractéristiques du DDF se définissent par son approche évolutive, cumulative et participative, offrant une alternative aux dictionnaires prescriptifs. Cet article explore comment ces dimensions contribuent à la gouvernance linguistique et à la lutte contre la glottophobie dans le cadre d’une langue française polycentrique.
- Aspects descriptif, évolutif, cumulatif et participatif : points cardinaux du DDF
Bernard Cerquiglini a, lors de la cérémonie de lancement du DDF le 16 mars 2021, introduit les trois caractères clés du DDF : il se veut évolutif, cumulatif et participatif (Pruvost, 2021, p. 100). À cela s’ajoute sa dimension descriptive, en opposition aux dictionnaires prescriptifs qui décryptent la langue selon une norme présentée comme étant la bonne à suivre.
Le lexicologue Jean Pruvost distingue, dans son ouvrages Les Dictionnaires français, outils d’une langue et d’une culture (2021), les dictionnaires de type extensif – ambitionnant de couvrir le plus de mots possibles – de ceux de type sélectif – se focalisant sur une partie du lexique déterminé par un thème donné – (Ibid., pp. 147-148).
Nous pouvons également différencier les dictionnaires selon qu’ils soient descriptifs, normatifs ou prescriptifs (Ibid., pp. 150-151). L’ouvrage descriptif tend à se faire le miroir neutre d’une langue et de ses usages. À contrario, l’ouvrage normatif ou prescriptif guide le lecteur vers une norme de la langue présentée comme étant la bonne à respecter.
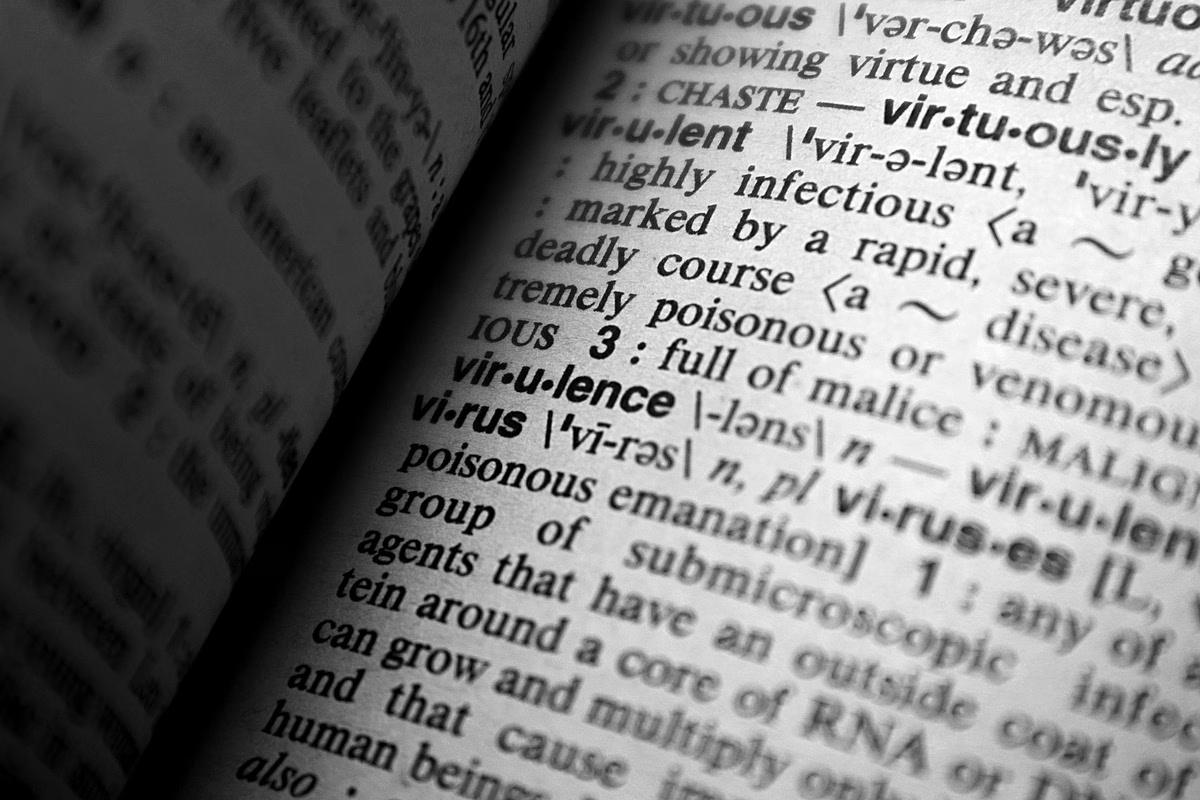
Il est pourvu d’une légende à visée didactique, qui oppose les usages dits « fautifs » à ceux dits « légitimes » (Idem). Sous un angle théorique, le DDF est un dictionnaire de type extensif et descriptif. Ainsi, Jean Tabi-Manga qualifie – lors de notre entretien – le DDF d’ « étude descriptive, structurale qui montre la vitalité de la langue » (2022, p. 53).
Il s’inscrit dans la lignée du Dictionnaire françois de Pierre Richelet. Conçu en 1680, il est l’un des trois dictionnaires monolingues fondateurs et ouvre la voie aux ouvrages descriptifs, accompagnant chaque définition d’une citation (Pruvost, 2021, p. 41).
Lucas Lévêque nuance la portée descriptive du DDF. S’il lui reconnaît « un positionnement où le but est plutôt de présenter la diversité que de la décrire par soi-même », il pointe du doigt la présence de « gens qui font de la relecture, qui font de la validation d’informations » et s’interroge : « Est-ce-que ce n’est pas de la norme ? On peut se poser la question.» (2022, p. 48)
La deuxième caractéristique officielle du DDF est son aspect évolutif. Il est ainsi voué à évoluer continuellement, escomptant ne jamais se figer dans une norme. Cela fait écho au discours d’Emmanuel Macron prononcé à l’Institut de France où il soutient « qu’on aura beau écrire des dictionnaires, il faudra continuer à les refaire. » (2018a)
Quant à Adeline Simo-Souop, elle comprend le DDF comme un « instantané évolutif » : « Avec le DDF, on peut vivre au jour le jour ce qu’est la langue française dans chacun de ses espaces. C’est un dictionnaire descriptif et c’est pour cela que je parlais de photographie évolutive. » (2022, p. 62)
Sa dimension évolutive va de paire avec sa dimension cumulative, son but étant d’engranger le plus grand nombre de mots français possible. Jean Pruvost qualifie les dictionnaires « offrant la langue dans sa plus large étendue » d’« accumulateurs de mots » et situe le premier ouvrage de la sorte à 1800 (2021, p. 67). Il s’agit du Dictionnaire universel de la langue française, de Pierre-Claude Boiste.
Enfin, la position participative du dictionnaire résulte du formulaire de contribution instauré. Ce dernier permet aux locuteurs d’introduire les termes qu’ils ont en usage et qui ne figurent pas dans une des bases de données du DDF. Lucas Lévêque nuance néanmoins ce dernier point en indiquant que « la dimension participative mise en œuvre [n’est] pas encore centrale » (2022, p. 48).
En résumé, la présentation du DDF comme outil descriptif, évolutif, cumulatif et participatif est celle qui a été officiellement retenue. À l’occasion de la conférence Dictionnaire des francophones, un commun citoyen, donnée pendant le forum « Innovation, Technologies et Plurilinguisme », Nadia Sefiane et Noé Gasparini parlent d’un « outil collaboratif » qui lie « l’institutionnel et le citoyen » (2022).
Néanmoins, ce n’est pas le seul récit valable. Slim Khalbous propose une autre typologie lors de la cérémonie de lancement du DDF. Il établit que l’outil est dynamique « par l’adaptation aux évolutions et à l’intégration des spécificités et des usages », moderne « par de nouveaux repères d’ouverture et un rajeunissement du discours », libre d’être approprié « car ce dictionnaire est un bel outil symbole d’une langue française qui appartient à toutes et à tous et où chacun peut apporter sa pierre à l’édifice » (2021).
