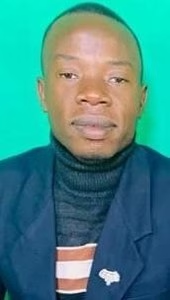La démission en droit positif congolais soulève des questions de vide juridique, notamment concernant la légitimité des décisions d’un gouvernement démissionnaire. Cet article aborde l’encadrement juridique nécessaire pour assurer la continuité des affaires courantes dans ce contexte.
PROBLEME DE DROIT SUR LA DEMISSION EN DROIT POSITIF CONGOLAIS
§1. Vide juridique
Le juge, notamment celui administratif, à la requête de l’intéressé, peut vérifier si les décisions prises par un gouvernement démissionnaire entrent bien dans la catégorie juridique des affaires courantes. Ce qui est une façon de dire que les affaires courantes doivent faire l’objet d’un encadrement juridique minimal1.
Ainsi, en Belgique par exemple, il découle de l’article 46, alinéa 4, de la Constitution belge, que la période de dissolution des Chambres est nécessairement courte, l’acte de dissolution contient la convocation des électeurs dans les quarante jours et de la Chambre des représentants dans les deux mois2.
Ainsi, pour la Belgique, le Gouvernement n’est soumis qu’à l’exercice des affaires courantes dans deux hypothèses. Primo, lorsqu’il a été désavoué par la Chambre des représentants par une motion de censure3. Dans ce cas, il est réputé démissionnaire et présente sa démission au Roi. Dans cette situation, le contrôle parlementaire est amputé de sa sanction ultime.
Secundo, lorsque la Chambre des représentants a été dissoute, dans cette hypothèse, les pouvoirs du gouvernement sont limités parce que le contrôle parlementaire n’existe plus. Or, la période de dissolution de la chambre ne peut dépasser deux mois, donc en toute hypothèse, au regard de ce qui précède, la durée légale des affaires courantes ne peut excéder deux mois.
Par ailleurs, en République démocratique du Congo, il n’est pas facile de déterminer expressément la durée légale de l’expédition des affaires courantes à l’absence d’un encadrement juridique minimal. En effet, le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d’un texte.
L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement ou d’un membre du Gouvernement par le vote d’une motion de censure ou de défiance. Lorsque l’Assemblée nationale vote une motion de censure, le Gouvernement national est réputé démissionnaire4. La constitution ne fait allusion nulle part à l’expédition des affaires courantes par le Gouvernement démissionnaire, ni y dégager de manière expresse ou implicite sa durée maximale. Ce qui constitue un vide juridique qu’il faudra combler à la prochaine révision constitutionnelle.
En fin de compte, bien qu’il y ait un vide juridique au sujet de la théorie d’expédition des affaires courantes en droit positif congolais, la pratique au niveau national peut nous permettre de déterminer sa durée maximale. Ainsi, le Gouvernement démissionnaire d’Augustin Matata Ponyo fait trois jours d’expédition d’affaires courantes. Celui Samy Badibanga, réalise un mois d’affaires courantes.
Pour le Gouvernement Bruno Tshibala Nzenze fait quatre mois (du 20 mai au 7 septembre 2019). Enfin, pour le Gouvernement Sylvestre ILUNGA, il a expédié les affaires courantes pendant trois mois (soit du 29 janvier au 26 avril 2021). Ainsi, il découle de ce constat empirique, affronté à l’alinéa 3 de l’article 76 de la Constitution du 18 février 2006, prévoyant ainsi, qu’en cas de vacance de la présidence ou lorsque l’empêchement du Président de la République est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, l’élection du nouveau Président de la République a lieu, sur convocation de la Commission électorale nationale indépendante, soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus, après l’ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.
Il ressort de cette disposition qu’en cas de vacance de la présidence, le Président intérimaire est appelé qu’à la gestion des affaires courantes puis que ces pouvoirs sont limités, notamment l’interdiction de nomination et de révocation du Premier ministre et des membres du Gouvernement national, ne peut qu’en exercer pendant quatre-vingt-dix jours, soit trois mois au plus. C’est pourquoi nous pensons qu’en RDC, la durée maximale des affaires courantes est de trois mois au plus. Ainsi, les affaires courantes de longue durée, dépassant cette durée, exposeraient les actes de l’autorité intérimaire à la censure du juge administratif pour incompétence temporaire de leur auteur5.
§2. Problème sur la durée et compétences des autorités démissionnaires en droit positif congolais
- Principe de limitation des compétences : la compétence est l’exception ?
Comme nous l’avons souligné dans les lignes qui précèdent, le pouvoir du gouvernement démissionnaire est réduit à l’inaction, il doit s’abstenir de poser le moindre acte qui, en période normale, aurait pu justifier l’interpellation, question ou enquête devant le parlement. Dans cette optique, il découle de ce qui précède qu’en expédiant les affaires courantes, l’incompétence est le principe et la compétence, c’est l’exception, car la compétence de l’autorité administrative s’exerce à l’intérieur d’une limite de temps, de l’investiture à la sortie de ses fonctions6.
Toutefois, la jurisprudence et doctrine admettent que certains actes posés après la fin des fonctions peuvent être valables lorsque l’Administration n’a pas désigné la personne qui doit assurer les affaires courantes7.
Dans tous les cas, il y aura incompétence ratione temporis lorsqu’une telle autorité, à la fin de ses fonctions, empiète le principe selon lequel « la compétence est l’exception en affaires courantes » en agissant comme si elle était en plein exercice de ses pouvoirs. En plus, au regard de la pratique telle qu’analysée au paragraphe premier, l’exercice de cette compétence ne peut dépasser trois mois en RDC.
Pouvoir hors contrôle ?
Le contrôle politique, en principe dès l’instant où un ministre s’exprime, agit, intervient à un titre ou à un autre, il doit pouvoir être interpellé et interrogé. Son action doit pouvoir faire l’objet d’une enquête. La logique du système parlementaire est claire à ce sujet. Si les réponses du ministre sont inexistantes, si elles ne sont pas satisfaisantes, si elles ne sont pas convaincantes, le comportement d’un membre du gouvernement doit pouvoir être censuré.
Le ministre doit pouvoir être renversé. Si nécessaire, ses collègues peuvent être entraînés dans sa chute. La règle du contrôle politique exprime la quintessence du régime parlementaire8.
Par ailleurs, l’idée du contrôle parlementaire durant les affaires courantes peut paraître paradoxale. La question qui résulte de cette situation, est de savoir, comment un parlement peut contrôler un gouvernement sur lequel il n’a plus d’emprise. Toutefois, poser la question des affaires courantes sous l’angle du contrôle parlementaire, c’est revenir aux sources de cette théorie que nous avons largement abordée précédemment au chapitre premier, section première, paragraphe premier.
Les affaires courantes ne sont pas des actes, il s’agit soit de dossiers desquels découlent des actes juridiques soit d’une période au cours de laquelle les pouvoirs du gouvernement sont restreints parce que sa responsabilité ne peut pas être engagée devant le parlement.
Ainsi, le contrôle a posteriori du parlement perd sa raison d’être dans la mesure où il ne peut plus mettre à terre un gouvernement qui y est déjà. En effet, la règle de conduite en cas de démission du Gouvernement est simple : « Pas d’action sans contrôle. Pas de contrôle, pas d’action ».
D’entrée de jeux, nous serons tentés d’affirmer qu’en ce cas, les Chambres existent encore et que rien ne les empêche d’exercer leurs prérogatives de contrôle ; ce qui est vrai. Cependant, il faut admettre qu’un contrôle ne saurait être réel et effectif s’il ne peut contraindre le Gouvernement désavoué par le Parlement à se retirer.
Dans la mesure où il a déjà remis sa démission dans les mains du Roi ou du Président de la République. Il ne sert donc à rien de s’acharner sur un gouvernement qui n’est déjà plus que l’ombre de lui-même9. « On ne tue pas les morts », disait le professeur Marcel Waline10.
Toutefois, nonobstant l’ineffectivité d’un contrôle parlementaire ou de l’organe délibérant sur le Gouvernement ou le Collège exécutif démissionnaire, ce contrôle ne devient pas certes impossible, mais atténué, car l’organe délibérant peut constituer une commission d’enquête parlementaire et interpeller les ministres. Il peut toujours soumettre ces autorités démissionnaires aux questions orales sans ou avec débat, etc., bien qu’ils ne soient pas suivis de la sanction ultime11.
En fin de compte, en droit positif congolais, les contrôles exercés par le juge constitutionnel, judiciaire et administratif sur les actes administratifs en période normale restent possibles, également en affaires courantes. Mais celui du juge administratif a la plus grande ampleur. Car le juge administratif est le juge naturel de l’administration, le gardien de la légalité, capable d’annuler un acte administratif et faire disparaitre ses effets antérieurs et présents.
En effet, le juge administratif a pour mission de juger de la conformité des actes, décisions ou règlements des autorités administratives au droit. Il est de ce point vu, juge de la légalité au sens large de cette expression12.
À cet effet, un acte posé en affaires courantes, qui excèderait les limites de cette théorie, se verrait annuler par le juge administratif congolais pour incompétence temporaire.
CONCLUSION
Nous voici au terme de ce travail qui nous a permis d’enrichir parfaitement notre connaissance d’une manière au moins lucide. Comme nous l’avons si bien dit dans notre introduction, ce travail est constitué de deux chapitres.
Dans le premier, portant sur la Généralité sur la théorie des affaires courantes. Il a été constaté que l’expédition des affaires courantes naît à la suite d’une démission et se justifie par le principe de continuité de l’État ou de continuité des services publics. Ainsi la démission a été définie comme étant un acte par lequel on renonce à une fonction ou un mandat.
De ce point de vue, elle est d’office, volontaire et en blanc. Mais dans tous les trois cas, la cessation de service ou du mandat occupé pour les postes politiques, est l’effet principal de la démission lorsqu’elle a été acceptée par l’autorité habilitée. Sauf la nécessité d’expédier les affaires courantes, ou de satisfaire aux exigences de la continuité des services publics que l’autorité démissionnaire peut rester en fonction en attendant, en bref délai, l’arrivée de la nouvelle autorité.
Contrairement à notre hypothèse du départ, l’expédition des affaires courantes ne prend pas son amont dès que le Gouvernement ou le Collège a été désavoué par l’organe délibérant par un vote favorable d’une motion de censure, mais plutôt au moment où la démission commence à produire ces effets. C’est-à-dire au moment de son acceptation par l’autorité habilitée.
Par ailleurs, nous affirmons l’hypothèse selon laquelle les pouvoirs en affaires courantes se limitent à la gestion des affaires habituelles, qui ne présentent pas en fait une importance exceptionnelle.
Par ailleurs, à l’absence des dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires limitant clairement un tel pouvoir en droit positif congolais ; nous avons partagé la même position avec le Conseil d’État, en affirmant que les affaires constituant la poursuite normale d’une procédure régulièrement engagée avant la dissolution ou la démission du gouvernement. Une affaire dont l’importance dépasse celle des affaires de gestion journalière et qui n’est pas urgente peut néanmoins être finalisée par le gouvernement, malgré sa démission ou la dissolution du parlement.
Enfin, quant au contrôle, nous affirmons l’hypothèse selon laquelle, en affaires courantes, trois contrôles sont possibles : le contrôle politique (parlementaire), administratif et juridictionnel. Toutefois, le premier contrôle est paradoxal par le fait que le parlement n’a pas d’emprise sur ce gouvernement démissionnaire, par conséquent un contrôle parlementaire est inefficace ou perd même sa raison d’être dans la mesure où il ne peut plus mettre à terre un gouvernement qui y est déjà. Il faut admettre, dans cette situation, qu’un contrôle parlementaire ne saurait être réel et effectif s’il ne peut contraindre le Gouvernement désavoué par le Parlement à se retirer. Néanmoins, malgré l’ineffectivité d’un contrôle parlementaire ou de l’organe délibérant sur le Gouvernement ou le Collège exécutif démissionnaire, celui-ci ne devient pas certes impossible, mais atténué, car l’organe délibérant peut constituer une commission d’enquête parlementaire et interpeller les ministres. Il peut toujours soumettre ces autorités démissionnaires aux questions orales sans ou avec débat, quoiqu’ils ne soient pas suivis de la sanction ultime.
Par contre, les deuxième et troisième contrôles (administratif et juridictionnel) sont plus effectifs sur ledit gouvernement, afin de vérifier que celui-ci n’excède pas les limites des affaires courantes.
Passant au second, qui aborde la question sur les pouvoirs des autorités démissionnaires en droit positif congolais. En premier lieu, nous avons souligné qu’en expédiant les affaires courantes, l’incompétence est le principe et la compétence, l’exception, car la compétence de l’autorité administrative s’exerce à l’intérieur d’une limite de temps, de l’investiture à la sortie de ses fonctions. En deuxième lieu et enfin, de la pratique congolaise observée, il sied de noter qu’en soumettant l’expédition des affaires courantes qu’aux interdictions, cela constitue une restriction exagérée, car les affaires en cours ou déjà engagées, quelle que soit leur importance, sont poursuivies par le gouvernement démissionnaire. Et la durée maximale de la gestion des affaires courantes est estimée à trois mois au plus.
Étant une œuvre humaine, vu la complexité de la matière qui a constitué notre objet de recherche, nous laissons la porte grandement ouverte aux chercheurs qui apporteront un coup de main à ce travail en répondant avec perspicacité à ce questionnement : Peut-on intégrer de manière expresse, la théorie d’expédition des affaires courantes dans la Constitution congolaise?
________________________
1 F. DELPEREE, « Gouverner sans gouvernement ? », In Bulletin de la Classe des lettres et des sciences morales et politiques, tome 23, 2012. p. 128. ↑
2 Art.46, al.4, Constitution coordonnée de l’État belge du 17 février 1994, disponible sur : https://www.ejustice.just.fgov.be/cg, consulté le 12 octobre 2022. ↑
3 LUCIEN RIGAUX, Quelle évolution pour le concept d’affaires courantes, Actes du colloque organisé par le Centre d’Études Jacques Georgin à la Chambre des représentants, le 29 novembre 2019, p. 37. ↑
4 Art. 146 et art.147 in fine , Constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006 , in J.O. RDC, 52e année, Kinshasa, n° spécial, février 2011, p.49., et l’art. 6 de l’Ordonnance présidentielle n° 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalité de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Membres du Gouvernement, disponible sur : leganet.cd/Legislation/Droitpublic/Ministeres/gouv/ordonnance27mars2020. html, consulté le 11 octobre 2022. ↑
5 Art. 76, al.3, et art.75 in fine, Constitution du 18 février 2006, Op.cit., p.29. ↑
6 F. VUNDUAWE te PEMAKO, p.683. ↑
7 Idem, p.684. ↑
8 F. DELPEREE, « Gouverner sans gouvernement ? », In Bulletin de la Classe des lettres et des sciences morales et politiques, tome 23, 2012, p. 126. ↑
9 F. DELPEREE, « Gouverner sans gouvernement ? », In Bulletin de la Classe des lettres et des sciences morales et politiques, tome 23, 2012. p.127. ↑
10 Ibidem. ↑
11 LUCIEN RIGAUX, Op.cit., p.37. ↑
12 BOTAKILE BATANGA, Précis du contentieux de droit administratif congolais, Tome 2, Bruxelles, Academia, 2014, p.38. ↑