Les stratégies d’implémentation en communication révèlent des mécanismes de défense socioculturelle inattendus dans le contexte congolais. Cette recherche, alliant psychologie interculturelle et méthodologies mixtes, offre des perspectives nouvelles sur la construction de la réalité à travers la communication, avec des implications cruciales pour la compréhension interculturelle.
- Processus psychiques de contextualisation
Dans la vie de tous les jours, voire dans la communication, les hommes construisent la réalité à travers leurs pratiques, le sens qu’ils donnent à ces dernières et leur capacité d’utiliser et de manipuler des règles collectivement construites. L’étude de ces processus psychiques de contextualisation a donné lieu à un courant américain contemporain, le « constructionnisme » opposé au « constructivisme ». A ce sujet, de nombreuses approches ont été effleurées pour catégoriser ces processus psychiques de contextualisation, mais en ce qui nous concerne, nous allons ici nous intéresser à l’approche de Jean Piaget, Peter L. Berger et Thomas Luckmann.
- Processus psychiques de contextualisation selon Jean Piaget
Selon Jean Piaget334, l’esprit humain construit les réalités à travers les trois processus psychiques ci-après : l’assimilation, l’accommodation et l’équilibration.
- Processus d’assimilation
Il y a assimilation lorsqu’un individu, qui interagit avec son milieu de vie ou qui est confronté à un problème dans une situation d’apprentissage, intègre des données qui viennent du milieu ou de la situation problème ; il intègre ces données en les reliant, en les coordonnant aux informations, aux connaissances dont il dispose déjà.
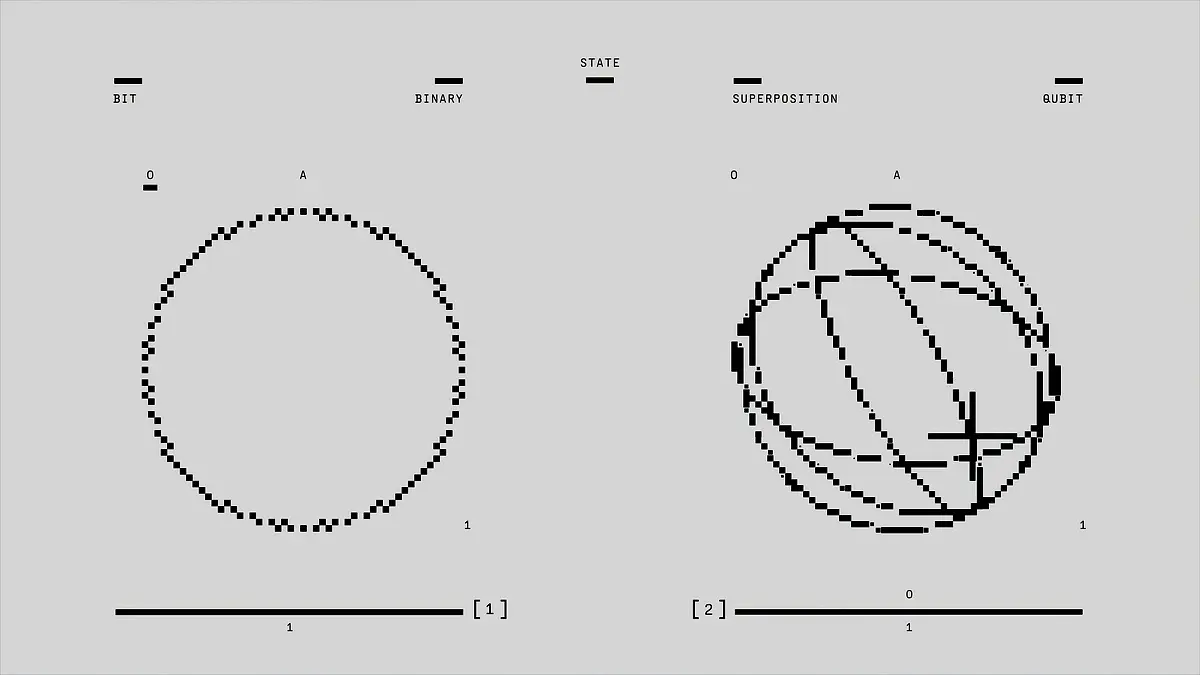
Ce processus est un travail d’appropriation, de décodage, de transformation. Il s’agit dans ce cas d’intégrer une nouvelle situation à un ensemble de situations auxquelles une conduite est déjà appliquée. Ici, la conduite ou l’opération ou le mode de raisonnement ne change pas fondamentalement. Ce qui change, c’est l’étendu d’un champ de connaissances.
Le processus d’assimilation se caractérise donc par l’intégration de nouvelles idées, analyses, notions, ou nouvelles situations à des cadres mentaux déjà existants. C’est l’action du sujet sur les objets qui l’environnent, action qui se fait en fonction des connaissances et des structures cognitives déjà élaborées. L’assimilation offre la possibilité d’intégrer les données nouvelles aux connaissances dont le sujet dispose déjà. Dans une perspective d’assimilation, comprendre un problème revient à le faire entrer dans les cadres de compréhension et de connaissances que l’individu maîtrise actuellement. Connaître reviendrait alors à ramener de l’inconnu à du connu.
- Processus d’accommodation
Le processus d’accommodation est marqué par l’adaptation du sujet à des situations nouvelles d’où il y a la modification de ses cadres mentaux. C’est donc une action de l’environnement sur l’individu qui va avoir pour effet de provoquer des ajustements dans la manière de voir, de faire, de penser du sujet, en vue de prendre en compte ces données nouvelles quelque peu perturbantes. L’accommodation traduit l’action d’imposition du milieu sur l’activité cognitive du sujet, en le poussant à une réorganisation de ses connaissances, à une modification de sa manière de voir les choses, à la modification des conduites et des structures de l’individu.
C’est aussi la transformation d’une conduite (ou d’une opération ou d’un mode de raisonnement) déjà existante, en réaction au milieu (ou au nouveau problème à traiter). Cette transformation est rendue nécessaire car les façons de faire habituelles ne suffisent plus pour résoudre le problème, c’est-à-dire pour s’adapter.
Enfin, l’accommodation renvoie aux modifications que le sujet est contraint d’imposer à la structure de ses activités en fonction de la résistance ou des particularités des objets sur lesquels il agit.
- Processus d’équilibration
La recherche permanente d’un équilibre entre l’assimilation et l’accommodation est appelée équilibration. Jean Piaget en parle en termes d’ « autorégulation ». Ainsi, par exemple, comprendre une théorie, c’est-à-dire entrer dans la penser de l’autre, suppose un effort d’accommodation au cours duquel des éléments disparates sont envisagés séquentiellement sans que leur articulation soit visible, effort suivi d’une appropriation plus personnelle (assimilation) au cours de laquelle ces éléments sont mis en lien avec des connaissances acquises antérieurement. L’équilibre entre les deux processus interviendra lorsqu’on est en mesure d’utiliser cette théorie pour expliquer certains phénomènes de la nature.
Jean Piaget distingue trois types d’équilibration335 :
- le premier type d’équilibration renvoie à la recherche de la satisfaction du besoin par l’activité assimilatrice. Celle-ci restaure l’équilibre rompu par le besoin ;
- le second type d’équilibration résulte des interactions directes entre le sujet et les objets, entre les schèmes d’assimilation et les contraintes à l’accommodation exercées par les objets ;
- le troisième type d’équilibration résulte des combinaisons ou coordinations internes entre schèmes d’assimilation et rend compte de la construction de conduites véritablement nouvelles avec le recours à la « conscience ».
Ce processus est entendu comme une adaptation, c’est-à-dire comme une recherche du meilleur équilibre possible entre l’individu et son milieu de vie, ou entre l’individu et la situation-problème à laquelle il se trouve confronté. C’est en ce sens qu’on a pu parler d’équilibration majorante, c’est-à-dire de la recherche de l’équilibre (ou de la solution, du compromis) le plus favorable à l’individu.
- Processus psychiques de contextualisation selon Peter L. Berger et Thomas Luckmann
D’après Peter L. Berger et Thomas Luckmann336 dans leur livre The Social Construction of Reality publié en 1966, la « réalité est socialement construite. Elle est « re-produite » par des personnes qui agissent en fonction de leur interprétation et de leur connaissance (qu’elle soit consciente ou non) de celle-ci. Cette réalité est comprise d’un point de vue subjectif plutôt qu’objectif, c’est-à-dire tel que nous pouvons la percevoir plutôt que la séparer de nos perceptions. A cet effet, l’esprit humain construit des significations, notamment par des processus d’apprentissage, d’étayage et de métacognition.
- Processus d’apprentissage et développement
L’hypothèse centrale de Lev Semionovitch Vygotski337 est celle d’un fonctionnement fondamentalement social de l’être humain. Il considère que les fonctions psychiques supérieures, celles donc qui nous caractérisent le plus en tant qu’êtres humains, ne se développent pas naturellement pour des raisons qui seraient essentiellement biologiques, mais culturellement par le biais des médiateurs socio-culturels.
Dans cette perspective, l’éducation apparaît comme l’élément fondamental de l’histoire de l’enfant. Sur le processus naturel du développement de l’enfant vient se greffer, de manière décisive, le processus d’éducation qui permet l’éclosion des potentialités. L’éducation restructure de manière fondamentale toutes les fonctions du développement. C’est à travers elle que l’enfant s’approprie tout un héritage culturel.
Pour cet auteur, la direction du développement de la pensée va du social à l’individuel. Les outils intellectuels élaborés par l’individu sont tout d’abord au cours d’interactions, d’échanges. Il y a une double construction des fonctions psychiques supérieures, chaque fonction apparaissant deux fois, ou se développant en deux temps : d’abord comme activité collective, sociale et donc comme fonction inter-psychique, puis la deuxième fois comme activité individuelle, comme propriété intérieure de la pensée de l’enfant, comme fonction intra-psychique338.
En tout état de cause, sous certaines situations comme la communication interculturelle, le processus interpersonnel peut intérioriser et générer des coordinations intra-individuelles, c’est-à-dire structurer les manières de penser des individus.
- Processus d’étayage
Le concept d’étayage est utilisé sous différentes formes et à partir d’approches différentes en psychologie, en éducation et en psychanalyse.
Dans le cadre d’une recherche sur la construction de soi, Marie-Claude Hurtig, Monique Pinol-Douriez et Annie Colas339 ont décrit le processus d’étayage comme un processus de transformations affectivo-cognitives par lesquelles se développent des réseaux de liens à des objets externes ou internes sur lesquels un individu prend appui pour se développer.
Pour Maryse Metra340, le processus d’étayage est à l’œuvre dans tout échange où la communication est asymétrique, dans le sens où l’un de deux interlocuteurs peut amener l’autre à réaliser ce qu’il ne pouvait pas faire sans aide.
Dans ce sens, la communication est un processus interactif dans lequel les gens apprennent les uns des autres, car nul ne peut se connaître soi-même ; on se voit d’abord par les autres. Pour agir, il faut être ensemble. C’est par le verbe et l’action, le rapport à autrui, que nous nous insérons dans le monde humain.
De plus, cet apprentissage tient autant aux composantes socio-affectives qu’aux aspects cognitifs ou intellectuels. Et c’est par la médiation sociale que les hommes construisent les connaissances.
- Processus de métacognition
Le concept « métacognition » est composé de deux termes 341: « Meta » et « Cognition ».
Méta : du grec méta signifie « au delà de », « après », « ce qui indique le changement », la « postérité », la « supériorité », le « dépassement ». Et le Cognition, c’est la faculté de connaître, l’acte mental par lequel on acquiert une connaissance ; c’est l’opération cognitive relative à la connaissance.
En effet, La métacognition se rapporte à «la connaissance qu’on a de ses propres processus cognitifs, de leurs produits et de tout ce qui y touche, par exemple, les propriétés pertinentes pour l’apprentissage d’informations ou de données… »342.
Elle désigne aussi « la capacité qu’a un individu de réfléchir sur sa propre activité, afin d’en prendre conscience. Le but d’une activité cognitive, d’une manière générale, est de résoudre un problème, d’effectuer une tâche, alors que le but d’une activité métacognitive est de fournir des informations sur l’activité dans laquelle on est engagé. On cherche alors des informations pour réguler la résolution » 343.
Linda Allal et Madelon Saada-Robert344 font remarquer qu’à partir d’un certain degré de maturité la métacognition s’exprime par des « habiletés cognitives » tangibles ou « compétences métacognitives ». Sur une ferme base d’autonomie, ces compétences permettent à la personne d’évaluer en permanence son capital intellectuel et ses savoir-faire ; d’opérer des transferts de connaissances et de combler les déficits (autoformation) ; d’opérer le meilleur choix dans un éventail de procédures possibles et globalement d’adopter la meilleure stratégie en fonction des objectifs initiaux.
________________________
334 PIAGET, J., La naissance de l’intelligence chez l’enfant, Genève, Delachaux, 1936, pp. 359-360. ↑
335 PIAGET, J., op.cit, pp. 359-360, 365. ↑
336 BERGER, P.L. and LUCKMANN, T., The Social Construction of Reality, New York, Doubleday, 1966, pp. 1- 115. ↑
337 VYGOTSKI, L. S., Pensée et langage, Paris, Editions sociales, 1985, pp. 45 et 111. ↑
338 VYGOTSKI, L. S., op.cit, pp. 45 et 111. ↑
339 HURTIG, M.-C. et alii, « Construction de l’identité : La construction de l’identité dans les trois premières années : un processus de transformation affecto-cognitive des interactions soi/objet », in Psychologie Française, Vol 35, n°1, 1990, pp. 25-33. ↑
340 METRA, M., « Les étayages multiples dont l’enfant a besoin pour grandir et apprendre », document téléchargé le 12 octobre 2012, URL : http://www.ngo-unesco.org/IMG/pdf ↑
341 WAGENER, B., « Métacognition », document téléchargé le 10 octobre 2012, URL : http://metacog.free.fr/metacognition.php ↑
342 FLAVELL, J.H., « Metacognitive aspects of problem-solving », in RESNICK, L.B. and alii (edit), The nature of intelligence, Hillsdale, Lawrence Erlbaum Associates, 1976, p. 232. ↑
343 BARNIER, G., « Théories de l’apprentissage et pratiques d’enseignement », pp. 12-13, document téléchargé le 12 juillet 2012, URL : http://www.aix-mrs.iufm.fr/formations/fit/doc/apprent/Theories_apprentissage.pdf ↑
344 ALLAL, L. et SAADA-ROBERT, M., « La métacognition : cadre conceptuel pour l’étude des régulations en situations scolaires », in Archives de Psychologie, n° 60, 1992, pp. 265-296. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quels sont les processus psychiques de contextualisation selon Jean Piaget?
Selon Jean Piaget, l’esprit humain construit les réalités à travers trois processus psychiques : l’assimilation, l’accommodation et l’équilibration.
Comment fonctionne le processus d’assimilation dans la communication interculturelle?
Le processus d’assimilation se caractérise par l’intégration de nouvelles idées et situations aux cadres mentaux déjà existants, permettant ainsi de comprendre un problème en le reliant aux connaissances maîtrisées.
Qu’est-ce que le processus d’accommodation selon Jean Piaget?
Le processus d’accommodation est marqué par l’adaptation du sujet à des situations nouvelles, entraînant une modification de ses cadres mentaux et une réorganisation de ses connaissances pour s’adapter à des données nouvelles.