Les stratégies d’implémentation photographique révèlent comment la photographie documentaire, durant l’occupation américaine d’Haïti (1915-1920), transcende son rôle initial. En analysant des images clés, cette étude met en lumière des représentations sociopolitiques complexes, essentielles pour comprendre cette période tumultueuse.
La photographie et l’histoire
Nous ne pouvons pas établir un rapport entre la photographie et l’histoire sans faire référence à Eugene Atget. Celui-ci est un photographe qui fait la jonction entre deux mondes disparates : homme du XIXème siècle par sa pratique et son ambition documentaire, il appartient au XXème siècle sur son œuvre vers 1925.
Il apparait alors qu’on parlait de la place de la photographie dans la connaissance, dans l’histoire, dans le marché des images, et la fonction du document dans une société. Atget dégage aussi le double langage de la photographie : le sens qui lui est donné par l’auteur et l’interprétation de la lecture ultérieure.
« Il y a des moments où je déteste la photo : qu’ai-je à faire des vieux troncs d’Atget ? » Roland Barthes savait bien qu’il allait scandaliser avec cette remarque car Atget (1857 – 1927) est un ancêtre incontournable dans l’histoire de la photographie, l’incarnation même du « grand photographe », qui a évincé Alfred Stieglitz, Nadar, Asel Adams et Cartier-Bresson60.
A la faveur de changement est née une tradition de la photographie qui se poursuit dans la nouvelle démarche documentaire des années 20 et 30, à travers les œuvres de Bérénice Abbott, de Brassai, d’André Kertesz, d’Henri Cartier-Bresson et de Walker Evans61… Cette nouvelle tradition confère à la photographie un destin indépendant, celui d’un moyen d’expression soumis à un perfectionnement et un affinement perpétuel, au même titre que la peinture de Cézanne.
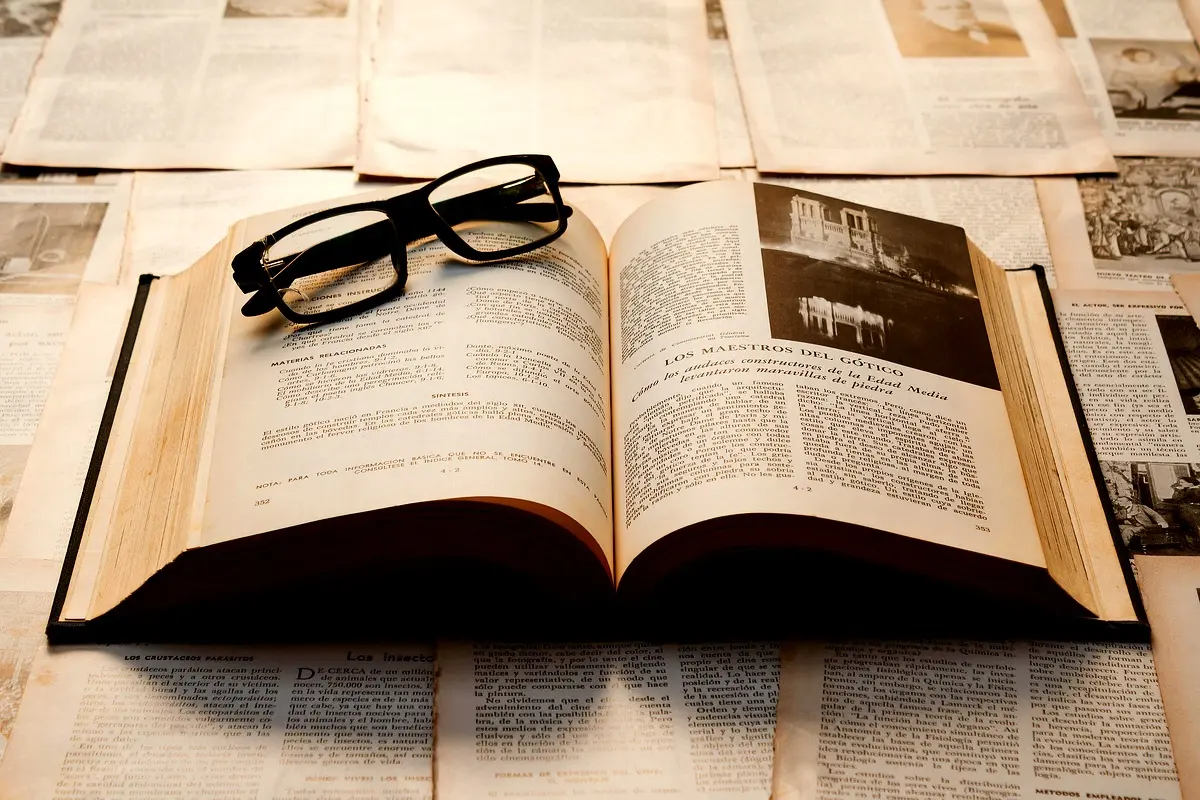
59 Ibid, meme page
60 (Michel FRIZOT et all. 1994, p 399)
61 Alfred Stieglitz est un photographe du XXème siècle, chef de fil d’un groupe de photographes et d’artistes américains, qui entreprenaient une lutte pour définir la photographie comme une forme d’expression artistique à part entière. De nombreux travaux, expositions, livres, articles ont corroboré, depuis, l’effort de Stieglitz pour établir la photographie comme un des beaux-arts.
La photographie est communément associée aux formes d’art visuel qui utilisent l’image comme moyen d’expression comme la peinture, le dessin, la gravure; Nadar Félix (1820-1910), est photographe, aéronaute, journaliste, caricaturiste et écrivain français. Comme photographe, Félix Nadar a été l’un des maîtres du portrait et l’un des grands innovateurs de la fin du XIXe siècle ; Adams Ansel Easton (1902-1984) est photographe américain, dont les œuvres, dédiées au paysage de l’Ouest américain, se veulent un éloge de la nature ; et, Cartier-Bresson, Henri (1908-2004), photographe
français. Même page
En Allemagne, Walter Benjamin leur consacre un compte-rendu, puis consigne quelques années après, les réflexions qu’elles lui ont inspirées dans son célèbre essai « l’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique » (1936). Il prend Atget pour le grand personnage de la transition dans l’histoire de la photographie, parce que son œuvre marque à ses yeux le passage d’une culture iconographique fondée sur les valeurs rituelles des images à une autre, fondée sur la capacité de démonstration et sur l’accès à un public.
Benjamin perçoit la valeur d’ « expression» des photographies d’Atget, et en considérant qu’elles ne se prêtent pas à une contemplation rêveuse, il désigne leur statut de document62.
Photographie et musée d’histoire
Sans refuser la valeur artistique, la photographie documentaire sert davantage la connaissance par son contenu, par son réfèrent à l’histoire et à l’ethnologie. L’urbanisme, l’architecture, l’ingénierie, la médecine, les arts, toutes les disciplines sont bien servies par ce fonds d’images. Et l’histoire sociale, économique et politique (celles des institutions comme celle des individus) profite de cette ressource informative inépuisable.
La vie collective, en privé, celle du monde ordinaire comme celle des grands, éclate dans les albums de plus en plus volumineux, décidément le «livre» le plus important de la bibliothèque familiale. Dans cinquante ans, quand les historiens traiteront d’histoire populaire de la fin du XXe siècle, ils pourront compter parmi les différentes sources d’interprétation sur les vestiges d’une insatiable industrie du souvenir, invitant à croquer tous les temps d’une vie.
Dans les musées d’histoire et de civilisation, la photographie tirée de différents dépôts d’archives sert de support à la contextualisation des projets et des thèmes. Par exemple, au Musée McCord de Montréal, une institution particulièrement active dans la mise en valeur du costume bourgeois, des clichés anciens tirés du fonds Notman ou de fonds privés donnent tout leur sens aux spécimens de culture matérielle en exhibit63.
Aucun médium ne peut mieux servir une présentation sur la vie rurale en début de siècle dans une paroisse ou une région du Québec. Même le volet ethnographique ou sociologique d’une exposition d’art ancien peut profiter du médium. A l’exposition consacrée au sculpteur Louis Jobin, tenu au Musée du Québec, la plus grande réussite dans le genre, de vieux clichés savamment agrandis permettaient de montrer cet artiste du siècle
62 (Michel FRIZOT et all.1994, p 401)
63 Tiré du concept d’ « Exhibition», « Une maison pour la photographie », Michel Lessard Cap-aux-Diamants : la revue d’histoire du Québec, n° 25, 1991, p. 52-55., http://id.erudit.org/iderudit/7840ac
dernier à l’œuvre dans son milieu de travail, comme aucun texte, aucune autre source ne peut le faire dans l’exploration concrète du temps64. Dans ce cas, il nous parait un peu problématique dans le cas d’Haïti car la photographie en tant que telle ne s’assoit sur aucun socle théorique jusqu’à présent.
En plus, il n’y a pas de musée consacré spécifiquement à l’histoire en Haïti. Et, pour cette recherche, nous ne trouvons que deux photos en rapport avec cette thématique seulement au MUPANAH. Comme notre seule alternative sur ce point, des chercheurs qui intéressent à cette question, et généralement à la culture d’archivage, pourraient nous aider.
1. Photographie comme archive
Dès son origine, au XIXe siècle, la photographie est orientée vers l’archive. Comme le montre Allan Sekula, dans The Body and the Archive1, pour que la pratique photographique réponde aux exigences d’une entreprise archivistique et que les clichés deviennent des documents d’archives, les photographes du XIXe siècle ont créé deux stratégies.
La première consiste à soumettre les photographies à des règles stylistiques et compositionnelles strictes afin de réduire les singularités à quelques traits emblématiques. L’entreprise archivistique est alors conçue comme un échantillonnage de la diversité du monde. La seconde refuse cette codification des photographies et cherche plutôt à rendre compte de la multiplicité des spécificités.
Un système de classement est alors nécessaire pour pouvoir retrouver chaque unité parmi la grande quantité d’images produites. Depuis les années 1960, plusieurs pratiques artistiques occidentales renouent avec l’esthétique de l’archive photographique et reprennent à leur compte ces deux tendances. Il s’agira ici de montrer comment s’effectue cette reprise, et de saisir quelques-uns de ses enjeux.
La réflexion ne privilégiera pas la question de la mémoire et de l’histoire, pourtant intrinsèque à la notion d’archivé, mais considérera le recours à l’archive photographique comme une stratégie par laquelle les artistes contemporains redéfinissent les limites de leur champ d’activité65. Par rapport à cette approche, ce qui a éveillé notre curiosité pour réaliser ce projet de recherche, nous nous proposons d’aborder cette question relativement à la base.
C’est-à-dire attirer l’attention du public à la necessité d’archiver des photos en rapport à la période que nous étudierons de manière systématique.
64 Ibid, même page
65 « Renouer avec l’esthétique de l’archive photographique », Anne Bénichou CV Photo, n° 59, 2002, p. 27-30. http://id.erudit.org/iderudit/21013ac
________________________
60 (Michel FRIZOT et all. 1994, p 399) ↑
62 (Michel FRIZOT et all.1994, p 401) ↑
Questions Fréquemment Posées
Quelles sont les stratégies d’implémentation pour la photographie documentaire en Haïti pendant l’occupation américaine ?
L’article analyse comment les photographes créent des images inédites qui dépassent leur fonction documentaire initiale, en se concentrant sur les codes vestimentaires et les postures des personnages.
Comment la photographie documentaire contribue-t-elle à la connaissance historique ?
La photographie documentaire sert davantage la connaissance par son contenu, en se référant à l’histoire et à l’ethnologie, et profite à l’histoire sociale, économique et politique.
Quelle est l’importance d’Eugene Atget dans l’histoire de la photographie ?
Eugene Atget est considéré comme un personnage clé dans la transition de la photographie, marquant le passage d’une culture iconographique à une autre fondée sur la démonstration et l’accès à un public.