Les résultats financiers de la REGIDESO révèlent des insights surprenants sur sa performance, mettant en lumière des dimensions souvent négligées. Cette étude critique transforme notre compréhension des enjeux financiers, offrant des implications essentielles pour les gestionnaires et les chercheurs dans le domaine.
CHAPITRE 1. REVUE THEORIQUE ET EMPIRIQUE SUR LES PERFORMANCES FINANCIERES D’UNE ENTREPRISE
La notion de la performance demeure un concept polyvalent qui peut revêtir diverses significations en fonction de l’auteur ou de l’évaluation en question. Afin d’approfondir notre compréhension de la performance financière, nous avons divisé ce chapitre en trois sections : la revue théorique, la revue empirique et la contextualisation de l’étude. La revue théorique nous permettra d’appréhender les différentes théories existantes concernant l’évaluation de la performance financière. En ce qui concerne la revue empirique, elle nous permettra d’examiner les recherches antérieures portant sur le même sujet que le nôtre, d’analyser leur méthodologie et d’étudier leurs résultats. La contextualisation nous aidera à situer le cadre contextuel de notre étude sur l’évaluation de la performance financière de la REGIDESO.
REVUE THEORIQUE SUR LA PERFORMANCE FINANCIERE
Il existe plusieurs courants théoriques concernant la performance des entreprises, et dans les lignes qui suivent, nous en examinerons quelques-uns.
Théories sur performance financière
- La conception Classique
Le courant classique concernant la performance financière des entreprises repose sur diverses théories, parmi lesquelles on retrouve la théorie de l’agence, la théorie des coûts de transaction et la théorie de la firme.
Théorie d’agence (Agency Theory)
Michael C. Jensen et William H. Meckling (1976), dans leur livre « Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure », se penchent sur la dynamique entre les propriétaires d’une entreprise (les actionnaires) et ses gestionnaires, explorant ainsi l’influence de cette relation sur le comportement des deux parties.
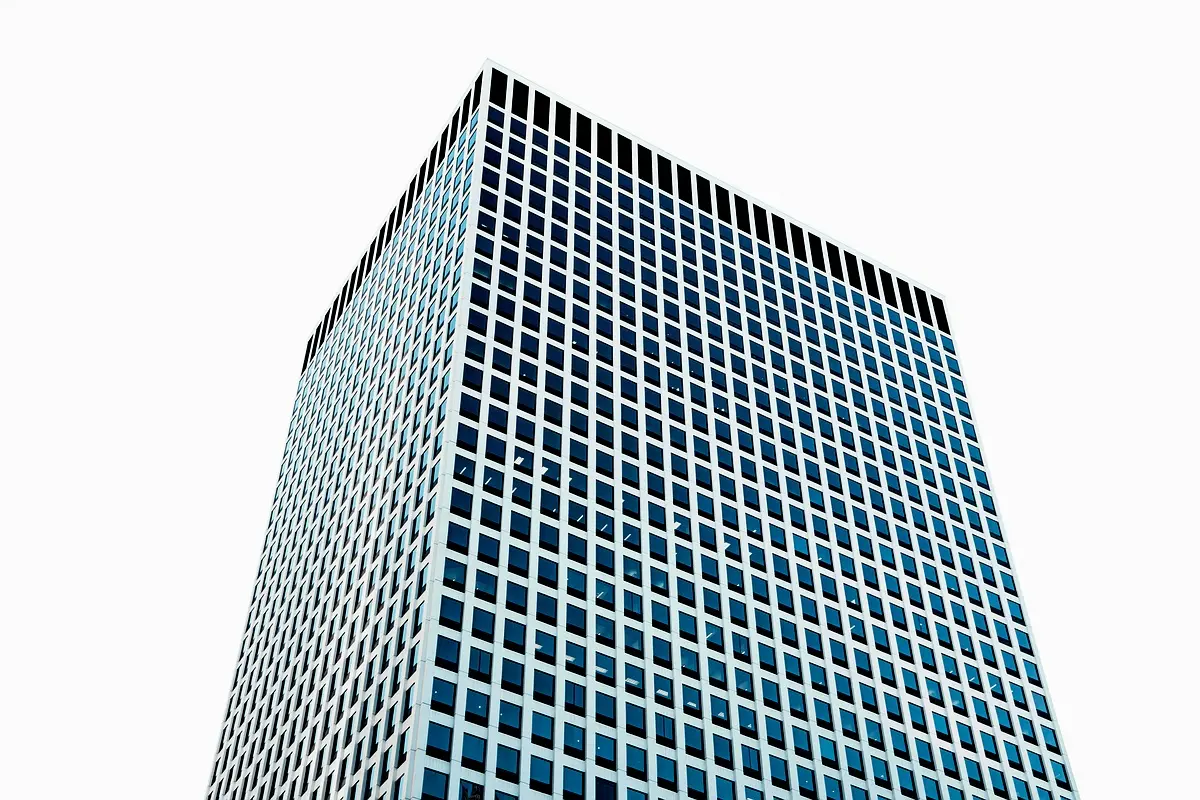
Les auteurs mettent en lumière la propension des gestionnaires à agir dans leur intérêt personnel plutôt que dans celui des actionnaires, créant ainsi un problème d’agence. Ce problème se traduit par des coûts, connus sous le nom de coûts d’agence, qui surgissent lorsque les objectifs des gestionnaires ne coïncident pas avec ceux des actionnaires.
Jensen et Meckling avancent que la structure de propriété de l’entreprise peut façonner les actions des gestionnaires. Par exemple, une participation accrue des gestionnaires dans l’entreprise peut les motiver à prendre des décisions plus en phase avec les intérêts des actionnaires.
Cette théorie explore les interactions d’agence entre les actionnaires et les dirigeants d’une entreprise, mettant en relief les conflits d’intérêts potentiels et la manière dont les contrats et les incitations peuvent être déployés pour aligner les intérêts des deux parties.
Théorie des coûts de transaction (Transaction Cost theory)
Olivier E. Williamson (1985), dans son ouvrage « The Economic Institutions of Capitalism », a profondément influencé la théorie économique et la pensée organisationnelle. Williamson, un économiste américain, est principalement connu pour ses travaux sur la théorie des coûts de transaction.
Dans ce livre, Williamson développe sa théorie des coûts de transaction, qui examine comment les coûts liés à la coordination des activités économiques influencent la structure des organisations et des marchés. Il souligne l’importance des institutions économiques, telles que les contrats, les arrangements de gouvernance et les structures organisationnelles, dans la réduction des coûts de transaction et l’amélioration de l’efficacité économique.
Williamson met en avant l’idée que les entreprises sont des structures de gouvernance qui émergent pour résoudre les problèmes de coordination et de conflits d’intérêts entre les parties prenantes. Il explore également les concepts de hiérarchie et de marché comme modes de coordination économique, en soulignant les avantages et les inconvénients de chacun.
L’auteur soutient que les entreprises existent en raison des coûts de transaction associés à la coordination des activités économiques. Il met en avant l’importance de la structure organisationnelle pour réduire ces coûts.
Théorie de la firme (Firm Theory)
Ronald H. Coase (1937), dans son article « The Nature of the Firm » a marqué le début de ce qu’on appelle maintenant la théorie de la firme. Dans cet article, Coase aborde la question fondamentale de pourquoi les entreprises existent et comment elles sont organisées.
Coase remet en question l’idée que les entreprises existent principalement en raison de l’efficacité de la production à grande échelle. Au lieu de cela, il met en avant le concept de coûts de transaction, qui sont les coûts associés à la coordination des activités économiques sur des marchés. Selon Coase, les entreprises émergent en raison de la nécessité de réduire ces coûts de transaction.
Il avance l’idée que les firmes sont des entités qui regroupent des activités économiques internes pour réduire les coûts de transaction liés à la coordination sur le marché. En d’autres termes, les entreprises existent pour rationaliser les processus de production et de coordination en interne, plutôt que de les laisser entièrement au marché.
En somme, Coase explore pourquoi les entreprises existent et pourquoi certaines activités économiques sont organisées en interne plutôt que sur le marché. Il met en avant l’importance des coûts de transaction et des coûts de production dans la prise de décision des entreprises.
Autres théories sur la performance des entreprises
- La théorie de la création de valeur
Le livre « Creating Shareholder Value: A Guide for Managers and Investors », écrit par Alfred Rappaport (1986), demeure une référence incontournable dans le domaine de la finance d’entreprise et de la gestion. L’auteur y approfondit la théorie de la création de valeur, abordant les points essentiels suivants :
- Concentration sur la création de valeur pour les actionnaires : Rappaport souligne l’impératif pour les entreprises de se focaliser sur la création de valeur pour les actionnaires. Il affirme que les décisions prises par les dirigeants doivent être dictées par leur impact sur la valeur des actions de l’entreprise.
- Mesure de la création de valeur : L’auteur propose diverses méthodes pour évaluer la création de valeur, incluant l’usage d’outils tels que l’analyse de rentabilité, le calcul de la valeur actualisée nette (VAN) et l’estimation du coût du capital.
- Alignement des intérêts des investisseurs et des gestionnaires : Rappaport insiste sur l’importance d’harmoniser les intérêts des actionnaires et des cadres dirigeants. Il affirme que les incitations financières des dirigeants doivent être en corrélation avec la performance de l’entreprise et la création de valeur pour les actionnaires.
- Gestion de portefeuille : L’auteur explore la gestion de portefeuille d’entreprises, mettant en lumière l’importance pour les investisseurs de diversifier leurs portefeuilles d’actions en fonction de leurs objectifs de création de valeur.
- Communication avec les investisseurs : Rappaport souligne l’importance pour les entreprises de communiquer de manière transparente avec les investisseurs concernant leur stratégie de création de valeur et leur performance financière.
Théorie des ressources et des capacités
La théorie des ressources et des capacités, largement développée par Jay Barney (1991) dans son article intitulé « Ressources-Based View of the Firm », constitue un pilier essentiel de la stratégie d’entreprise. Barney avance l’idée fondamentale que les ressources internes d’une entreprise, telles que ses compétences, ses connaissances, ses actifs et ses capacités stratégiques uniques, représentent des sources primordiales d’avantages concurrentiels durables. Selon lui, ce ne sont pas uniquement les ressources en tant que telles qui revêtent de l’importance, mais également la capacité de l’entreprise à exploiter, à intégrer et à gérer ces ressources de manière stratégique.
Barney met en exergue deux critères majeurs pour évaluer si une ressource peut constituer une source d’avantage concurrentiel durable : la rareté et l’incopiableté. En effet, les ressources rares et difficiles à imiter sont susceptibles de procurer à une entreprise un avantage compétitif durable et significatif sur ses concurrents.
Birger Wernerfelt (1984) a exploré en profondeur cette théorie avant Barney dans son œuvre intitulée « A Resource-Based View of the Firm ». Il a exercé une influence significative sur la théorie de la stratégie d’entreprise, en introduisant le concept de la vue basée sur les ressources (Resource-Based View, RBV), transformant ainsi la manière dont les entreprises envisagent leurs avantages concurrentiels.
Les points clés qu’il aborde sont les suivants :
- Concept central : La RBV met l’accent sur les ressources internes d’une entreprise (telles que les compétences, les technologies, les actifs, etc.) en tant que principaux déterminants de la performance et de la compétitivité à long terme.
- Avantages concurrentiels durables : Selon Wernerfelt, les avantages concurrentiels durables découlent non seulement de l’environnement externe, mais également des ressources spécifiques, rares, difficiles à imiter et non substituables détenues par une entreprise.
- Hétérogénéité des ressources : Les entreprises se distinguent les unes des autres en raison de la diversité et de la spécificité de leurs ressources. Cette hétérogénéité est ce qui crée des avantages concurrentiels durables.
- Imitation et substitution : Wernerfelt souligne que pour qu’une ressource soit une source d’avantage concurrentiel, elle doit être difficile à imiter ou à substituer par les concurrents.
- Limites de l’approche RBV : Bien que puissante, l’approche RBV présente des limites. Par exemple, elle ne prend pas pleinement en compte les aspects dynamiques de la concurrence et de l’innovation.
En somme, l’œuvre de Birger Wernerfelt a posé les fondements de la théorie de la vue basée sur les ressources, mettant en lumière l’importance des ressources internes des entreprises dans la création d’avantages concurrentiels durables.
Questions Fréquemment Posées
Quels sont les principaux axes d’évaluation de la performance financière de la REGIDESO ?
Cette recherche explore l’évaluation de la performance financière de la REGIDESO en examinant trois dimensions principales : la productivité des actifs, la liquidité et la structure financière garantissant la rentabilité.
Quelle méthodologie est utilisée pour évaluer la performance financière de la REGIDESO ?
L’étude utilise une méthodologie combinant recherche documentaire et analyse des ratios financiers pour tester trois hypothèses formulées.
Quelles limitations sont identifiées dans l’évaluation de la performance financière de la REGIDESO ?
Des limitations sont identifiées, notamment la concentration sur l’analyse du bilan et la portée temporelle limitée, ouvrant des pistes pour des recherches futures plus complètes.