La répression de la cybercriminalité révèle des lacunes surprenantes dans le Code congolais du numérique de 2023. Cette étude comparative entre les droits français et congolais met en lumière des défis cruciaux, avec des propositions innovantes pour renforcer l’efficacité des dispositifs législatifs.
Université Officielle de MbujiMayi
Faculté de Droit
Département de Droit privé et judiciaire
Travail de fin d’études présenté et défendu publiquement en vue de l’obtention du grade de Licencié en Droit
La Répression de la Cybercriminalité à l’Ère du Code Congolais du Numérique :
Étude comparative entre les droits français et congolais
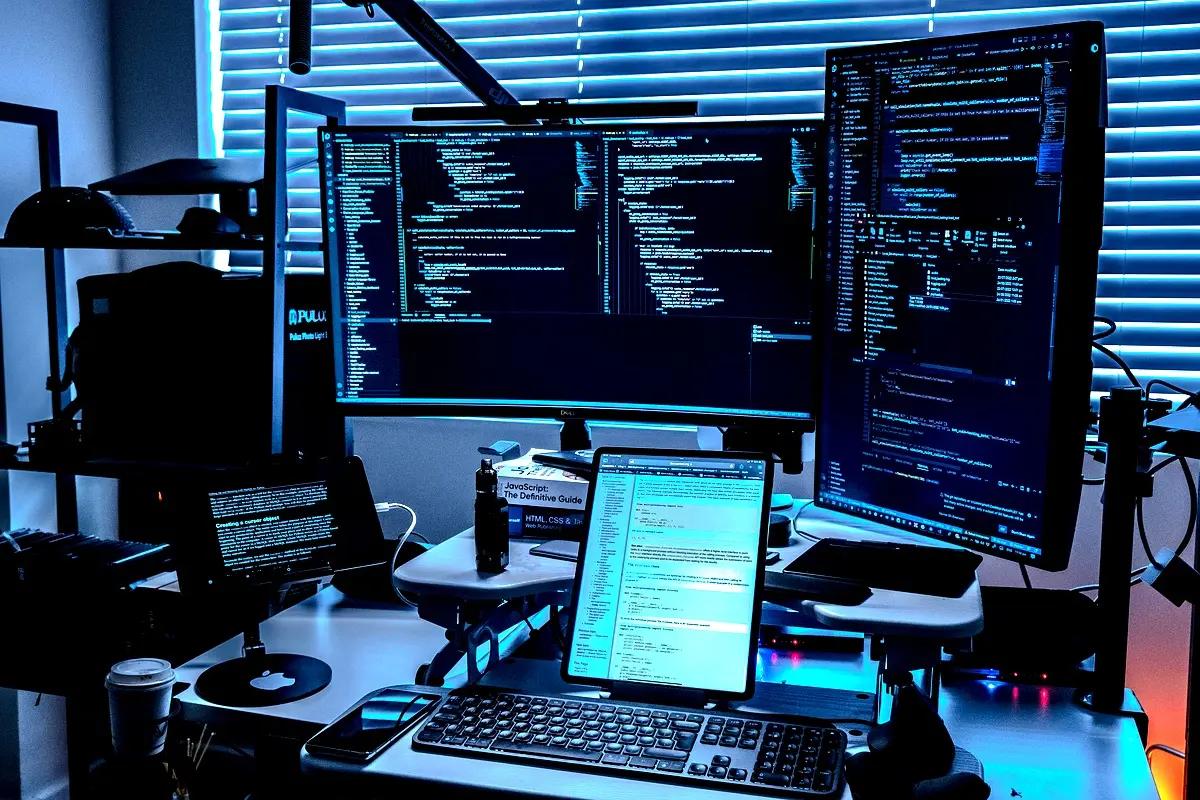
Par : Henri Thomas Lupantshia Kangomba
Supervisé par : Prof. Hillaire Kabuya Kabeya Tshilobo
Encadreur : Georges Bukasa Mpunga
Année académique 2023-2024
Introduction
Le présent siècle, caractérisé par le progrès technique et industriel, voit l’apparition des technologies numériques comme la fin du moyen âge a vu celle de l’imprimerie. Parmi ces nouvelles technologies de l’information et de la communication, figure l’internet. Cette révolution contemporaine est notamment liée à la structure même d’internet et de l’espace virtuel qu’elle génère : « le cyberespace ».
L’ère numérique ignore désormais toutes les frontières. Elle unit aujourd’hui des individus de presque toute la terre. Elle permet l’accès à la culture et à la connaissance, favorise les échanges entre les personnes. Elle rend possible la constitution d’une économie en ligne et rapproche le citoyen de son administration. Les technologies numériques sont porteuses d’innovations et de croissance, en même temps qu’elles peuvent aider ou accélérer le développement des pays émergents.1
Mais un certain pessimisme vient tempérer cette approche idéaliste. Tous les progrès génèrent aussi de nouvelles fragilités et vulnérabilités propices aux menaces ou aux risques, car ils aiguisent l’imagination des criminels. En effet, puisque toute invention humaine porteuse de progrès peut être aussi génératrice de comportements illicites et comme toute vie humaine, la vie numérique ne se voit pas dépourvue de problèmes.
Le coté élogieux d’internet occulte la face la plus redoutable ; et parmi les menaces liées à cet outil, une se démarque par sa dangerosité et sa complexité : la cybercriminalité.2 Celle-ci est l’une des nouvelles formes de criminalité ou de délinquance3 sur le réseau Internet, dont les
1 Romain Boos., La lutte contre la cybercriminalité au regard de l’action des Etats, thèse de doctorat en Droit privé et sciences criminelles, faculté de droit et sciences économiques et de gestion, université de Lorraine, 2016, p. 23 ;
2 Trésor-Gautier Mitongo Kalonji, Notions de cybercriminalité : praxis d’une pénalisation de la délinquance électronique en Droit pénal Congolais, Éditions ScienceNet, Lubumbashi, août 2010, p.2, version électronique ;
3 Nous préférons le terme de délinquance à celui de criminalité, compte tenu de l’approche juridique du thème sous analyse.
Conséquences se révèlent être particulièrement graves pour la sécurité humaine. Par le biais des Technologies d’information et de la communication, du système informatique ou de l’Internet,4 les quidams, éditeurs en ligne, les utilisateurs des réseaux électroniques tels que Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp,…, sont de nos jours propagateurs des actes attentatoires à la pudeur, à l’intégrité des personnes ainsi que de tout autre crime de nature numérique ou non. L’espace numérique est devenu rébarbatif à l’égard des certaines personnes.5
De toute évidence, Colin Rose souligne que « la cybercriminalité est la troisième grande menace au monde après les armes chimiques, bactériologiques et nucléaires ».6 C’est « un véritable tsunami7 informatique au regard des dégâts et pertes qu’elle occasionne8 », souligne un spécialiste congolais en cybercriminalité. « En plus, estime toujours ce dernier, il ne serait pas exagéré de la qualifier de SIDA numérique ou informatique ».9
La cybercriminalité est désormais une réalité. Elle est d’autant plus dangereuse qu’elle pénètre au sein des familles, là où la délinquance ordinaire n’avait pas accès jusqu’à présent.
4 Kodjo Ndukuma Adjayi, Cyber droit, télécoms, internet, contrats de e-commerce : Une Contribution au Droit congolais, Presses universitaires du Congo P.U.C. Kinshasa, 2009 P 45.
5 Obed Kongolo Kanowa, Responsabilité pénale des personnes morales à l’aune de L’ordonnance-loi N° 23/010 DU 13 MARS 2023 portant code du numérique Congolais, 2023, p. 2.
6 Colin Rose, cité par Mohammed Chawki, Essai sur la notion de cybercriminalité, IEHEI, Juillet 2006, p.2 (disponible sur le site www.iehei.org ).
7 Tsunami : terme japonais désignant une « vague gigantesque, souvent destructrice, résultant habituellement d’un tremblement de terre ou d’un volcan sous-marin ; aussi appelé raz-de-marée » (voir la définition de tsunami dans le glossaire disponible sur www.dfo-mpo.gc.ca ). Ce terme est employé par Mukadi pour, estimons-nous, marquer l’ampleur du danger que revêt le phénomène cybercriminalité.
8 Emmanuel Mukadi Musuyi, La cybercriminalité est une réalité en RDCONGO, article disponible sur http://www.digitalcongo.net/article/47215, consulté le 8 juillet 2024 à 19h30’ ;
9 Emmanuel Mukadi Musuyi, Cybercriminalité, le SIDA informatique, in la Revue Lubila N°001 du 18 au 31 Janvier 2008, disponible sur http://www.lepotentiel.com, consulté le 8 juillet 2024, à 19h35’.
La cybercriminalité représente un défi majeur pour les États modernes, affectant à la fois la sécurité des citoyens et l’intégrité des systèmes d’information. La montée en puissance des technologies numériques a conduit les législateurs à élaborer des cadres juridiques adaptés pour lutter contre les infractions liées au numérique. Le législateur congolais ne pouvait pas faire exception.
La répression de la cybercriminalité en République Démocratique du Congo a été le souhait de plusieurs, et demeurait l’un des points focaux eu égard à l’adaptation de la justice Congolaise à l’évolution sociale.
Il était donc d’un souci majeur, d’une préoccupation gigantesque et d’un intérêt crucial de doter la RDC d’un texte juridique régissant le secteur numérique.
Il a fallu attendre 2023, pour que la RDC se dote effectivement d’un code du numérique, lequel, traite plusieurs questions relatives au système informatique et sanctionne pénalement certains actes délictueux commis constamment et de manière répétitive sur cet espace dit numérique. Il s’agit donc, en effet, de l’ordonnance-loi N° 23/010 du 13 Mars 2023 portant code Congolais du numérique.
Ce code du numérique Congolais, tant attendu avec espoir bien sûr de juguler ce phénomène en RDC, ne se fait pas cependant sentir sur terrain. En plus, cette loi revêt tant d’insuffisances au point de ne pas punir la cybercriminalité.
Cette insuffisance a rendu nécessaire une étude comparative entre le Droit pénal Congolais et celui Français sur le plan de la répression de la cybercriminalité.
Notre démarche sera alors d’étudier la répression de la cybercriminalité à travers le prisme du Code Congolais du numérique, en analysant le cadre juridique relatif à la cybercriminalité en France et en République Démocratique du Congo ; évaluer l’efficacité des dispositifs de répression prévus par le Code Congolais du numérique en les comparant à ceux du droit français ; identifier les défis et les failles dans l’application de la législation sur la cybercriminalité en RDC ; pour proposer enfin des solutions pour une amélioration.
En effet, même si la problématique est posée de façon pertinente, il est recommandé à tout chercheur de vérifier les résultats de recherches antérieures, ainsi que toute la documentation sur la théorie qui pourrait se rapporter au thème de sa recherche ; c’est l’état de la question.10
L’état de la question qui n’est pas à confondre avec un simple alignement des opinions des auteurs sur un sujet donné, « est une synthèse critique des écrits existants ».11
L’état de la question est, selon Victor Kalunga Tshikala, un relevé de publications antérieures qui, de manière directe ou indirecte, ont porté sur le même thème et non sur le même sujet que celui abordé par l’auteur.12
Ainsi, nous conformant à cette exigence scientifique, nous avons compulsé quelques travaux relevant du domaine de recherche dans lequel s’inscrit la présente étude, dont :
- Romain Boos, thèse de doctorat en Droit, intitulée : « la lutte contre la cybercriminalité au regard de l’action des Etats »13
L’auteur fait un constat selon lequel la montée en puissance des technologies numériques, en dépit des multiples avantages, favorise la perpétration et le développement des infractions en ligne ou celles facilitées par les nouvelles technologies de l’information et de la communication. Les progrès techniques accroissent les risques d’abus, car il est désormais possible d’attaquer loin des lieux du crime, et, avec la possibilité relative d’anonymat qu’offre le réseau informatique, d’échapper à la répression. La sensation de crainte des poursuites est donc réduite à des impulsions virtuelles.
L’auteur continue son constat, on a également pu constater l’existence de lacunes qui vont à l’encontre des ambitions de la lutte contre toutes les formes de la cybercriminalité. Mais il serait inopportun de conclure que le cadre juridique français n’est pas bien adapté. On ne saurait pas dire non plus que ce cadre est le mieux adapté de tous.
L’arsenal répressif français de lutte contre la cybercriminalité est plutôt complet puisqu’il permet de viser l’ensemble du champ des infractions cybercriminelles. Mais il peine à mettre sur pied ses dispositions, notamment en matière d’enquête de procédure pénale. « Le fait que l’Internet, par sa technique, son ubiquité, son insensibilité aux frontières étatiques, emporte des conséquences sur la manière d’envisager l’application du droit et sa capacité à produire les résultats souhaités soulève la question de la nécessité d’adapter le droit pénal international ».
Nous nous accordons avec l’auteur en effet, lorsqu’il propose la création (l’adoption) d’un code pénal international qui pourrait constituer une réponse adaptée ; la convention de Budapest, seul instrument international de lutte contre la cybercriminalité adopté jusqu’ici, puisque non contraignante, n’arrive pas à fédérer tous les Etats.
Questions Fréquemment Posées
Qu’est-ce que la cybercriminalité selon le Code Congolais du Numérique?
La cybercriminalité est l’une des nouvelles formes de criminalité ou de délinquance sur le réseau Internet, dont les conséquences se révèlent être particulièrement graves pour la sécurité humaine.
Comment le Code Congolais du Numérique de 2023 aborde-t-il la répression de la cybercriminalité?
Le Code Congolais du Numérique adopté en 2023 introduit des dispositifs répressifs pour lutter contre la cybercriminalité, mais l’article identifie également des défis et des failles dans son application.
Pourquoi la cybercriminalité est-elle considérée comme une menace majeure?
Colin Rose souligne que la cybercriminalité est la troisième grande menace au monde après les armes chimiques, bactériologiques et nucléaires, et elle est qualifiée de véritable tsunami informatique en raison des dégâts qu’elle occasionne.