La réinsertion des ex-détenus à Maroua révèle des défis surprenants en matière d’estime de soi et de confiance. Cette étude innovante propose la programmation neurolinguistique comme solution potentielle, offrant des perspectives cruciales pour leur développement personnel et leur intégration sociale.
CHAPITRE 1 PROBLÉMATIQUE
Dans ce chapitre, nous formulons la problématique de recherche articulée autour du développement personnel des ex-détenus jeunes adultes de la Prison Centrale de Maroua. Ce chapitre est constitué du contexte et justification de l’étude, la formulation du problème, des questions, des hypothèses, de l’intérêt de l’étude et de la délimitation de la recherche.
Contexte et justification de l’étude
Il est question dans cette articulation de décrire l’actualité autour du problème et d’énoncer les principales motivations qui nous ont orientées dans le choix de la présente thématique.
Contexte de l’étude
La description du contexte de notre étude se fera sur le plan international, national et au niveau de la ville de Maroua.
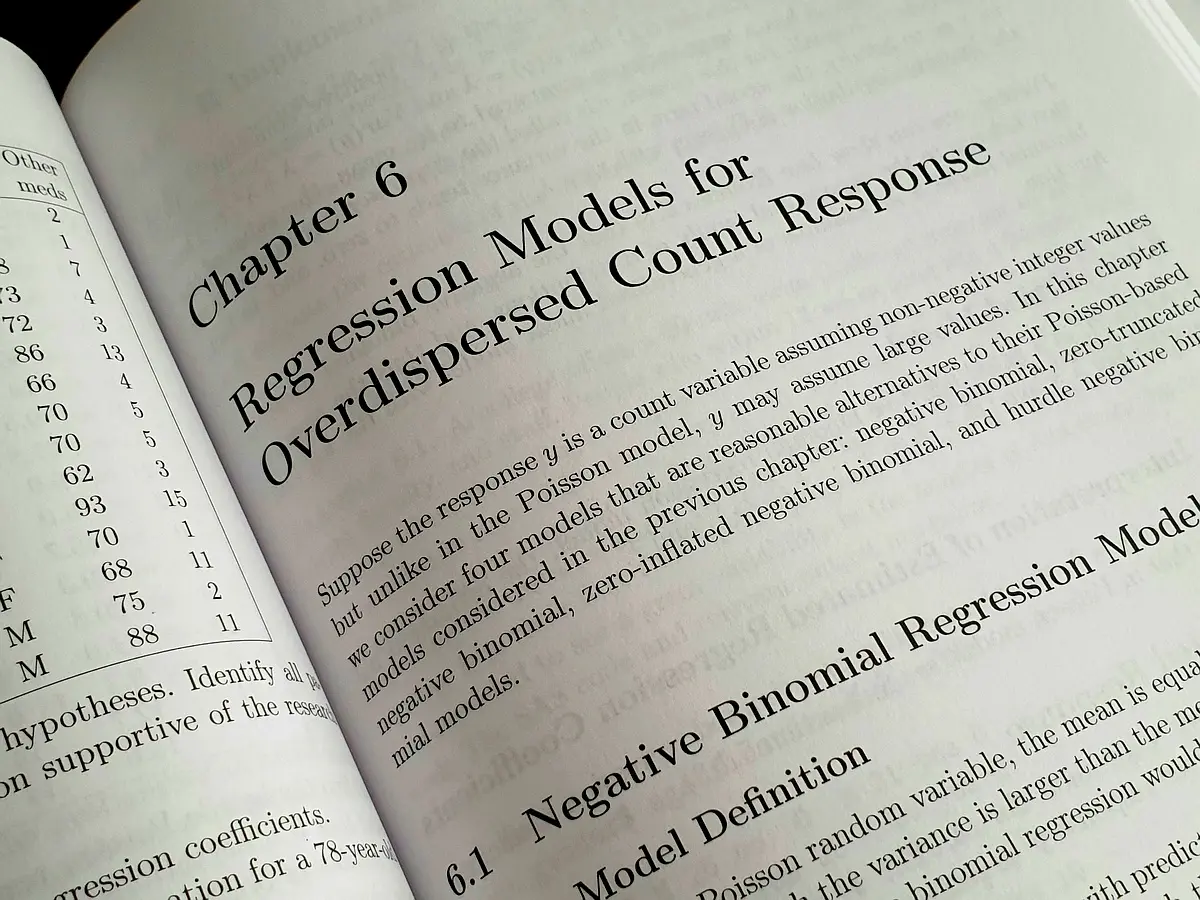
Contexte international
Sur le plan mondial, les statistiques nous montrent une évolution permanente du taux d’incarcération des détenus adolescents. En effet, l’Office des Nations Unies de Lutte Contre la Drogue et le Crime (UNIDOC, 2020) estime que chaque année environ 16 Millions d’adolescents entre en prison soit un taux de représentativité de 47% de la population carcérale mondiale. En fonction du type d’infraction commise et de la peine d’emprisonnement prononcée, ce détenu adolescent peut à sa sortie de prison être un jeune adulte ce qui nous intéresse particulièrement dans cette étude.
De façon plus détaillé, le rapport de l’UNIDOC (2020) précise que la population adolescente que l’on trouve dans les prisons sur le plan mondial est composée d’hommes à hauteur 96,4 % de la population carcérale générale. L’âge moyen de la population carcérale est de 34,2 ans. Le niveau d’instruction des individus en détention est relativement faible puisque 41 % se sont arrêtés en primaire et 10,7 % sont illettrés. En outre, 80% des personnes détenues sont prévenues et la durée d’incarcération est d’environ 5 ans.
À l’heure actuelle, beaucoup de chercheurs essayent d’élaborer des raisons explicatives de l’émergence de ce phénomène. Pour Sid et Blatier, face à l’insécurité et la criminalité, la prison est pour le grand public, un lieu de punition extrême. Car elle est davantage représentée comme une solution socialement utile et efficace plutôt qu’un univers complexe et bien trop souvent néfaste. Allant dans ce sens, pour bon nombre de professionnels de la justice et de l’éducation spécialisée, l’incarcération apparaît comme l’ultime recours face à de graves comportements de délinquance très souvent associés à la violence.
En effet, lors de la remise en liberté, les délinquants en général et les ex-détenus jeunes adultes en particulier doivent faire face à toute une série de problèmes, de nature sociale, économique et personnelle, qui font obstacle à un mode de vie en respect de la loi (Borzycki et Baldry, 2003).
Parmi ces problèmes, certains relèvent des expériences passées du délinquant, d’autres sont directement associés aux conséquences de l’incarcération et aux difficultés du retour dans la communauté (Borzycki, 2005). Certains détenus ont un passé fait d’isolation sociale et de marginalité, d’abus physiques et psychiques, d’emplois précaires ou de chômage, voire d’un mode de vie criminel adopté dès leur plus jeune âge.
D’autres sont affectés par des handicaps physiques et/ou psychiques, voire par des problèmes de santé reliés à l’abus de substances et à la toxicomanie.
D’autres encore doivent composer avec des déficits comme les difficultés dans les relations sociales, un niveau de scolarisation insuffisant, l’analphabétisme, un fonctionnement cognitif et émotionnel déficitaire, l’incapacité de planifier et gérer un budget : difficultés qui réduisent d’emblée leurs chances de succès dans une société compétitive. Par ailleurs, le retour à la vie en liberté n’est pas sans poser une multitude de problèmes très concrets, comme trouver un logement convenable avec peu ou pas de moyens, s’en sortir financièrement en attendant un emploi, se procurer des biens de première nécessité, accéder à des services et à de l’assistance couvrant des besoins spécifiques.
Aux difficultés du passage de l’emprisonnement à la vie en liberté s’ajoute le stress inhérent à la supervision au sein de la communauté.
Or, au vu des conséquences, on ne peut toutefois nier que la plupart des psychopédagogues spécialistes de la rééducation perçoivent l’incarcération comme l’expression d’un échec cuisant des mécanismes de prévention et d’accompagnement socio-éducatif. Ceci est d’autant plus vrai lorsque cela concerne des mineurs et des jeunes majeurs : une population qui traduit sans doute la grande difficulté d’un système social, pris dans sa globalité, à œuvrer dans le sens d’une évolution favorable à la fois pour sa jeunesse que pour son environnement social.
En plus, un retour dans la communauté qui se solde par un échec entraîne des coûts sociaux non négligeables, que ce soit financièrement ou au niveau de la sécurité publique. Il importe donc d’évaluer les coûts des programmes facilitant la réinsertion sociale des délinquants en tenant compte des coûts sociaux et économiques importants que de tels programmes ont permis d’éviter.
Au vu de cette situation, de multiples initiatives sont développées pour briser le cercle vicieux qui fait obstacle à la réadaptation sociale des délinquants remis en liberté. C’est à ce titre que les programmes de prévention du crime inclus des mesures efficaces de réduction de la récidive. Par ailleurs, les ex-détenus sont confrontés à de problèmes qui affectent leur aptitude à devenir des citoyens respectueux de la loi. Cet état de lieu se dégage quasiment dans tous les pays du monde (United Nations Office on Drugs and Crime, 2006). À travers le monde, chaque pays essaie de développer des stratégies de réduction du crime en milieu communautaire.
À titre d’illustration, en 2006, la Colombie a mis sur pied un dispositif pour réduire la criminalité et la récidive et, en même temps, de mobiliser les ressources de la communauté pour favoriser la réhabilitation et la réintégration des délinquants. Cette stratégie se distingue par l’implication d’un grand nombre de partenaires (organisations à but non lucratif, les services correctionnels communautaires, la commission scolaire, la chambre de commerce et les organismes communautaires) et par une approche tenant compte des différents aspects de la criminalité et des délinquants. Les détails de l’approche ont été développés et planifiés par un groupe de travail pour la sécurité publique et la réduction du crime, sous la responsabilité du maire.
Chacune des quatre composantes de la stratégie couvre plusieurs initiatives spécifiques, et notamment :
–La prévention du crime et la dissuasion : comprend une initiative pour assurer la sécurité dans les moyens de transport ; des programmes de formation et de conscientisation ; la mise en place de groupes d’action pour contrer la drogue dans la communauté ; des unités de logement sans crime ; des programmes d’intervention ciblant les jeunes, etc.
–L’arrestation et la poursuite des délinquants : inclut l’identification des délinquants multirécidivistes et des quartiers chauds (hot spots) ; la mise en place d’un modèle de tribunal communautaire et d’un tribunal de nuit, et la création d’un groupe pour la gestion des délinquants multirécidivistes.
-La réhabilitation et la réintégration des délinquants : comprend le traitement des délinquants en collaboration avec des institutions à but non lucratif et des institutions privées ; l’accréditation de maisons de réadaptation (recovery houses) ; la création d’une fondation pour le logement et les sans-abri ; des programmes de formation scolaire et professionnelle ; des groupes de soutien communautaire, etc.
-La perception et la réalité du crime : inclut la mise en place d’une stratégie de communication ; la création de groupes d’action communautaires ; le travail avec les personnes âgées et les autres groupes vulnérables, etc.
En Afrique, notamment en Algérie l’expérience de l’encadrement des ex-détenus jeunes adultes est davantage centrée sur le rôle fondamental des Psychologues. Dans la société actuelle le métier de psychologue se trouve en constante évolution. La réalité sociale évolue, les comportements humains et leurs valeurs changent, en conséquence les méthodes thérapeutiques et la prise en charge psychologique varient en fonction des nouveaux besoins.
Traditionnellement la prise en charge des ex-détenus jeunes adultes, effectuée par les psychologues se base sur la demande. Ceci avec une approche de psychologue clinique pure. La plupart du temps est dédiée à l’évaluation, avec les anamnèses et la passation de tests aux psychothérapies de soutien et à la relaxation pour les patients agités.
En France, la consultation psychologique est assurée à tous les ex-détenus jeunes adultes au moment de leur sortie pour tester leurs aptitudes au travail et pour les informer des dispositifs de réinsertion existants. Bien plus, avec l’implémentation du Programme de Réinsertion et le Plan Individuel de Réinsertion, le travail des psychologues a pris une nouvelle dimension, en abandonnant probablement cette approche plus clinique par d’autre d’un type plus social, cognitive et comportementale.
Dans ce modèle, le rôle du thérapeute consiste à agir comme instigateur et à aider les clients à tenter activement d’obtenir un changement. En psychologie correctionnelle, la motivation à l’égard du traitement a été conceptualisée comme un facteur de risque dynamique, donc le personnel peut contribuer à motiver un délinquant à se faire traiter, c’est-à-dire qu’un personnel efficace peut renforcer la motivation, mais, à l’inverse, un personnel inefficace peut accroître la résistance au traitement.
En dehors des connaissances spécialisées, pour être un accompagnateur psychosocial de l’ex-détenu jeune adulte en France, l’individu doit disposer des cinq compétences de bases suivantes : relations et interactions, structuration et réaction à l’imprévu, connaissances personnelles utiles aux services à la personne, soutien social pour la prestation de services cliniquement appropriés et autres considérations.
Enfin, cette partie nous permet d’explorer la situation mondiale des ex-détenus jeunes adultes. Afin de mieux cerner notre problème de recherche, nous allons décrire le contexte du développement personnel des ex-détenus jeunes adultes au Cameroun.
Questions Fréquemment Posées
Quels sont les principaux défis de développement personnel des ex-détenus jeunes adultes à Maroua?
Les ex-détenus jeunes adultes de la Prison Centrale de Maroua rencontrent des problèmes d’estime de soi et de confiance en soi, ainsi que des difficultés sociales, économiques et personnelles qui font obstacle à leur réinsertion.
Comment la programmation neurolinguistique peut-elle aider les ex-détenus à Maroua?
L’étude propose que la programmation neurolinguistique pourrait favoriser la réinsertion sociale et le développement personnel des ex-détenus jeunes adultes.
Quelle est l’importance de l’éducation pour les ex-détenus jeunes adultes?
Le niveau d’instruction des individus en détention est relativement faible, avec 41 % s’étant arrêtés en primaire et 10,7 % étant illettrés, ce qui réduit leurs chances de succès dans une société compétitive.