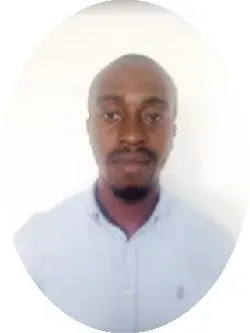Les perspectives futures des échanges CEMAC révèlent une réalité surprenante : malgré des attributs de qualité, les échanges intra-branche restent largement inexistants. Cette étude met en lumière les défis cruciaux auxquels font face ces pays, avec des implications significatives pour l’intégration économique régionale.
Résultats (voir annexe tableau GLi) :
Nous remarquons qu’entre le Gabon et Cameroun, les échanges intra-branche sont majoritairement nuls car l’indice de Grubel Lloyd tend vers ou est égal à zéro.
Durant la période 2006-2016, on a majoritairement GLi=0, cela traduit que le Gabon a été soit exclusivement importateur ou exportateur.
- Pour l’huile de palme raffinée, le Gabon a été exclusivement importateur. Cependant, nous apercevons néanmoins en 2013, une forte présence de l’intra-branche (GLi= 0,99), ce qui est un motif d’espoir ;
- Pour le sucre raffiné, il y a présence d’intra-branche en 2008 (GLi= 0,46) mais le Gabon a été majoritairement importateur sur la période 2006- 2016;
Ces rares apparitions du commerce intra-branche se vérifient sur le marché gabonais et camerounais, car on y retrouve des variétés de sucre raffiné et d’huile de palme (différence de couleur, de forme, emballage…) mais dans l’optique d’une intensification des échanges communautaires, ceci est faible.
- Pour les biens huile brut de pétrole et viande de coq, les échanges intra- branche entre le Gabon et le Cameroun sont inexistantes ;
- Pour le bien bois plaques et bois stratifiés, le Gabon est majoritairement exportateur ;
La part de l’échange intra-branche dans le commerce total entre le Gabon et le Cameroun est majoritairement nulle. Cette faiblesse de l’indice de Grubel Lloyd, montre que les échanges intra-branches sont quasi inexistant voire marginaux pour les produits manufacturés, car la valeur obtenue ne tend pas vers 1.
De manière globale, ces deux pays à l’instar de tous les pays de la CEMAC, ne sont pas performants dans l’échange intra-branche or, c’est ce type de transactions qui domine l’économie mondial depuis 1970 (70% du commerce mondial) et favorise l’intégration économique d’une zone. Cette faiblesse des transactions croisées enregistrées par les pays de la sous-région incline à penser que le développement des économies d’échelle et la différenciation des produits sont des processus de production encore peu développés dans cette sous-région (François Ngangoue, 2016).

Contrairement à l’UEMOA (Bénin, Burkina-Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo), le développement des échanges intracommunautaire est plus lent dans la zone CEMAC, 2,1% (Moussone, 2010) contre 17,6% dans la zone UEMOA (Rapport sur la Politique Monétaire dans l’UEMOA, mars 2018). Ceci est expliqué part le fait que l’essentiel des échanges s’inscrit dans un schéma traditionnel comme décrit par les théories Classique et Néoclassique du commerce extérieur (François Ngangoue, 2016).
Les études empiriques ont démontré que l’échange intra-branche soutenu par une forte différenciation des produis est très important au sein des zones communautaires dans lesquelles le commerce intra-zone est intensif. De ce fait, l’instauration d’une stratégie de différenciation par attributs dans la CEMAC sera un des facteurs d’intensification des flux commerciaux intra-CEMAC. De plus, notre enquête exploratoire montre que sur 2253 enquêtés, 84,3% sont prêts à
acheter le meuble qui répond à leur préférence sur les autres marchés de la CEMAC autrement dit, ils sont favorables à la vente sur le marché domestique les meubles dont ils valorisent les attributs.
Le calcul des parts du marché des différents attributs significatifs du meuble (voir tableau 1 en annexe) révèle que les entreprises gagneraient à opter pour une politique marketing de diversification des produits pour bénéficier des économies d’échelles7 à l’exportation causé par une taille de marché plus importante. Le meuble fabriqué avec le Wenge a des plus grandes parts de marché qui lui sont conférés par ses attributs Design (Brun 69,9%) et l’attribut solidité (73,1%). De ce fait, producteurs gabonais ou camerounais devraient se lancer dans une stratégie de différenciation verticale car les consommateurs sont prêts à acheter à un prix cher le meuble qui répond à leurs préférences ce qui va être des économies d’échelles.
La faiblesse des échanges en zone CEMAC devraient être palier par les échanges intra-branches qui seront soutenus par une bonne différenciation par attributs car cette dernière conduite à une meilleure stratégie de différenciation des produits. Ainsi, les consommateurs gabonais pourront acheter les produits de leurs préférences sur les autres marchés de la CEMAC. L’étude menée sur le marché du bois peut être faite sur d’autres produits, cela permettra saisir au mieux les préférences des consommateurs de la sous-région.
2- Recommandations
La différenciation par attributs d’une part procure aux consommateurs des produits qui correspondent à leurs attentes ou préférences et d’autre part, elle génère aux producteurs des économies d’échelles. Elle permet l’apparition des produits différenciés sur le marché et favorise l’échange intra-branche qui va
7 Les économies d’échelle sont directement liées à la nature de l’activité comme le marketing, car les économies se font à partir de calculs de coûts fixes et du montant des ventes. C’est pour cette raison qu’il est de la coresponsabilité du service marketing de stimuler des offres caractérisées par l’aptitude à générer des économies d’échelle.
intensifier les échanges intra-CEMAC. A cet effet, nous formulons quelques recommandations :
- Vulgariser la théorie de la différenciation par attributs dans la CEMAC pour inciter les producteurs à tenir compte des préférences de leurs demandes en biens et services. En effet, l’analyse menée sur le terrain nous a permis de relever une forte demande différence8 qui doit être satisfaite. Les consommateurs exigeants souhaitent acheter des produits semblables mais non identiques et les entreprises doivent, pour répondre à ces nouvelles demandes des consommateurs, différencier leurs produits et éviter leur banalisation. L’importation devient alors indispensable pour étendre encore plus la gamme des produits offerts sur le marché intérieur et les demandes des partenaires étrangers vont favoriser les exportations.
- Investir dans la Recherche Développement pour favoriser l’apparition des nouveaux produits (innovation) pour améliorer la compétitivité des entreprises sur le marché de la CEMAC ;
- Mettre en place une réelle politique de diversification de l’économie pour amoindrir l’impact des perturbations des cours des matières sur les économies de la sous-région (ce que nous appelons la « marche vers une économie industrialisée », l’industrie est un moteur de transformation économique de beaucoup de pays en développement qui réussissent (Hinh, Dinh, et al., 2012) ;
- Dans le cadre de la filière bois, les états doivent rendre effectif la politique
d’incitation à la transformation du bois (troisième transformation9) afin de favoriser la production des produits manufacturés ;
8 LASSUDRIE-DUCHENE B., « La demande de différence et l’échange international », Economies et Sociétés, Tome V, 1971.
9 Ensemble des opérations effectuées sur les produits de la première ou deuxième transformation et qui permettent d’obtenir des produits finis (aucune transformation supplémentaire n’est nécessaire). Les produits issus de la troisième transformation sont par exemple les meubles, les menuiseries, les fermes industrielles, les parquets contrecollés, les tonneaux, les traverses de chemin de fer, les palettes, le papier, le carton…
- Compte tenu de la similitude des ressources des pays de la CEMAC, la mise en place de l’échange intra-branche favorisera l’intégration régionale qui peine à voir le jour. En effet, le processus d’intégration régionale dans le cadre des accords de libre-échange ou d’union douanière se trouve dépendante des échanges intra-branches. « L’intégration régionale aurait d’autant plus de chances d’impulser la croissance des pays membres qu’elle ferait progresser leurs échanges de produits similaires »
(Abdelmalki et al., 2001).
- Les entreprises devraient mettre en place la politique marketing-mix10 à savoir : politique produit, politique de prix, politique de distribution et politique communication dans le but de fidéliser, de gagner des nouveaux clients ;
- Les pays de la CEMAC devraient s’efforcer d’augmenter le niveau des investissements, d’améliorer la gouvernance, de mettre fin aux conflits, d’adopter des politiques budgétaires audacieuses et d’assurer la stabilité macroéconomique, parallèlement à la mise en œuvre de politiques industrielles et commerciales qui favorisent la diversification économique. Ces politiques auront pour effet de renforcer la diversification des exportations, ce qui permettra, en fin de compte, d’augmenter la contribution de la productivité totale des facteurs à la croissance économique et de tirer profit des préférences et de la libéralisation du commerce régional ;
- Les dirigeants de la CEMAC doivent supprimer les obstacles illégaux et le déroutement des marchandises sur les routes, puis aménager les grands axes routiers reliant les centres commerciaux dans la CEMAC. La suppression des obstacles aura pour but d’amplifier les échanges et de créer chez les commerçants un environnement favorable à la réalisation des bénéfices.
10 Plan marchéage ou politique marchéage, désigne dans le cadre d’une entreprise ou d’une marque d’ensemble cohérents de décisions relatives aux quatre volets que sont : politique de produit, politique de prix, politique de distribution et de communication.
CONCLUSION
Le présent travail nous a permis de montrer de façon théorique et empirique que la différenciation par attributs est un stimulus pour l’intensification des échanges en zone en générale, et dans la zone CEMAC en particulier. En effet, la différenciation par attributs relève l’importance des caractéristiques des produits dans les décisions d’achats des consommateurs en ce sens que ces derniers sélectionnent ou éliminent un produit par rapport à ces attributs. L’instauration de l’échange de qualité et de variété est un moteur de l’échange intracommunautaire par l’apparition de l’échange intra-branche car il permet aux entreprises de répondre aux besoins précis des consommateurs.
Les résultats de l’étude de l’impact des attributs du meuble sur les préférences des consommateurs établissent une forte liaison entre le comportement d’achat du meuble avec les attributs du bois qui a servi à la fabrication de ce meuble et les caractéristiques propres aux consommateurs. Toutes les variables du modèle sont significatives au seuil 1% ce qui nous permet de vérifier notre hypothèse.
Les pays de la CEMAC bénéficient d’une réduction des coûts de transaction du fait de la proximité géographique, linguistique et de la possession d’une monnaie commune ce qui est favorable à l’intégration économique mais cette intégration peine à voir le jour. Comme solution pour résoudre ce problème nous proposons la mise en œuvre de la stratégie de différenciation par attributs car cette dernière permet d’aboutir à une meilleure différenciation des produits (attribut de variété et attribut de qualité) qui est le fondement des échanges intra-branche.
________________________
2 Définition donnée par l’article 62 de la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai 2001. ↑
3 Auchan Les 4 Temps, La Défense. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quels sont les défis des échanges intra-branche entre le Gabon et le Cameroun ?
La part de l’échange intra-branche dans le commerce total entre le Gabon et le Cameroun est majoritairement nulle, ce qui montre que les échanges intra-branches sont quasi inexistants voire marginaux pour les produits manufacturés.
Comment la différenciation par attributs peut-elle influencer les échanges en CEMAC ?
L’instauration d’une stratégie de différenciation par attributs dans la CEMAC sera un des facteurs d’intensification des flux commerciaux intra-CEMAC.
Quelle est la performance des échanges intra-branche dans la zone CEMAC par rapport à l’UEMOA ?
Le développement des échanges intracommunautaires est plus lent dans la zone CEMAC, 2,1% contre 17,6% dans la zone UEMOA.