Les perspectives d’avenir identitaires révèlent un paradoxe fascinant : comment l’exil et le déracinement façonnent-ils la créativité littéraire ? Cette recherche met en lumière les tensions entre la langue française et la langue arabe, offrant des clés essentielles pour comprendre la quête identitaire de Leïla Sebbar.
La culture au milieu du jeu identitaire
L’identité culturelle est avant tout un ensemble des sources culturelles par lequel un individu ou un groupe d’individus se définit, se manifeste et souhaite être reconnu. La notion de culture est déterminé comme un ensemble regroupant l’identité, le mode de vie et de pensé caractérisant une société. Les cultures se multiplient, il est difficile de donner une définition universelle à ce concept parce qu’il n’existe pas une seule culture.
Pour comprendre cette transformation de la culture il faut d’abord assumer que la notion d’identité signifie deux dimensions diamétralement distinctes…parler d’identité
48 LE BOUCHER, Dominique, Traversière, dialogue avec Leila Sebbar, Paris, édition Marsa, 2015, p. 27
49 SEBBAR, Leïla, Je ne parle pas la langue de mon père, Paris, Julliard, p. 93
signifiait parler de racines, de souches, de territoire, de mémoire symbolique dense. C’est n’est qu’à partir de ceci qu’était construite l’identité.50
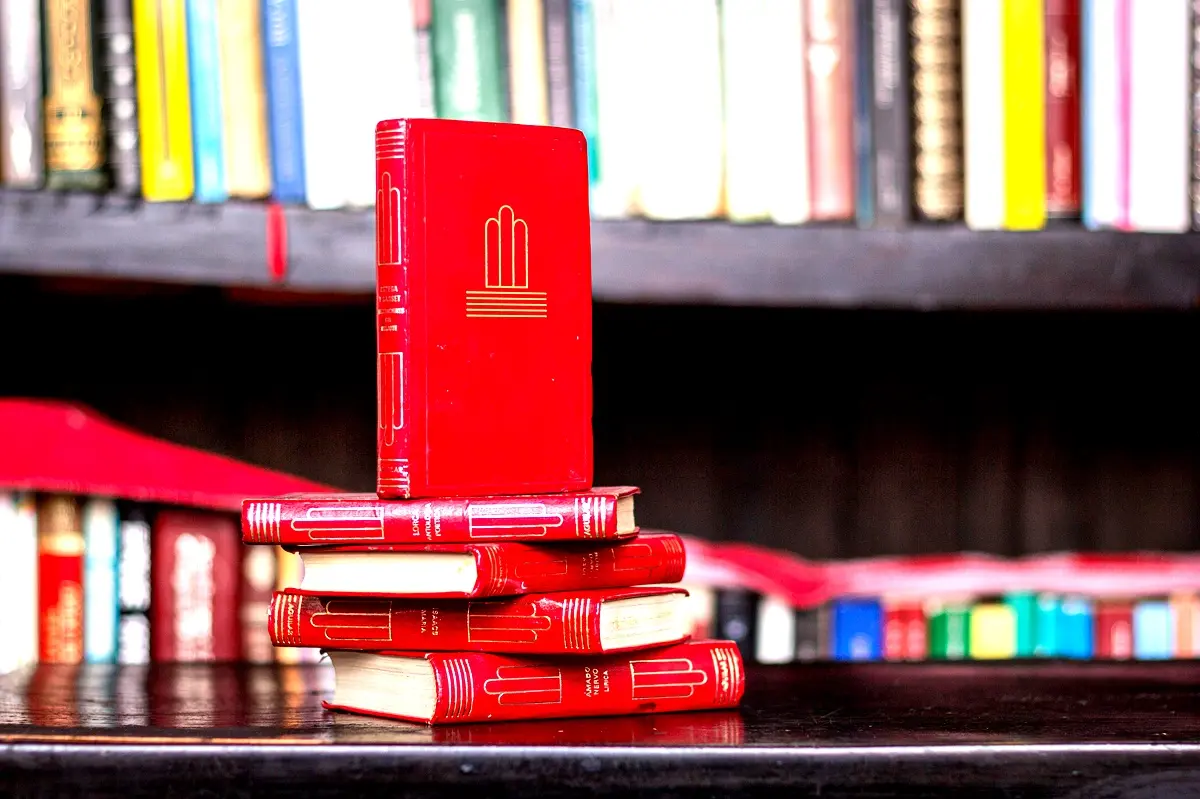
On remarque ici la relation établie entre la culture et l’identité qui sont généralement mises en parallèle, il y a un lien entre les deux. D’après cette citation, la culture peut indiquer l’identité de la personne, et l’élaboration et l’écrasement de l’une explique la construction ou l’élimination de l’autre. Toute culture est dynamique dès qu’il y a un changement au niveau de la culture il y a une modification et une transformation au niveau de l’identité de l’individu.
Le problème de double culture est né avec l’indépendance des pays maghrébins. Beaucoup d’écrivains francophones se sont interrogés sur leurs origines, leurs racines, leurs cultures, leurs appartenances, et leurs identités. C’est le cas de notre romancière.
Leïla Sebbar, un fruit de mariage mixte, n’arrive pas à s’identifier. Dans la majorité de ses écrits, elle parle de son pays d’origine. Pourquoi alors ce besoin d’origine ? Pourquoi le fait d’être à la croisée de deux cultures, de deux mémoires, de deux langues a-t-il produit en elle un métissage incohérent : double fidélité, ou bien double trahison? Entre deux cultures ou bien en dehors de deux cultures ?
Leïla Sebbar dans son œuvre je ne parle pas la langue de mon père se trouve au croisement de deux cultures, elle a subi un déracinement et un déchirement entre la culture arabo-musulmane et la culture occidentale. Elle a toujours posé la question : Qui suis-je ? etÀ quelle culture elle appartient ?
Comme tous les écrivains beurs, Leïla Sebbar raconte l’histoire de son pays, elle traite le thème de l’exil, la quête identitaire, le milieu familial, le colonialisme français qui la met en situation de double culture. L’héroïne de notre corpus a vécu un trouble identitaire et un déséquilibre dans sa vie provoqué par la différence des langues et des cultures, elle était élevée dans une maison où la culture et les traditions orientales ont été marginalisées, elle se voit dominée malgré elle par la culture française,
la culture de sa mère et de l’ennemi. Cette culture d’origine dont elle a été séparée, elle tente de la rétablir à travers la représentation du père dans son autofiction : « Le corps déplacé de mon père, sa terre, je l’écris dans la langue de ma mère et j’entends les voix, les rires et les cris les mots qui se croisent.
Violence, tendresse, amour…
50 BARBERO Martin. Imoginarios de Nacion, Jean et all, L’approche culturelle de la globalisation, Les presses de l’université Laval, 2001, P.11.
je n’oublie pas l’image, tout ce qui fait signe, les traces mémorielles qui jouent sur des correspondances insolites, imprévues, troublées »51
De ce fait, le retour aux origines, aux traditions du pays natal, ne peut se faire que par le truchement des livres qui permettent à l’auteure d’élaborer sa mémoire algérienne. Dans les textes de Leïla où il est question de filiation brisée que l’écrivaine peut ranimer par et dans les lettres, les mots, et grâce à son corpus.
Elle peut vivre sa part algérienne seulement dans la fiction et le retour aux origines, aux traditions et à la culture orientale ne peut avoir lieu que dans la langue française, la seule qu’elle possède : « c’est ainsi que je peux vivre, dans la fiction, fille de mon père et de ma mère.
Je trace mes routes algériennes dans la France. »52
C’est ainsi que dans son roman autobiographique où elle ne cesse plus de penser et d’oublier la culture occidentale : les marabouts ancestraux, les fêtes et les deuils, les moutons égorgés et les garçons circoncis, l’école coranique, la cour carrée au figuier, etc. Ces derniers restent des signes d’obscurité et qui ravivent la blessure ancestrale qui provoque discrètement l’être. Le génie inventé c’est de la création littéraire, la voix écrite se fait sans doute d’un passé indéchiffrable pour exprimer sa souffrance, ses douleurs psychiques et son malaise. Alors notre romancière est insociable, déséquilibrée et déprimée ce qui va procurer en elle un choc culturel.
Dans un entretien avec Leila Sebbar nous avons relevé un passage dans lequel elle exprime sa relation avec la culture arabe. Elle répond ainsi : « Mon lien à cette culture se fait par le biais des traductions. J’ai lu plus de littérature arabe traduite que beaucoup d’arabes qui connaissent très mal leur littérature. Donc mon lien avec l’arabe en tant que culture transite par le français, et mon lien à l’arabe fondamental se fait de façon directe et très émotionnelle. »53
D’après cet entretien, nous remarquons que notre romancière n’a pas oublié sa petite part algérienne qui est vivante en elle. Malgré cet obstacle linguistique, l’écrivaine poursuit sa culture paternelle avec la traduction de la littérature arabe parce qu’elle ne parle qu’une seule langue, la langue française. En effet la perte de la parole d’origine de côté paternel va de pair avec la perte d’une partie de soi-même.
51SEBBAR, Leïla, L’arabe comme un chant secret, Paris, Bleu autour, 2007, p.164
52 Ibid. p.154
53 Georgia Makhlouf-Cheval, Entretien avec Leïla Sebbar publié dans l’Orient littéraire (L’Orient-Le jour, Beyrouth, Mars, 2008)
Dans je ne parle pas la langue de mon père l’identité de Leïla Sebbar est déterminée par différents signes également le problème de double appartenance culturelle. En principe les enfants qui sont nés d’un mariage mixte, ils ont plus d’avantage que les autres, ils ont deux langues, deux modes de vie différents ce qui va créer une identité riche, mais ce n’est plus le cas de notre romancière, qui en souffre beaucoup plus qu’elle en réjouit, du moins dans sa vie d’enfance en Algérie.
________________________
48 LE BOUCHER, Dominique, Traversière, dialogue avec Leila Sebbar, Paris, édition Marsa, 2015, p. 27 ↑
49 SEBBAR, Leïla, Je ne parle pas la langue de mon père, Paris, Julliard, p. 93 ↑
50 BARBERO Martin. Imoginarios de Nacion, Jean et all, L’approche culturelle de la globalisation, Les presses de l’université Laval, 2001, P.11. ↑
51SEBBAR, Leïla, L’arabe comme un chant secret, Paris, Bleu autour, 2007, p.164 ↑
53 Georgia Makhlouf-Cheval, Entretien avec Leïla Sebbar publié dans l’Orient littéraire (L’Orient-Le jour, Beyrouth, Mars, 2008) ↑
Questions Fréquemment Posées
Quelles sont les thématiques principales abordées dans ‘Je ne parle pas la langue de mon père’ de Leïla Sebbar ?
Leïla Sebbar aborde des thématiques telles que l’exil, la quête identitaire, le déracinement culturel, et le tiraillement entre la culture arabo-musulmane et la culture occidentale.
Comment Leïla Sebbar exprime-t-elle son déracinement identitaire dans son œuvre ?
Leïla Sebbar exprime son déracinement identitaire à travers la représentation de son père et la mémoire algérienne, en utilisant la langue de sa mère pour évoquer ses racines et ses souvenirs.
Pourquoi Leïla Sebbar ressent-elle un besoin de retour aux origines dans ses écrits ?
Leïla Sebbar ressent un besoin de retour aux origines pour rétablir sa mémoire algérienne, car elle a été séparée de sa culture d’origine et tente de la retrouver à travers ses livres.