La monétisation des dépenses publiques révèle des effets inattendus sur la croissance économique des États de la CEMAC. Cette étude met en lumière des résultats contrastés, soulignant l’importance d’une gestion fiscale adaptée pour garantir la stabilité politique et économique dans la région.
La monétisation et l’innovation économique révèlent des dynamiques inattendues dans les performances macroéconomiques des États de la CEMAC. Cette étude met en lumière des résultats contrastés, avec des implications cruciales pour la gestion des politiques fiscales et la stabilité politique régionale.
Section 2 :
Interprétation des résultats et recommandations des politiques
Cette section se focalise sur l’interprétation des résultats analysés plus haut et la vérification des hypothèses (A) mais aussi à la formulation des recommandations de politiques économiques (B).
Interprétation des résultats et vérification des hypothèses
Nos résultats étant déjà analysés, il est nécessaire pour nous de les interpréter sur le plan macroéconomique pour pouvoir par la suite, mieux formuler nos recommandations. Dans le cadre de cette sous-section, nous interprétons nos résultats (1) et nous vérifions nos hypothèses formulées depuis l’introduction (2).
Interprétation des résultats
Pour réduire le chômage et atteindre les objectifs d’émergence fixés, les pays de la sous-région CEMAC doivent faire évoluer positivement leurs PIB par tête. Pour y parvenir, ces six États ont des décisions conjoncturelles et structurelles à prendre.
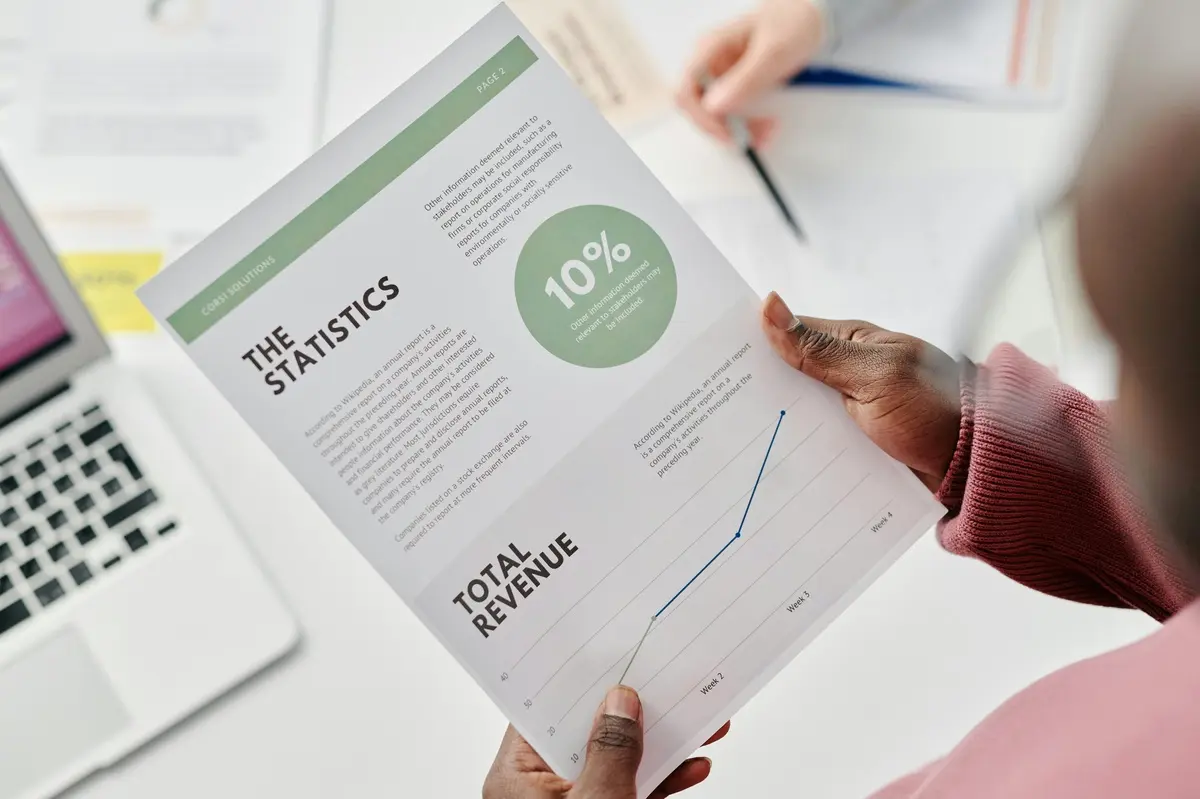
Sur le plan de la conjoncture économique, le Cameroun, comme on l’attendait bien, peut financer son économie par la création monétaire. La Guinée et le Gabon, quant à eux, devraient le faire grâce à la fiscalité. Car, ces variables impactent directement et positivement la croissance économique dans ces pays. Le Congo a aussi intérêt à adopter la création monétaire, puisque, celle-ci impacte de manière indirecte (à travers les dépenses publiques) la croissance du PIB par habitant.
Sur le plan structurel, toute la sous-région a intérêt à intégrer la création monétaire parce qu’elle impacte directement et indirectement à l’amélioration de la croissance économique. L’économie gabonaise et celle du Cameroun devraient mettre un accent sur dépenses publiques qui perfectionnent leurs croissances respectives.
À long terme, comme à court terme, les effets de la monétisation sur la croissance économique des États de la CEMAC restent mitigés. Ces mêmes résultats variés s’observent aussi pour toutes les variables de contrôle. Cependant la République Centrafricaine reste le seul pays de notre échantillon dont aucun effet n’a affiché de résultats significatifs. Par ailleurs, l’étude affiche une limite pour le cas de la Guinée, la non prise en compte des dépenses publiques pour faute de données. Aussi, nous enregistrons une mauvaise spécification du modèle pour le cas du Cameroun.
Vérification des hypothèses
D’après le tableau ci-dessous, il ressort que l’hypothèse principal 𝐇𝐩 ( la création monétaire booste la croissance des pays les moins riche) est confirmée à court terme pour le Cameroun et à long terme pour le Gabon et la Guinée, dans le reste des cas elle est infirmée. Notre première hypothèses subsidiaire 𝐇𝟏 ( la création de monnaie ne cause pas l’inflation) est vérifiée uniquement pour le cas de la Guinée. Pour ce qui est de la deuxième hypothèses subsidiaire 𝐇𝟐 ( la monétisation est négativement corrélée au chômage), seul le cas du Cameroun le confirme.
Tableau 07 : Vérification des hypothèses de recherche
| Vérification des hypothèses de recherche | |
|---|---|
| Hypothèse | Résultat |
| 𝐇𝟏 | confirmé |
| 𝐇𝟐 | confirmé |
| R.E. | Résultat Escompté |
| R.O. | Résultat Obtenu |
| Cameroun | confirmé |
| Congo | confirmé |
| Gabon | confirmé |
| Guinée | confirmé |
| RCA | confirmé |
| Tchad | confirmé |
| TMM | TMM |
| 𝐇𝐩 | confirmé |
| chômage | confirmé |
| inflation | Causalité positive |
| Masse monétaire | Pas d’effet significatif |
| 𝐇𝟏 : Hypothèse 1 | Corrélation positive |
| 𝐇𝟐 : Hypothèse 2 | Corrélation négative |
| 𝐇𝐏 : Hypothèse principale | Impact positif |
| TMM | Théorie Monétaire Moderne |
Source : Auteur (Fondé sur les résultats)
Recommandations
Ces résultats contre intuitifs pour certains pays de notre échantillon sont imputables aux politiques économiques absentes ou moins efficaces, aux instabilités politiques, etc. Par ailleurs, au regard des résultats trouvés dans cette étude, les recommandes suivantes s’adressent aux autorités politiques des pays de la CEMAC pour atteindre les objectifs d’émergence fixés.
Accentuation du processus de monétisation de la dette publique
Adopter la création monétaire pour la sous-région facilitera le financement de l’économie, ce qui contribuera ainsi à rendre plus compétitif cette dernière. En effet, lorsque la Banque Centrale diminue le taux d’intérêt directeur, les taux d’intérêts débiteurs des Banques Commerciales diminuent eux aussi. Par conséquent, il y a plus de crédits accordés ce qui provoque une hausse de la création monétaire et donc de la masse monétaire.
Ainsi, la croissance économique est relancée. De plus, elle permet de relancer le pouvoir d’achat, c’est- à-dire l’augmenter, car les agents économiques mettent plus de monnaie dans le système économique, de ce fait beaucoup d’agents économiques pourront bénéficier de ce surplus de monnaie et donc augmenter leur pouvoir d’achat. Par ailleurs, créer de la monnaie fait diminuer les taux d’intérêts réels, donc favorise l’emprunt, l’achat de biens et par conséquent favorise aussi la croissance.
La promotion des dépenses publiques
Les dépenses publiques étant l’un de courroie de transmission des effets de la monétisation sur la croissance, occupent une place importante dans notre analyse. Les autorités politiques se doivent de mettre en place des politiques économiques réalistes (les politiques de l’offre), qui s’inscrivent dans le temps, de nature à encourager la classe moyenne d’affaires locales et la production des biens capitaux.
L’économie des 150 dernières années prouve que : la croissance économique va de pair avec une proportion de plus en plus forte des dépenses publiques depuis le milieu du XIXe siècle. D’un point de vue statistique, il existe un lien significatif entre l’augmentation des dépenses publiques et la croissance économique, dans les pays en développement.
Ce lien durable s’appelle « la loi de Wagner », du nom de l’économiste qui l’a identifié pour la première fois dans les années 1880. L’augmentation de dépenses publics constitue donc une partie essentielle de la croissance et du développement économiques, dans tous les pays. Les dépenses publiques jouent un rôle incontournable au niveau de l’investissement dans les infrastructures.
Toute l’économie bénéficie du fait d’avoir de bons systèmes de routes, de chemins de fer, d’eau et d’électricité, mais il n’est pas rentable pour le secteur privé de les construire. Comme on peut le remarquer, la majeure partie des gains de productivité de l’âge d’or de l’économie américaine est issue des investissements publics dans les infrastructures telles que les routes et l’électricité.
Les dépenses publiques permettent d’offrir de nombreux services de manière plus performante. Car ces dernières agissent davantage sur la croissance du PIB que les dépenses privées, ce qui est logique par rapport à la preuve formelle que les dépenses publiques de santé sont beaucoup plus performantes, en termes économiques,
et plus efficaces, en termes d’objectifs de santé, que les dépenses du secteur privé pour la santé. Très simplement, la santé publique est plus efficace pour l’ensemble de l’économie. La redistribution des revenus permet d’accroître la demande des consommateurs. En effet, étant donné que les populations plus pauvres dépensent une proportion beaucoup plus importante de leurs revenus, la redistribution des riches vers les pauvres, par le biais d’un système de prestations, stimule la croissance économique. Les politiques de redistribution soutenues par l’État peuvent ainsi accélérer le rythme de l’activité économique, dans la mesure où elles donnent un revenu supplémentaire aux familles ayant une propension marginale à consommer relativement forte.
Politique de lutte contre le chômage involontaire
La sous-région devrait se lancer à l’objectif taux de chômage involontaire zéro en privatisant les entreprises publiques. Le comble du déficit d’infrastructure au niveau régional est crucial pour promouvoir le développement et la lutte contre la pauvreté. La CEMAC accuse un net retard dans le domaine des transports, des télécommunications et de l’énergie.
En matière d’infrastructures physiques, il existe entre investissements publics et investissements privés une forte complémentarité, qui peut être une source importante de croissance et influencer fortement la composition et la répartition des fruits de la croissance. Les investissements publics peuvent jouer un rôle clef dans l’accroissement de la productivité et la génération d’un excédent net, essentiel à l’accumulation dans tous les secteurs de l’économie.
Ainsi il est nécessaire de concrétiser les actions prévues dans le Programme Économique Régional de la CEMAC. En effet, ce programme vise dans son volet d’infrastructure, à faciliter la circulation des personnes, le trafic des marchandises, en améliorant la qualité et la quantité des infrastructures routières ainsi que leur interconnexion transfrontalière d’une part et d’autre part réduire les délais de transport, les coûts du fret, de l’énergie et des télécommunications.
Le programme prévoit :
- L’aménagement et l’entretien du réseau routier ainsi que l’amélioration du système d’informations routières ;
- La construction de postes de contrôle juxtaposés aux frontières.
Politique de tolérance d’une inflation légèrement élevée
L’inflation est souvent associée à l’augmentation des prix de première nécessité, à la baisse du pouvoir d’achat des ménages les plus pauvres et aux tension sociales qui s’ensuivent. Ce phénomène économique a des bienfaits méconnus, qui peuvent s’avérer très intéressants sur le moyen terme, comme le soutiennent plusieurs économistes. L’inflation réduit le poids de la dette publique une politique monétaire qui favoriserait une montée de l’inflation pourrait
enrayer la récession, favoriser la croissance, la création d’emplois et la maîtrise, voire la diminution de la dette publique. Plus l’inflation augmente, plus le poids de la dette publique ou privée baisse. L’inflation est en cela une solution pour réduire la dette publique sans augmenter les impôts ni diminuer les dépenses publiques.
Même si la Banque Centrale n’ira pas dans le sens d’une politique monétaire inflationniste, au vu de la politique budgétaire présentée par les gouvernements, qui consiste en une relance par la demande, avec la création de centaines de milliers d’emplois à travers des chantiers publics, il est certain que l’inflation va monter davantage.
Et ce sera une bonne chose, si toutefois on arrive à endiguer les effets négatifs sur le pouvoir d’achat. Ce raisonnement sur la dette s’applique également aux entreprises. En diminuant le coût réel de l’endettement en fonction de la différence entre le niveau des taux d’intérêt nominaux et le niveau général des prix, l’inflation améliore la rentabilité financière des entreprises.
En période d’inflation, les entreprises sont d’autant plus incitées à recourir au financement externe que leurs taux de profit internes sont supérieurs au taux d’intérêt des capitaux empruntés. Une telle situation élève la rentabilité de leurs fonds propres, effet de levier oblige. Les entreprises se trouvent stimulées par les perspectives de gains et incitées à investir.
L’inflation devient un moteur de l’investissement et peut induire une croissance la production et l’emploi. Agissant sur l’investissement, la rentabilité des entreprises, la diminution de la charge de la dette publique, mais aussi sur les dépenses des ménages, l’inflation apparaît ainsi comme un mécanisme de relance de l’économie par excellence. Mais elle agit aussi sur un autre registre : la prise de risque, autre levier de l’investissement et de la croissance.
Si elle réduit le poids de la dette, l’inflation agit par le même mécanisme sur l’épargne et érode sa valeur. Si l’on suit le raisonnement économique, cela pousse les ménages qui vivent des produits d’une épargne dormante à chercher des alternatives de placement plus rentables, et donc plus risquées ce qui favorise l’investissement.
Questions Fréquemment Posées
Comment la monétisation de la dépense publique affecte-t-elle la croissance économique en CEMAC ?
Les effets de la monétisation sur la croissance économique des États de la CEMAC restent mitigés, avec des impacts positifs à court terme pour le Cameroun et négatifs pour le Congo et le Gabon.
Quelles recommandations sont faites pour améliorer la gestion de la politique fiscale en CEMAC ?
Les recommandations incluent l’accentuation du processus de monétisation de la dette publique et l’adoption de la création monétaire pour faciliter le financement de l’économie.
Quelles hypothèses ont été vérifiées concernant la création monétaire et l’inflation ?
L’hypothèse principale selon laquelle la création monétaire booste la croissance des pays les moins riches est confirmée à court terme pour le Cameroun et à long terme pour le Gabon et la Guinée, tandis que l’hypothèse subsidiaire sur l’absence de causalité entre création monétaire et inflation est vérifiée uniquement pour la Guinée.
Questions Fréquemment Posées
Quel est l’impact de la monétisation des dépenses publiques sur la croissance économique des États de la CEMAC?
Les résultats montrent des effets variés de la monétisation sur la croissance économique, avec des impacts positifs à court terme pour le Cameroun et négatifs pour le Congo et le Gabon.
Comment la création monétaire influence-t-elle le chômage dans les pays de la CEMAC?
La deuxième hypothèse subsidiaire 𝐇𝟐 (la monétisation est négativement corrélée au chômage) est confirmée uniquement pour le cas du Cameroun.
Quelles recommandations sont proposées pour améliorer la gestion des politiques fiscales dans la CEMAC?
Des recommandations sont proposées pour améliorer la gestion de la politique fiscale et renforcer la stabilité politique, notamment en intégrant la création monétaire pour impacter positivement la croissance économique.