La méthodologie de recherche en psychologie révèle des défis inattendus auxquels font face les ex-détenus jeunes adultes de la prison centrale de Maroua. En explorant l’impact de la programmation neurolinguistique, cette étude offre des solutions prometteuses pour leur réinsertion sociale et leur développement personnel.
CHAPITRE 3 MÉTHODOLOGIE
Tout chercheur ne peut accéder aux résultats fiables de ses recherches sans au préalable déterminer les procédés utilisés pour parvenir à ces résultats. Les principales articulations de cette partie méthodologique sont : le rappel de l’objet de l’étude, la méthode et le type de recherche, la formulation et opérationnalisation du corps d’hypothèse de recherche, le site de l’étude, la population et l’échantillon de l’étude, les instruments statistiques de collecte et d’analyse des données.
Rappel de l’objet de l’étude
Le sujet qui fait l’objet de notre étude est intitulé « programmation neurolinguistique et développement personnel des ex-détenus jeunes adultes de la Prison Centrale de Maroua ». La formulation de ce sujet s’est faite conformément au canevas de la méthodologie de recherche en psychologie. Car, avant de choisir un sujet, on doit toujours se poser la question de savoir : quelles sont les problématiques déjà existantes en sciences sociales que ce sujet aborde ; les champs d’études auxquels il se rattache, les grands concepts, courants
de pensée et auteurs qu’il soulève. À ce sujet, Bourdieu (1992, p.207) estime que « construire un objet scientifique, c’est, d’abord et avant tout, rompre avec le sens commun, c’est-à-dire avec des représentations partagées par tous, qu’il s’agisse des simples lieux communs de l’existence ordinaire ou des représentations officielles, souvent inscrites dans des institutions, donc à la fois dans l’objectivité des représentations sociales et dans les cerveaux.
Le pré-construit est partout ».
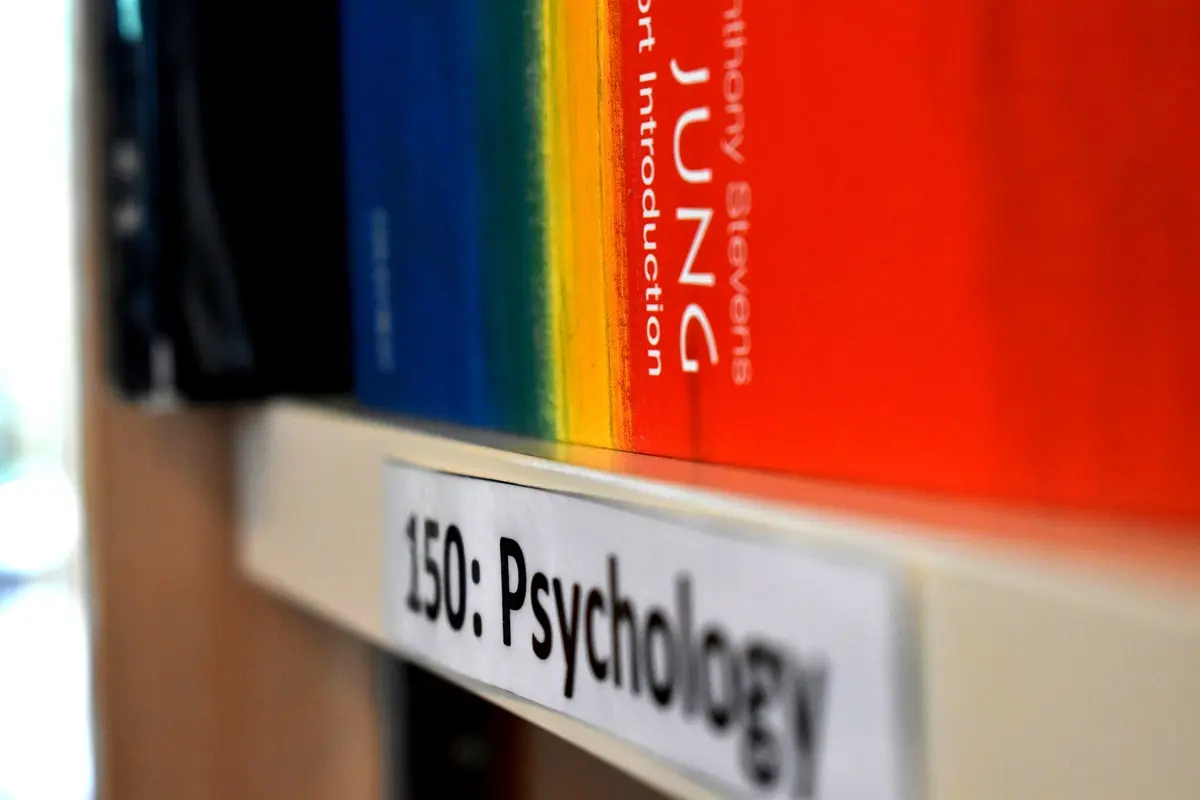
Comme nous l’avons souligné ci haut, le choix de ce sujet est motivé par un ensemble de recherche que nous avons menée sur les jeunes délinquants. En 2018, la première étude réalisée dans le cadre de la monographie en licence-psychologie portait sur 60 adolescents du quartier Ziling-Maroua, nous avons remarqué que 45 d’entre eux ont fait au moins une fois la prison ou étaient en prison. La prison en tant qu’institution de rééducation du délinquant est sensée transformer positivement le comportement de l’adolescent, cependant, le constat était que à sa sortie de prison le comportement de l’adolescent était pire qu’à sa première incarcération.
De façon plus détaillée, lors de la première incarcération les délinquants mineurs sont le souvent impliqués dans des infractions telles que la bagarre, le vol simple, la toxicomanie, le défaut de CNI… Or, à la seconde incarcération ces derniers sont impliqués dans les délits et crimes tels que le braquage, le vol à main armé, le viol, l’avortement, violation de tombeau, émission de fausse monnaie… Les conclusions de cette première étude nous ont stimulé a effectué une seconde recherche qui visait à comprendre si les mécanismes de rééducation en milieu carcéral favorisent-ils la récidive des ex-détenus adolescents de la Prison Centrale de Maroua ?
La deuxième recherche a été réalisée dans le cadre du mémoire de fin de formation à l’Ecole Normale Supérieure de Maroua en 2020 (Djakba et Makadji, 2020). Cette recherche nous a permis de comprendre que 80% des ex détenus adolescents récidive un an après leur libération. Les raisons explicatives de ce problème sont liées aux programmes d’actions éducatives en milieu carcéral ; au profil des rééducateurs en milieu carcéral et aux interactions entre détenus adolescents en milieu carcéral.
Selon la Délégation régionale de l’administration pénitentiaire de l’Extrême Nord (2020) les prisons de l’Extrême-Nord comptaient 162 détenus adolescents. Avec l’évolution de la crise sanitaire du COVID-19, son excellence le Président Biya a instruit le 15 Avril 2020 la commutation des peines des détenus. Malgré cette libération qui a première vue est salutaire, les statistiques fournies par la Prison Centrale de Maroua font état de 93% de réincarcération en 6 Mois.
Le constat présenté ainsi qu’il suit dans nos études précédentes nous a permis de mieux cerner l’actualité autour du développement personnel des ex-détenus. Cet état de lieu nous a motivé à chercher à savoir s’il existe un facteur susceptible d’améliorer le niveau d’estime de soi, de confiance en soi et de maîtrise de soi chez cette catégorie d’individu en vue de limite leur récidive. Les lectures exploratoires nous permis de découvrir les travaux de Bandler et Grinder (1970) sur la programmation neurolinguistique (PNL).
Selon Bandler et Grinder (1970) la PNL est un entrainement mental qui vise la transformation des schémas de pensées négatifs en pensées positives. Ce changement comportemental se fait grâce à des techniques telles que le recadrage cognitif, l’ancrage
des ressources mentales, la synchronisation psychologique. C’est fort de cela que, nous nous sommes proposé d’étudier dans le cadre de ce mémoire le sujet « programmation neurolinguistique et développement personnel des ex-détenus jeune adulte de la Prison Centrale de Maroua ».
Méthode et type de recherche
Cette partie est dédiée à la présentation de la méthode et du type de recherche utilisés dans cette étude.
Méthode de recherche
Pour cette étude, nous utiliserons la recherche quantitative. En effet, elle est une méthode de recherche qui utilise des outils d’analyse mathématiques et statistiques, en vue de décrire, d’expliquer et de prédire les phénomènes sous formes de variables observables et mesurables. Le choix de la méthode de recherche est crucial pour les conclusions possibles à propos d’un phénomène. Ce choix affecte ce qu’il est possible de dire à propos de la cause et des facteurs influençant le phénomène. Il est également important de choisir une méthode de recherche en adéquation avec les dispositions du chercheur. Le temps, l’argent, la faisabilité, l’éthique et l’aptitude à une mesure correcte du phénomène sont des exemples de conditions contraignantes la recherche.
Type de recherche
Notre étude est de type expérimental. Plus précisément, nous allons opter pour l’approche quasi-expérimentale car nous ne manipulerons que la variable indépendante en vue de mesurer son impact sur la variable dépendante. Ainsi, à travers cette démarche expérimentale, nous pourrons mesurer l’impact de la programmation neurolinguistique sur le développement personnel des ex-détenus jeunes adultes de la Prison Centrale de Maroua.
En effet, pour Claude Bernard (1990) la procédure méthodique scientifique comportant une ou plusieurs expériences de test et de mesures puis d’analyse et de validation d’un modèle, en conditions de laboratoire puis sur le terrain dans des conditions d’usage réel moins maîtrisées. Les méthodes expérimentales scientifiques consistent à tester la validité d’une hypothèse, en reproduisant un phénomène (souvent
en laboratoire) et en faisant varier un paramètre. Le paramètre que l’on fait varier est impliqué dans l’hypothèse. Le résultat de l’expérience valide ou non l’hypothèse. La démarche expérimentale est appliquée dans les recherches en biologie, physique, chimie, psychologie, ou encore l’archéologie. La méthode expérimentale est ainsi définie par le chimiste Chevreul (1856 :14)
Un phénomène frappe vos sens ; vous l’observez avec l’intention d’en découvrir la cause, et pour cela, vous en supposez une dont vous cherchez la vérification en instituant une expérience. Le raisonnement suggéré par l’observation des phénomènes institue donc des expériences, et ce raisonnement constitue la méthode que j’appelle expérimentale, parce qu’en définitive l’expérience est le contrôle, le critérium de l’exactitude du raisonnement dans la recherche des causes ou de la vérité.
Cette méthode a été centrale dans la révolution scientifique accomplie depuis le 17e siècle, en donnant naissance aux sciences expérimentales. Parmi les précurseurs de la méthode expérimentale, il convient de citer le physicien et chimiste irlandais Robert Boyle, qui est aussi le père de la philosophie naturelle, ainsi que le médecin Claude Bernard (1990).
Claude Bernard (1990) distingue nettement les approches empiriques et expérimentales : « L’empirisme est un donjon étroit et abject d’où l’esprit emprisonné ne peut s’échapper que sur les ailes d’une hypothèse ». Il insiste en effet sur l’importance de l’hypothèse, et Canguilhem qualifie l’Introduction à l’étude de la médecine expérimentale de « long plaidoyer pour le recours à l’idée dans la recherche, étant entendu qu’une idée scientifique est une idée directrice et non une idée fixe ». Les étapes de la méthode expérimentale ont été résumées par le sigle OHERIC, schéma très simplificateur, et des modèles plus proches d’une méthode expérimentale authentique ont été proposés.
Le schéma de la vérification d’une hypothèse à l’aide de l’expérience est demeuré en vigueur dans les sciences expérimentales de Francis Bacon jusqu’au 20e siècle, date à laquelle certains l’ont remis en cause (Duhem 1906). En effet, selon l’article de Quine Les deux dogmes de l’empirisme, il n’existe aucune « expérience cruciale » qui puisse permettre de confirmer, ou non, un énoncé scientifique. Quine soutient en effet une position holiste, qui ne dénie pas tout rôle à l’expérience, mais considère que celle-ci ne se rapporte pas à un énoncé scientifique, ou hypothèse, en particulier, mais à l’ensemble
de la théorie scientifique. Aussi, à chaque fois qu’une expérience semble apporter un démenti à l’une de nos hypothèses, nous avons en fait toujours le choix entre abandonner cette hypothèse, ou la conserver, et modifier, à la place, un autre de nos énoncés scientifiques.
L’expérience ne permet pas, ainsi, d’infirmer ou de confirmer une hypothèse déterminée, mais impose un réajustement de la théorie, dans son ensemble. Selon Duhem (1906 :13) nous avons toujours le choix de procéder au réajustement que nous préférons :
On peut toujours préserver la vérité de n’importe quel énoncé, quelles que soient les circonstances. Il suffit d’effectuer des réajustements énergiques dans d’autres régions du système. On peut même en cas d’expérience récalcitrante préserver la vérité d’un énoncé situé près de la périphérie, en alléguant une hallucination, ou en modifiant certains des énoncés qu’on appelle lois logiques. Réciproquement, aucun énoncé n’est à tout jamais à l’abri de la révision. On a été jusqu’à proposer de réviser la loi logique du tiers exclu, pour simplifier la mécanique quantique.
La méthode expérimentale repose sur cinq principes qui sont :
Contrôle des paramètres et test d’hypothèses : il s’agit de modifier un ensemble de paramètres à l’aide d’un dispositif expérimental conçu pour permettre le contrôle de ces paramètres, dans le but de mesurer leurs effets et si possible de les modéliser. Dans le cas le plus simple on cherche à modifier un seul paramètre à la fois, « toutes choses égales par ailleurs ».
Cependant il n’est pas toujours possible ni souhaitable de modifier un seul paramètre à la fois. Ainsi en chimie lorsqu’on opère sur les constituants d’une seule phase (liquide, solide, gazeuse ou sous forme de plasma) la somme des concentrations des constituants reste égale à un ; modifier la valeur de l’une d’entre elles modifie inévitablement la concentration d’un autre constituant au moins.
Expérience scientifique à l’aide de modèle : lorsque certains phénomènes naturels sont trop complexes, trop vastes, trop dangereux, trop chers ou trop long à reproduire dans une expérience, on a recours à un dispositif simplifié : le modèle. Il peut s’agir : d’un modèle réduit (maquette). On parle de modélisation analogique, à laquelle les géologues étudiant la tectonique ont recours ; d’un modèle numérique (programme de simulation par ordinateur) ; d’un modèle vivant, comme la souris, mais dont la transposabilité à l’espèce humaine n’est que de 43 %.
Protocole expérimental : le protocole d’expérimentation regroupe la description des conditions et du déroulement d’une expérience ou d’un test. La description doit être suffisamment claire afin que l’expérience puisse être reproduite à l’identique et il doit faire l’objet d’une analyse critique pour notamment détecter d’éventuels biais.
Structure théorique d’une expérience : d’un point de vue très général, l’expérience isolée comporte sommairement trois phases : la préparation, l’expérimentation et l’évaluation. Les deux dernières sont l’aboutissement simple de ce qui les a précédés. Une expérience globale composée d’expériences partiellement individualisables comporte les trois mêmes pôles. Cependant, si dans l’expérience isolée les trois phases constituent autant d’étapes réglées chronologiquement, dans l’expérience globale, il s’agit de trois registres qui interagissent en permanence. Ainsi : l’évaluation est plus ou moins associée aux paramètres pris en compte dans la préparation, par exemple, les résultats questionnent la méthode d’échantillonnage ; l’expérimentation peut être répétée, en fonction des deux autres phases.
Expériences en blocs : exemple d’expérience en blocs aléatoires complets relative à la comparaison de six éléments (par exemple six fumures différentes, numérotées de 1 à 6) au sein de quatre blocs. Dans les expériences en champ au sens large (champ, verger, forêt, etc.), qui sont réalisées en recherche agronomique, on appelle « blocs » des ensembles de parcelles voisines qui servent à comparer différents traitements (différentes fumures par exemple). Les blocs sont dits « complets » quand tous les éléments qui interviennent dans l’expérience (toutes les fumures étudiées par exemple) y sont présents. Ils sont au contraire dits « incomplets » quand seulement certains de ces éléments y sont présents.
Instruments fréquemment utilisés en sciences expérimentales sont :
- Microscopie : les méthodes de microscopie sont utilisées principalement en sciences de la matière et de la vie : sciences des matériaux, biologie moléculaire, géologie… mais aussi pour les investigations : police scientifique, épidémiologie et diagnostic médical (culture de cellules), études environnementales (hygiène et sécurité du travail, pollution) …
- Analyse structurale : ces méthodes consistent à déterminer la structure des cristaux et des molécules. Elles sont utilisées en chimie analytique, pour étudier la synthèse des molécules (synthèse organique, industrie pharmaceutique), en sciences des matériaux…
- Analyse chimique : de nombreux domaines ont recours à la chimie analytique.
La méthode expérimentale est employée au sein de disciplines considérées comme des sciences humaines, telles que la sociologie, la psychologie, ou l’archéologie. L’expérience de Milgram est un exemple d’expérience de psychologie réalisée entre 1960 et 1963 par le psychologue américain Stanley Milgram. Cette expérience cherchait à évaluer le degré d’obéissance d’un individu devant une autorité qu’il juge légitime et à analyser le processus de soumission à l’autorité, notamment quand elle induit des actions qui posent des problèmes de conscience au sujet.
________________________
Questions Fréquemment Posées
Quelle est l’importance de la méthodologie de recherche en psychologie pour le développement personnel des ex-détenus ?
La méthodologie de recherche en psychologie est essentielle pour déterminer les procédés utilisés afin d’obtenir des résultats fiables, ce qui est crucial pour comprendre le développement personnel des ex-détenus.
Quels problèmes rencontrent les ex-détenus jeunes adultes à leur sortie de prison ?
Les ex-détenus jeunes adultes luttent avec des problèmes d’estime de soi et de confiance en soi, ce qui complique leur réinsertion sociale.
Comment la programmation neurolinguistique peut-elle aider les ex-détenus ?
L’étude propose que la programmation neurolinguistique pourrait favoriser la réinsertion sociale et le développement personnel des ex-détenus jeunes adultes.