La méthodologie d’analyse littéraire révèle comment l’exil et le déracinement identitaire façonnent l’œuvre de Leïla Sebbar. En explorant la dualité linguistique entre le français et l’arabe, cette étude offre des perspectives inédites sur la quête identitaire, essentielle pour comprendre les enjeux contemporains de la littérature francophone.
Université 8 Mai 1945 Guelma
Faculté des Lettres et des Langues
Département des Lettres et de la Langue Française
Diplôme de Master en littérature française
Mémoire présenté en vue de l’obtention du diplôme
Exil et déracinement identitaire dans « Je ne parle pas la langue de mon père » de Leïla Sebbar
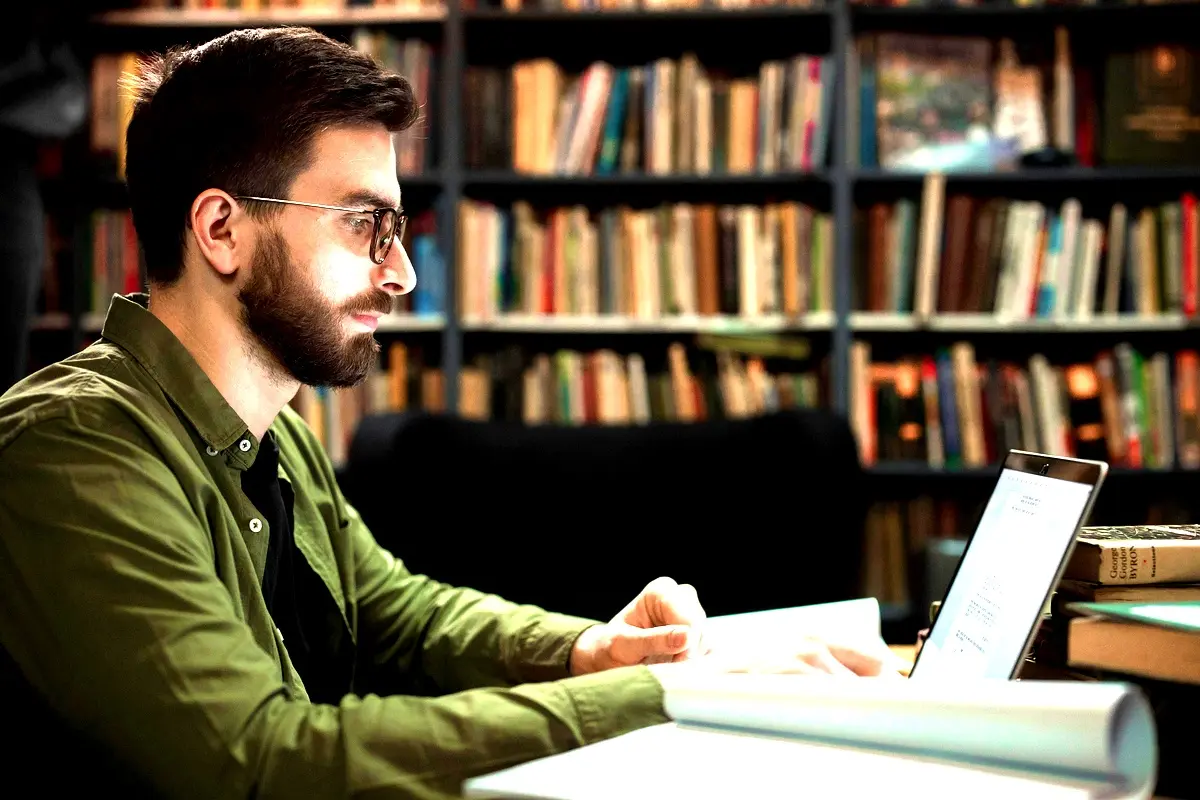
Mlle Touil Imene & Mlle Mouassa Ilham
Sous la direction de: M. Mouassa Abdelhak
Année universitaire 2016/2017
Membres du jury
Président : M. Sedaïria Hichem, Maître-assistant Rapporteur : M. Mouassa Abedelhak, Maître-assistant Examinateur : M. Necib Merouane, Maître-assistant
Résumé :
Le présent travail mené dans le cadre d’un mémoire de Master propose une analyse sociocritique et psychocritique de la situation de l’écrivaine. Leïla Sebbar vit très douloureusement la question de l’exil et de la double appartenance culturelle et linguistique. Elle se trouve tiraillée entre la langue française, la langue de sa mère et choisie par son père, et la langue arabe, occultée par ce dernier.
Chose qu’elle n’a pas pu digérer et aspire à renouer avec la culture et la langue de sa terre natale et de ses aïeux. C’est pourquoi, elle fait une sorte de flux et reflux spatiotemporel entre le présent et le passé, entre la France et les souvenirs algériens, le point à partir duquel allait s’articuler sa réappropriation culturelle et linguistique des origines, allant à la découverte de l’autre partie de son identité perdue en elle, que le père en a privé.
Afin d’appréhender son parcours inscrit dans son ouvrage Je ne parle pas la langue de mon père, nous nous proposons dans ce mémoire d’analyser son discours afin d’en constater le rapport entretenu avec les deux langues qui la fondent : l’arabe et le français.
Mots-clés : langue – identité – interculturel – exil – psychocritique – sociocritique
ملخص :
يقترح هذا العمل المندرج في إطار مذكرة المستر تحليلا اجتماعيا ونفسيا لوضعية الكاتبة ليلى صبار التي تعيش ألم المنفى وازدواجية الانتماء اللغوي والثقافي. حيث نشأت ليلى صبار في ملتقى لغتين، لغة الأم اللغة الفرنسية التي يتحدث بها والدها واللغة العربية التي تفتقدها. الشيء الذي لم تستوعبه ليلى ساعية وراء ذلك إلى إحياء التواصل مع ثقافة والدها المفقودة ولغة وطنها وأجدادها. ولهذا تعود الكاتبة وعبر عملية المد والجزر بين الماضي والحاضر، بين فرنسا وذكريات الجزائر من خلال طرح هذه الإشكالية تشرع ليلى صبار في استعادة ثقافتها ولغتها الأصلية، حيث تسعى إلى اكتشاف الجانب الآخر من هويتها المفقودة، التي حرمها منها والدها.
من أجل فهم وإدراك مسارها المندرج في. روايتها «أنا لا أتحدث لغة أبي»، نقترح في هذه المذكرة تحليل لنص الروائية ليلى صبار من أجل الكشف عن العلاقة المتبادلة مع كلتا اللغتين: العربية والفرنسية اللتان تكوننها
الكلمات المفتاحية: اللغة-الهوية-المنفى-نفسيا-اجتماعيا
Abstract:
This work undertaken within the Framework of a report of Master degree proposes a sociocritic and psychocritic analysis of the situation of the writer. Leïla Sebbar very painfully lives the question of the exile and dual membership both cultural and linguistic. It is pulled about between the French language, the language of her mother and chosen by her father, and the Arab language, occulted by this last.
Thing which she could not digest, and aspires to join again with the culture and the language of her native land, and her ancestors. This is why, she makes a kind of flow and backward flow spatiotemporal between the present and the past, France and Algerian souvenirs, the point from which was going to articulate her appropriation of her cultural and linguistic origins, going on a tour of the other part of her identity lost in her, that the father deprived.
In order to apprehend his course registered in his work I do not speak the language of my father, we propose in this thesis to analyze his speech in order to note the report maintained with the two languages witch found it: Arabic and French
Keywords: language – identity – intercultural- sociocritic – psychocritic – exile.
Introduction
La littérature maghrébine est née dans les pays du Maghreb pendant la période coloniale, elle s’est couronnée par un prix mondial qui la rend plus centrale. Cette expression est composée de deux termes «Maghreb» ainsi de «langue française», deux mondes complètement divers.
Depuis ses exordes, « la littérature beur » qui est envisagée comme une littérature appartenant à la seconde génération des jeunes immigrés qui ont vécu la moitié de leur vie dans un territoire français, où ils ont souffert d’une marginalité et d’une séparation avec la terre natale. Cette littérature, dite beur, est considérée comme un point de rencontre entre deux littératures nationales, qui s’approchent et se métissent culturellement dans un endroit assez difficile celui de l’exil. En effet, elle a comme objectif de réconcilier l’identité perdue de ses écrivains beurs qui n’arrivent pas à s’identifier.
Ce groupe d’écrivains maghrébins d’expression française qui sont installés en France dès leur âge enfantin, à travers des récits de caractère autobiographique, ont essayé de relater leurs histoires de vie dans lesquelles ils dévoilent leur souffrance, leur déséquilibre identitaire mais également la nostalgie aux origines et au pays natal. Parmi ces écrivains qui ont laissé des traces mondiales dans la sphère littéraire, citons à titre d’exemple : Nina Bouraoui, Azzouz Beggag, Farida Belghoul, Leïla Sebbar. Celle qui nous intéresse est bien la romancière Leïla Sebbar, qui a connu un grand succès ces dernières années, à travers son tribut de papiers qui est considéré comme une source de fascination et d’inspiration aux lecteurs.
L’intitulé de notre travail de recherche, « Exil et déracinement identitaire » s’inscrit dans une étude analytique du roman de Leïla Sebbar ayant pour titre : Je ne parle pas la langue de mon père, l’histoire racontée se passe précisément dans les années cinquante, la période difficile de l’Algérie coloniale. Notre choix se justifie par l’importance du thème, nous voulons à travers ce sujet étudier d’une part, ce que nous avons appelé la complexité identitaire, qui est menée par une recherche des origines doublées d’un déplacement dans le temps et dans l’espace, et d’autre part étudier la souffrance de l’exil qui constitue pour Leïla Sebbar le moteur capital de sa production littéraire.
Cette écrivaine installée en France depuis son âge adolescent, née à Aflou d’un père algérien et d’une mère française, tous deux instituteurs à l’école laïque de la république française. De ce fait, sa vie n’était pas équilibrée, elle est conférée entre deux pôles : l’Algérie et la France, et c’est qu’à travers son roman Je ne parle pas la langue de mon père, qu’elle a tenté de remplir les blancs de son histoire notamment sa méconnaissance de la langue paternelle, son écartement de la société indigène ainsi ses mauvais souvenirs qu’elle a passésen Algérie sa terre natale. Alors, notre écrivaine se trouve dans un entre-deux culturel, au croisement de deux univers tout à fait différents.
Au frontières de sa création littéraire, un tiraillement d’appartenance et d’identité se distingue à travers l’œuvre étudiée Je ne parle pas la langue de mon père qui nous retrace en quelque sorte, le déracinement que supporte Leïla Sebbar en tant qu’un individu qui est issu d’un monde extrêmement différent de celui des ancêtres. Elle se voit enfin perdue sans identité équilibrée, sans religion, entre deux langues. Elle a subi des conséquences de deux cultures différentes. Cette idée se résume dans la déclaration de l’écrivaine « je suis une croisée ».
Nous penchons notre recherche à l’étude de l’exil et l’identité à travers le roman Je ne parle pas la langue de mon père de Leïla Sebbar, pour plusieurs raisons : Je ne parle pas la langue de mon père résume l’interaction identitaire, la souffrance de l’exil de la langue arabe, les conditions difficiles du mariage mixte franco-algérien et le problème de double appartenance qu’apprécie la narratrice. L’étude de ce roman nous permet d’aborder le problème de la biculturalité et la mixité vécu par la deuxième génération.
Donc, on a choisi ce corpus et pas un autre parce qu’il répond le mieux à notre besoin de recherche et s’associe bien à notre problématique parce qu’il s’intéresse à la vie et l’enfance de notre écrivaine.
Notre recherche se penchera principalement sur l’interrogation suivante :
Comment se manifeste le phénomène de l’exil et de déchirement identitaire chez Leïla Sebbar dans le roman Je ne parle pas la langue de mon père? Cette interrogation nous mène vers des questions secondaires :
Comment changer cette souffrance d’écartement et d’éloignement de la terre natale et la rendre une source de création? Est-ce que la création d’un récit que le père n’a jamais voulu transmettre était essentielle pour dépasser les déchirements que confrontent Leïla Sebbar? Est-il possible que la langue française, la langue du colonisateur, ait bloqué la communication entre son père et elle? Cela se serait-il produit si elle avait parlé sa langue, l’arabe ?
Notre problématique ébauche les hypothèses suivantes :
Leïla Sebbar à travers Je ne parle pas la langue de mon père, a cherché à s’identifier et à deviner sa place au milieu des différentes identités et des différentes appartenances, entre son être qui tente à s’établir et la société qui nécessite à coexister.
Leïla Sebbar découvre son identité grâce au dédoublement de racines, de langue, de culture et de religion. Cela permettra à l’écrivaine d’oublier une partie pénible de son enfance. L’exil de Leïla Sebbar est lié au silence du père qui est le vecteur principal de sa perte,de son amnésie à la fois culturelle, religieuse et linguistique.
Pour bien mener notre travail, nous avons commencé par donner un aperçu sur la vie de l’auteure et un résumé de l’œuvre étudiée. Notre étude se divise en deux chapitres.
Dans le premier chapitre intitulé : L’écriture de l’exil dans Je ne parle pas la langue de mon père, nous avons centré notre investigation sur l’étude de l’exil en donnant une définition opératoire de la notion et en se basant sur l’exil de la langue du père. Donc, ce chapitre est consacré à l’étude de l’espace comme un indicateur de l’exil, le milieu familial de l’héroïne, la langue en société, en montrant que le silence du père c’est le facteur principal qui met Leïla Sebbaren exil dans son pays natal. Et, on finit ce chapitre par un autre point celui de la culture d’origine et la culture de vie, en citant deux sociétés contradictoires algérienne et française qui s’opposent en traditions et aux habitudes et qui influencent sur la vie et les écrits de notre romancière.
Concernant le deuxième chapitre qui porte comme titre : Quête identitaire. Ce chapitre est consacré à l’étude de la notion d’identité. Tout d’abord, on va parler de la langue comme un facteur identitaire. Ensuite, la culture au milieu du jeu identitaire, puis, la religion comme élément primordial dans la construction d’identité et à la fin nous allons aborder les figures identitaires représentées dans notre corpus qui aident l’héroïne à se retrouver.
Nous voulons découvrir, à travers notre étude, l’impact des traces des souvenirs d’enfance dans la construction identitaire, ainsi notre étude consiste à deviner le rapport entretenu avec les deux langues qui fondent l’écrivaine: l’arabe et le français.
Il est important d’indiquer la méthode que nous avons adoptée dans ce travail: l’approche sociocritique et l’approche psychocritique. Nous allons d’abord, commencer dans le premier chapitre par l’approche sociocritique afin de dégager les conditions existantes dans la société algérienne de Leïla Sebbar dans une période coloniale assez difficile. Ainsi le statut de notre écrivaine lorsqu’elle se sent exilée au sein même de sa propre communauté et dans son pays natal. Dans le deuxième chapitre, nous préconisons une approche psychocritique afin de dégager les obstacles qui ont écrasé l’identité de notre protagoniste tel qu’ils sont indiqués dans cette autobiographie.
Questions Fréquemment Posées
Quelle est la problématique principale abordée dans ‘Je ne parle pas la langue de mon père’ de Leïla Sebbar ?
La problématique principale est l’exil et le déracinement identitaire, ainsi que la double appartenance culturelle et linguistique vécue par l’écrivaine.
Comment Leïla Sebbar exprime-t-elle son tiraillement entre les langues française et arabe ?
Elle se trouve tiraillée entre la langue française, la langue de sa mère et choisie par son père, et la langue arabe, occultée par ce dernier.
Quel type d’analyse est proposé dans le mémoire sur l’œuvre de Sebbar ?
Le mémoire propose une analyse sociocritique et psychocritique de son parcours et de son discours, en lien avec les deux langues qui la fondent : l’arabe et le français.