La méthodologie d’analyse littéraire révèle comment Alice Zeniter transforme l’Histoire en fiction dans « L’Art de Perdre ». En explorant les récits des Algériens durant la Révolution, cette étude offre une perspective inédite sur la mémoire collective, essentielle pour comprendre les enjeux contemporains de la narration historique.
Université 8 Mai 1945 Guelma
Faculté des Lettres et des Langues
Département des Lettres et de la Langue Française
Domaine: Langues et littératures étrangères
Filière: Langue française
Spécialité: Littérature et civilisation
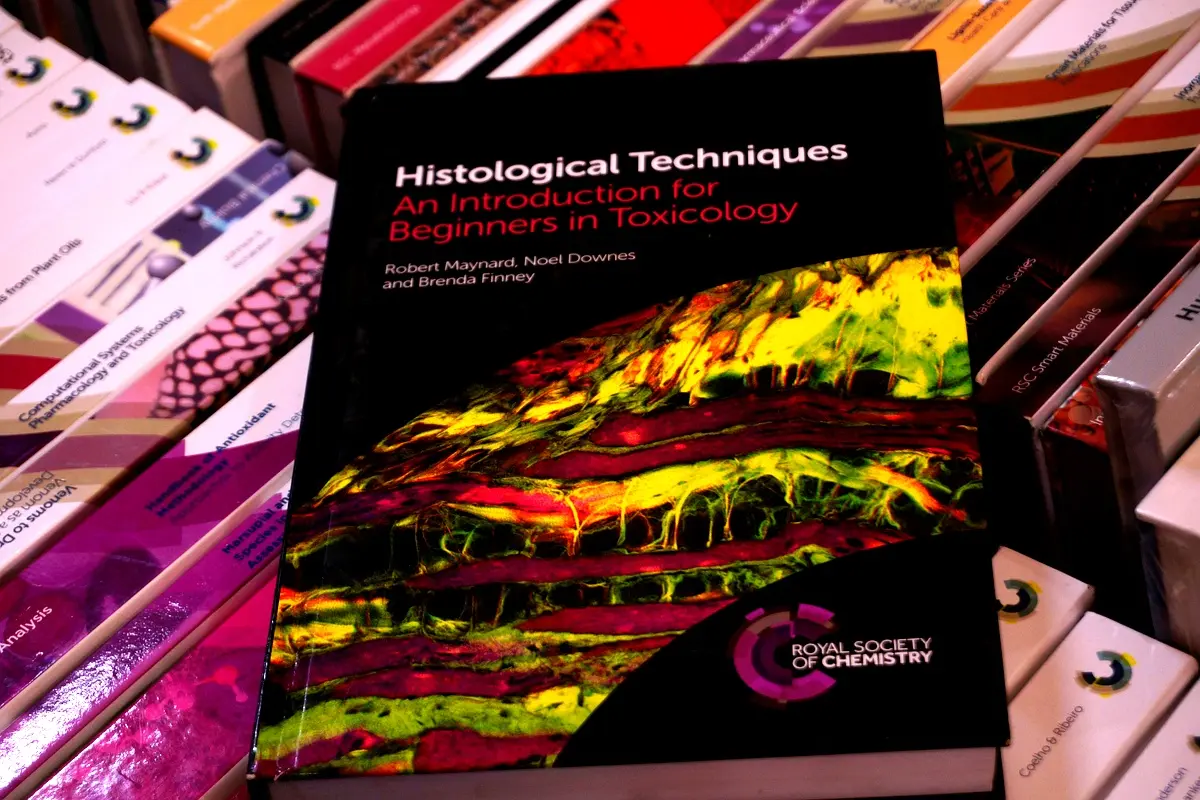
Mémoire en vue de l’obtention du diplôme de master académique
L’inscription de l’Histoire dans « L’Art de Perdre » d’Alice Zeniter
Élaboré par
Khelaifia Bahe-eddine
Dirigé par
M. Alioui Abderaouf
Soutenu le : 30/09/2020 Devant le Jury composé de :
Nom et Prénom Grade
M. OUARTSI Samir | Maitre-assistant | A | U. De Guelma | Président |
M. ALIOUI Abderaouf | Maitre-assistant | A | U. De Guelma | Encadreur |
M. MOUASSA Abdelhak | Maitre-assistant | A | U. De Guelma | Examinateur |
Année universitaire :
2019/2020
Résumé :
L’Art de Perdre d’Alice Zeniter est un roman qui sort de la doxa1 habituelle, celle qui tend à glorifier l’Histoire des civilisations occidentales, pour retracer une autre Histoire, partant du point de vue des vaincus et des marginalisés que sont les algériens ayant collaborés avec la France pendant la Révolution algérienne.
Ce mémoire cherche à mettre en lumière la particularité de l’écriture romanesque de l’Histoire à travers de différents pôles d’analyse, en interrogeant les relations qu’entretiennent le fictionnel et le référentiel, en dehors de la perspective qui considère la fiction comme un espace de fabulation à finalité esthétique.
Ce travail s’attache à l’observation des éléments textuels fictionnalisés, et à l’étude des outils permettant la plausibilisation du monde fictionnel, tout en cherchant à révéler les motivations et les desseins de l’auteure.
Mots clés: Histoire, fiction, référentiel, Alice Zeniter, Révolution algérienne, harkis.
Abstract:
Alice Zeniter’s Art of Losing is a novel that detached from the usual background, which tends to glorify the History of Western civilizations, to retrace another path of History, starting from the point of view of the vanquished and the marginalized Algerians who collaborated with France during the Algerian Revolution.
This dissertation seeks to shed light on the particularity of historical novel writing, using different poles of analysis, by questioning the relationships between the fictional and the referential, outside the perspective that considers fiction as a space of fabulation with aesthetic finality.
This work focuses on the observation of fictionalized textual elements, and the study of tools allowing the plausibility of the fictional world, while seeking to reveal the motivations and the desires of the author.
Keywords: History, fiction, referential, Alice Zeniter, Algerian Revolution, harkis.
1 Doxa: ensemble des opinions communément admises dans une société donnée.
الملخص:
« فن الخسران » لأليس زينيتير هي رواية منفصلة عن الخلفية السائدة، التي تم جد تاريخ الحضارات الغربية، لتتبع تاريخًا آخر، بدءًا من وجهة نظر المهزومين والمهمشين الجزائريون الذين تعاونوا مع فرنسا خلال الثورة الجزائرية.
تسعى هذه الأطروحة إلى تسليط الضوء على خصوصية كتابة الرواية التاريخية من خلال أقطاب مختلفة من التحليل، من خلال التشكيك في العلاقات بين الرواية والمرجعية، خارج المنظور الذي يعتبر الرواية بمثابة مساحة للأغراض الجمالية.
يركز هذا العمل على ملاحظة العناصر النصية الخيالية، ودراسة الأدوات التي تسمح بمعقولية العالم الخيالي، مع السعي للكشف عن دوافع المؤلف وتصميماته.
كلمات مفتاحية: تاريخ، خيال، مرجعي، أليس زنيتر، ثورة جزائرية، حركى.
Introduction générale
La littérature est souvent associée à la « fiction », voire à l’imaginaire ; la condition et le voile esthétique par lesquels la littérature s’érige en art parfait ; or, si la fiction se réfère à son origine étymologique « fingere2 », ou feindre, la littérature deviendrait un espace convenable pour dépeindre poétiquement la réalité ; c’est ainsi que certains romanciers trouvent refuge dans la littérature pour revivre des expériences du réel par un récit fictif proposé, et c’est notamment le cas du roman historique.
Tradition héritée de l’écrivain écossais Walter Scott au XIX ; à cette époque la frontière entre Histoire et littérature était assez poreuse, l’Histoire ne se voulait plus uniquement le contexte extérieur du fait et la toile de fond, mais aussi une particularité référentielle qui côtoie la diégèse du roman et influence la destinée du personnage par lequel l’auteur se réfère à un passé exemplaire qui permet de penser les liens avec le présent : l’Histoire est une maîtresse de vie3.
Dès lors, le genre ne cesse de prospérer tant qu’il y aura des écrivains comme Balzac ou Victor Hugo qui prennent le relais : le roman est le reflet du monde prolétarien et les phénomènes de révolution sociale. Ce fut l’ère de prolificité du roman historique.
Si cette tendance traditionnelle tend à penser conjointement et indissociablement la relation entre Histoire et littérature, les Nouveaux Romanciers et notamment Marguerite Yourcenar optent pour une vision un peu plus distanciée envers l’Histoire ; partant des interrogations du présent, elle reproduit le passé à force de sympathie imaginative4, loin de l’Histoire officielle, contaminée et indissociable de l’Histoire des conflits et grands bouleversements ; l’Histoire évènementielle ne suffit que pour relater les aventures des hommes, mais pas leur vie. C’est dans une pareille perspective qu’Alice Zeniter ressuscite l’Histoire mouvementée de la guerre d’Algérie qui n’a cessé d’attirer les romanciers français, prenons à titre d’exemple : Laurent Mauvignier, Maurice Attia et Jérôme Ferrari.
Alice Zenitter est dramaturge et metteuse en scène, née d’un père algérien et d’une mère française, elle nous dépeint une fresque romanesque dont les implications s’étendent entre l’Algérie et la France. Le récit s’étend sur trois générations, il débute avec l’histoire d’Ali, le patriarche et le notable déchu suite à sa collaboration forcée pendant la Révolution, et se poursuit avec l’histoire de son fils Hamid héritier du silence et chercheur d’émancipation et d’intégration.
2 Fingere c’est-à-dire « façonner » et par extension « feindre ».
3 Offenstadt Nicolas, l’Historiographie, Paris, Puf, 2011, p.10.
4 Marianne Alphant, YOURCENAR (Marguerite) 1903-1987, Encyclopédie Universalis 2016.
dans la société française, et enfin avec sa petite fille Naima, la galeriste qui tente de creuser et déterrer l’Histoire enfouie sous les silences des deux générations précédentes.
Ce roman, bien qu’il soit en grande partie fictionnel, retrace l’Histoire de l’Algérie à travers les histoires d’Ali, Hamid et Naima qui entretiennent des relations étroites avec les circonstances sociohistoriques du pays, Ainsi même si nous avons affaire à des individus, leur prisme nous permet de saisir l’Histoire de l’Algérie. En retraçant cette histoire l’auteure met aussi en exergue une poétique de jonction entre la fiction et le réel.
Sous cet angle, nous nous trouvons face à la problématique suivante : la fiction littéraire peut-elle avoir une valeur historique dans l’Art de perdre d’Alice Zeniter ?
Afin d’apporter des réponses à cette problématique, deux pistes hypothétiques nous semblent envisageables :
- En mêlant fictif et réel, l’auteure comblera les failles et les non-dits de l‘Histoire. En d’autres termes, l’auteure déforme la réalité pour permettre de la voir, la réalité esthétique aide à comprendre la réalité authentique. Dans ce cas, l’auteure effectue un détour par la fiction qui parait en filigrane pour éclairer et orienter le sens de l’Histoire.
- La fiction se veut une forme nouvelle d’écriture de l’Histoire ; autrement dit, le roman n’est qu’un espace interprétatif des évènements déjà vécus ; qui propose de changer la perspective et de regarder l’Histoire autrement : une expérience sensorielle en parallèle avec l’Histoire évènementielle.
C’est avec une grande érudition et une plume fascinante qu’Alice Zeniter nous offre cette œuvre bien documentée, d’une authenticité et d’une audace remarquable, dépourvue de tout cliché habituel, abordant des thématiques peu étudiées, du fait qu’il s’agit d’une écrivaine française qui dénonce et révèle les crimes de la colonisation en Algérie; ainsi nous ne pouvons pas nier notre appréciation de l’Histoire et notamment celle de l’Algérie qui se révèle très passionnante et motive ainsi notre choix du corpus et de thématique.
Pour mener à bien notre recherche, nous aurons recours à l’analyse du récit, afin de pouvoir repérer et mettre en évidence les différences entre les faits rapportés par Alice Zeniter et les sources historiques dans lesquelles elle aurait puisé. Ainsi, les théories et concepts développés par Pierre Barbéris autour de la légitimité de l’œuvre littéraire comme document historique alternatif seront convoqués dans ce présent travail afin de donner du sens aux résultats.
de notre analyse et nous permettre de mener une étude approfondie sur la relation entre Histoire et littérature.
En ce qui concerne la structure de notre mémoire ; nous le développerons en trois parties : Le premier chapitre sera consacré à la présentation de l’auteure et de son œuvre, ainsi qu’à l’étalage d’un aperçu historique qui nous éclaire sur le contexte sociohistorique particulier dans lequel se déroule l’intrigue.
Dans le deuxième chapitre, nous essayerons de répertorier les éléments référentiels dans le récit, avant de procéder à une analyse de ces éléments et de voir les altérations et les modifications survenues aux éléments référentiels par la fiction ; et dans le sens contraire nous tenterons de révéler les processus par lesquels l’auteur donne de la vraisemblance à des éléments qui ne sont que le fruit de son imagination.
Enfin dans le troisième chapitre nous essayerons de déceler les motivations de l’auteure, les raisons pour lesquelles l’auteure déploie autant d’éléments historiques dans un texte de littéraire et finalement la relation entre l’Histoire et la littérature.
Finalement, nous espérons qu’à partir de ce modeste travail, nous arriverons à révéler certaines réalités sur notre pays qui -par manque de recul historique- ne peuvent être transmises que par le biais d’écrits littéraires.
Chapitre 01 :
La tribu d’Ali, une tragédie en trois générations
Alice Zeniter, un parcours particulier vers l’écriture :
Alice Zeniter est née à Clamart en 1986 d’un père algérien immigré d’Algérie en 1962, et d’une mère française, elle a été l’élève de l’école d’Alençon où elle a grandi en Normandie jusqu’à 17 ans avant de partir à Paris et s’y est installée dix ans. Alice Zeniter est une écrivaine, metteuse en scène et traductrice.
Elle est entrée à la Sorbonne Nouvelle en même temps qu’à l’École Normale Supérieure et y fait un master d’études théâtrales suivi de trois années de thèse, pendant cette période elle a eu l’occasion d’enseigner les étudiants de licence.5
En 2013 elle est partie, sans avoir mené à terme son doctorat, à Budapest où elle a enseigné le français et s’est consacrée à des travaux artistiques en tant qu’assistante-stagiaire à la mise en scène, elle y a œuvré en tant que dramaturge et elle a eu la chance de contribuer à plusieurs mises en scène. Après trois ans à Budapest, Alice Zeniter est revenue en France et s’est installée en Bretagne.
Depuis son enfance, elle a eu le goût de la lecture grâce à sa mère :
« Elle nous lisait surtout, à mes sœurs et moi, des contes de fées dans des livres qui lui avaient appartenu petite, des vieux livres, presque des grimoires, énormes ! » et sa sœur : « J’ai appris à lire à 4 ans parce que ma grande sœur me refaisait ses cours de CP grâce à une méthode, un peu contestable, de menaces avec des cannes des billard. »6
Alice Zeniter a commencé ainsi l’aventure de l’écriture quand elle était aussi jeune, à l’âge de 16 ans elle a publié son premier roman qui s’intitule deux moins un égal zéro, suivi en 2010 par son deuxième roman Jusque dans nos bras un roman qui raconte l’histoire d’une fille algérienne de par son père et française par sa mère, la fille a grandi depuis l’enfance avec son ami malien Amadou qui va lui demander de l’épouser, un mariage blanc, pour qu’il puisse régulariser sa situation.
En 2013 elle a publié son troisième roman sombre dimanche, qui retrace une histoire d’une famille hongroise vivant dans la mélancolie et le silence sous le règne de Staline, une situation.
5 Salon livre Paris, Alice Zeniter, in Bablio, en ligne https://www.babelio.com/auteur/Alice-Zeniter/94032 (consulté le 28/04/2020 à 00:43h)
6 Julia Vergely, Alice Zeniter : “Toute mon enfance j’ai lu de tout dans un joyeux bordel”, in Telerama, en ligne https://www.telerama.fr/enfants/alice-zeniter-quand-jecris-pour-les-enfants,-je-me-laisse-aller,-sans- snobisme,n6140266.php (consulté le 30/04/2020 à 22 :35 h)
qui perdurait même après l’effondrement de l’URSS. En 2015 la parution de son quatrième roman juste avant l’oubli, qui est couronné par le Prix Renaudot des Lycéens, et lui a valu un large écho parmi le jeune lectorat ; il raconte l’histoire d’une jeune fille Émilie, qui attend son compagnon sur une île abandonnée depuis la disparition brusque de Galwin Donnell, un auteur pour qui Émilie voudrait consacrer une thèse ; sur l’île étrange, la rencontre ne passe pas comme prévu.
Et finalement en 2017, la publication de l’Art de Perdre, le roman qui a reçu beaucoup de récompenses dont le fameux Prix Goncourt des lycéens qui fait connaitre Alice Zeniter à un plus large public, il relate une saga familiale dont l’histoire s’inscrit entre l’Algérie et la France par trois générations différentes.
Alice Zeniter traduit aussi des romans de l’anglais au français comme I Love Dick, écrit des nouvelles et des pièces de théâtre et des contes musicaux tels Ours of course.
- Résumé de L’Art de Perdre:
L’Art de Perdre retrace une saga familiale sur trois générations et s’étend sur plus d’une soixantaine d’années, avec la guerre d’Algérie et les enjeux d’immigrations comme toile de fond. D’ailleurs, l’idée même de ce roman semble inspirée d’un voyage en l’Algérie :
« Quand êtes-vous allée en Algérie la première fois ?
En 2011. Et une deuxième fois en 2013. La première fois, j’y suis allée avec mon meilleur ami qui est fils de pied-noir, on s’était toujours dit qu’on ferait ce voyage un jour. Son petit frère, qui est réalisateur de documentaires, nous a proposé de partir et de filmer ce voyage. Comme il avait des fonds et devait les utiliser dans les trois prochains mois, les choses sont devenues réelles avec une soudaineté que je n’avais pas envisagée.
C’est plutôt lors du deuxième voyage que l’idée du livre est née, sans que ce soit exactement ce livre-là.7
Après ce voyage, Alice Zeniter prend conscience que l’Histoire a encore des répercussions sur les migrants : « Je me suis lancée dans cette entreprise au moment où j’ai réalisé le parallèle avec la situation actuelle des migrants »8 elle aura par la suite à effectuer une enquête de documentation et d’interprétation.
Le roman est divisé en trois parties ; l’odyssée de Naima prend son origine en Algérie en 1930, avec Ali un pauvre adolescent, qui travaille dans les champs et qui s’engage dans l’armée française pendant la Deuxième Guerre mondiale et participe à la terrible bataille de Monte Cassino, pour nourrir sa famille après la mort de son père.
En rentrant en Algérie le destin l’enrichit lorsque le torrent fluvial lui apporte un pressoir d’huile, Ali devient vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, l’homme riche et le notable écouté de la crête. Pour pouvoir transmettre et léguer tous ses biens, après avoir divorcé de la première femme stérile, Ali épouse une jeune femme que la narratrice appellera tout au long du récit « Yema », il aura avec elle dix enfants dont Hamid est l’aîné.
Tandis qu’Ali profite de sa vie entre les rencontres à l’Association, la fête de circoncision de son fils Hamid et les naissances de ses autres enfants, la guerre de la libération de l’Algérie s’embrase notamment avec l’embuscade de Palestro ; du
7 Claire Devarrieux, Entretien avec Alice Zeniter, in libération, en ligne https://next.liberation.fr/livres/2017/09/01/entretien-avec-alice-zeniter-enfant-j-ignorais-pourquoi-on-n-allait-pas- en-algerie_1593592 (consulté le 28/04/2020 à 23:15)
8 Ibid.
coup, Ali doit choisir son camp, celui de choisir de se tenir au côté de l’armée de libération ou avec les français. S’étant trompé à choisir le bon camp, en croyant au mythe de la France invincible, Ali se trouve contraint de fuir, de laisser derrière lui tous ses souvenirs de l’Algérie.
La deuxième partie du roman est consacré à l’histoire d’Hamid qui après avoir été l’enfant gâté en Algérie se retrouve subitement entouré de barbelés dans les camps de transit, au milieu des baraquements et à subir toute forme de misère dont la famine est certainement la plus dure. Ce changement brusque dans la situation, et l’entrée soudaine à l’adolescence, tout ça lui était incompréhensible d’autant plus qu’il n’a jamais compris les raisons de ce changement de situation vu le mutisme de son père.
Hamid cherche l’émancipation, tente de mener sa vie loin des camps, alors il excelle dans ses études, se fait des amis en dehors du camp, s’intègre dans la société française, et finalement rencontre Clarisse sa future épouse et la mère de ses quatre filles dont la narratrice Naima.
L’histoire se poursuit avec Naima qui n’a jamais compris le regard accusateur de la société envers elle après tout attentat en Europe, elle n’a jamais connu ses origines, à cause des silences tenaces de son père. Avant d’être l’histoire d’Ali ou d’Hamid c’est l’enquête et l’histoire de Naima dont le métier est galeriste, celle qui tente de déterrer l’Histoire enfouie, notamment après les rencontres avec Lalla le peintre qui lui dévoile certaines vérités sur l’Algérie.
À travers trois personnages fictifs, l’auteure retrace différentes expériences historiques et traite des questions fondamentales sur l’identité : Ali et l’Histoire de la guerre, Hamid et la question de déracinement, enfin Naima et la crise identitaire. Les trois parties du roman retracent une Histoire marginalisée, méconnue, et même s’il y a d’autres thèmes secondaires comme les voyages, la mélancolie, l’amitié et la famine, l’auteure revient irrémédiablement à la question d’Histoire de la guerre et de l’immigration.
L’Art de Perdre a été honoré par plusieurs prix littéraire dont : Prix Landernau 2017, prix littéraire du Monde 2017, prix Goncourt des lycéens 20179, prix Goncourt choix de Polonais10, prix Goncourt choix de Suisse11 et finaliste de prix Goncourt et prix Femina12.
9 Babelio, L’Art de perdre, in BEBLIO en ligne https://www.babelio.com/livres/Zeniter-LArt-de-perdre/956484 (consulté le 02/05/2020 à 23 :20h)
10 IF Livre, Verdict de la 20éme édition du prix “ Le Choix Goncourt de la Pologne ” 2017, en ligne http://iflivre.institutfrancais.com/fr/actualites/institut-francais/verdict-20eme-edition-du-prix-choix-goncourt- pologne-2017(consulté le 02/05/2020 à 00:20h)
11 Alice Zeniter, Choix Goncourt de la Suisse 2017, https://ch.ambafrance.org/Alice-Zeniter-Choix-Goncourt-de- la-Suisse-2017 (consulté le 02/05/2020 à 23 :00h)
12 Elisabeth Philippe, Que vaut « l’Art de perdre » d’Alice Zeniter, prix Goncourt des lycéens 2017 ? In BIBLIOBS en ligne https://bibliobs.nouvelobs.com/sur-le-sentier-des-prix/20171116.OBS7427/que-vaut-l-art-de-perdre-d- alice-zeniter-prix-goncourt-des-lyceens-2017.html (consulté le 02/05/2020 à 23 :45h)
Une revue historique :
La professeure agrégée d’histoire moderne Claire Eldridge de l’Université de Leeds, Royaume-Uni, a traité l’Histoire des Harkis dans son étude intitulée : «’Nous n’avons jamais eu une voix’ : la construction de la mémoire et les enfants des Harkis (1962–1991)», elle a traité des préoccupations liées aux multiples voix qui faisaient écho au souvenir de ce qu’on appelle
«les oubliés de l’histoire»13.
Pour ce faire, elle a défini le terme Harkis à partir de différentes sources. Les Harkis sont ces auxiliaires algériens analphabètes et ruraux qui ont aidé volontairement l’armée française pendant la révolution d’indépendance ; le terme a été inventé en 1956 à partir de l’expression arabe Harka qui signifie « mouvement » ; ils étaient nombreux en 1958. Cependant, leur nombre a diminué dans la dernière phase de la guerre.
En France, les Harkis évacués après l’indépendance n’ont pas trouvé la paix, ils ont vécu dans un état désastreux, contrairement aux Européens ou aux pieds-noirs, les Harkis étaient hors des calculs gouvernementaux en raison de leur nombre énorme, Larzac, Rivesaltes et Bias étaient des noms de camps qui les abritaient, certains y sont envoyés pour être assimilés dans la nouvelle société, tandis que beaucoup travaillent dans les hameaux forestiers.
Les Harkis se sont également rassemblés dans des communautés ou cités urbaines comme Lodève dans l’Hérault. Cependant, les membres les plus faibles ou les moins aptes à s’intégrer de la communauté Harkis étaient condamnés à vivre dans des camps ou ce que l’on appelle des zones à forte concentration, jusqu’en 1981, une estimation de 3560 familles y vivaient en donnant naissance à une deuxième génération.
La mémoire liée à la guerre était absente du discours quotidien des Harkis, et malgré tout ce qu’ils endurent dans les camps, le silence était dominant, cela remontait à de nombreux facteurs externes tels que l’analphabétisme et l’isolement. Alors que dans d’autres cas, la mémoire était absente parce que les Harkis ont hérité de la tradition islamique et nord-africaine qui liait le silence à la déférence paternelle, et que les enfants respectent cela sans poser de questions, un autre facteur majeur qui était l’atmosphère de peur à l’intérieur des camps, ils
13 Claire Eldridge, ‘We’ve never had a voice’: memory construction and the children of the harkis (1962–1991), in Oxford Academic, en ligne https://academic.oup.com/fh/article/23/1/88/668266 (consulté le 03/06/2020 à 22:18h)
avaient peur de dire quelque chose de mal qui conduirait en hôpital psychiatrique, ou en centre disciplinaire pour les plus jeunes.
Le chaos psychologique a assombri leur perception de soi, qu’ils soient traîtres ou patriotes. Dans l’autobiographie de Saïd Ferdi, Un enfant dans la guerre, où il raconte comment il est devenu Harki, il dit qu’il avait treize ans lorsqu’il a été capturé par les troupes françaises, torturé et emprisonné pendant des jours, l’ensemble de son village pensa qu’il était devenu un traître, ainsi ils ont maltraité et mis en danger sa famille, en conséquence, il s’est enrôlé dans l’armée française et devenu Harki14.
L’histoire de Ferdi était très significative dans une communauté silencieuse, contrairement à d’autres témoins de la guerre semblables aux pieds-noirs à qui ils racontaient leurs souvenirs, les Harkis ont été complètement paralysés par leurs peurs, jusqu’aux années 1970 lorsqu’ils ont organisé le Mouvement d’assistance et de défense des rapatriés d’Afrique du Nord (MADRAN) devenant ainsi visible à l’opinion publique pour la première fois, actuellement, plus de 540 organisations défendent les droits de ces communautés.
14 Algeriades, Un enfant dans la guerre de Saïd Ferdi, in Algériades, en ligne http://www.algeriades.com/said-ferdi/article/un-enfant-dans-la-guerre-de-said (consulté le 04/06/2020 à 21:45)
Questions Fréquemment Posées
Quelle est la méthodologie d’analyse littéraire utilisée dans L’Art de Perdre d’Alice Zeniter ?
Ce mémoire cherche à mettre en lumière la particularité de l’écriture romanesque de l’Histoire à travers de différents pôles d’analyse, en interrogeant les relations qu’entretiennent le fictionnel et le référentiel.
Comment Alice Zeniter utilise-t-elle la fiction pour traiter l’Histoire dans son roman ?
L’Art de Perdre retrace l’histoire des Algériens ayant collaboré avec la France pendant la Révolution algérienne, offrant une perspective alternative sur les événements.
Quels sont les objectifs de l’étude sur L’Art de Perdre ?
L’étude analyse comment l’auteure utilise la fiction pour combler les lacunes historiques et cherche à révéler les motivations et les desseins de l’auteure.