La méthodologie d’analyse historique révèle comment L’Art de Perdre d’Alice Zeniter transcende la fiction pour réhabiliter des vérités oubliées. En explorant les origines et leurs impacts, cette étude offre une perspective inédite sur les récits algériens, essentielle pour comprendre la mémoire collective.
Chapitre 03 :
Vers la réhabilitation d’une vérité historique
Outre les thématiques de la guerre et de l’immigration qui traversent l’intrigue, L’Art de Perdre est surtout un roman qui montre à quel point sont enracinées les origines, et leur impact tenace sur les descendants, en l’occurrence Naima, qui, à un moment donné, cherche à en exhumer l’Histoire enfouie.
Une dimension autobiographique :
Dans L’Art de Perdre, il ne saurait être question d’aborder le récit comme une simple écriture remémorative d’une fresque romanesque ; il vaudrait peut-être mieux l’interroger dans ses subtilités et ses particularités, celles d’un roman déroutant qui nous immerge tantôt dans le passé lointain d’Ali, tantôt dans le présent et l’actualité de Hamid et Naima ; comme le disait Barthes concernant le texte littéraire :
« Texte de jouissance : celui qui met en état de perte, celui qui déconforte […] fait vaciller les assises historiques, culturelles, psychologiques, du lecteur, la consistance de ses goûts, de ses valeurs et de ses souvenirs, met en crise son rapport au langage ».125
Naviguant par vents contraires des écrivains français contemporains qui convergent vers le réalisme en littérature126, Alice Zeniter étant encline à des sujets curieux, choisit de traiter une Histoire en marge et une crise identitaire, deux thèmes qui traversent le roman du début à sa fin, et qui lancent l’écrivaine dans une enquête d’exploration des origines familiales.
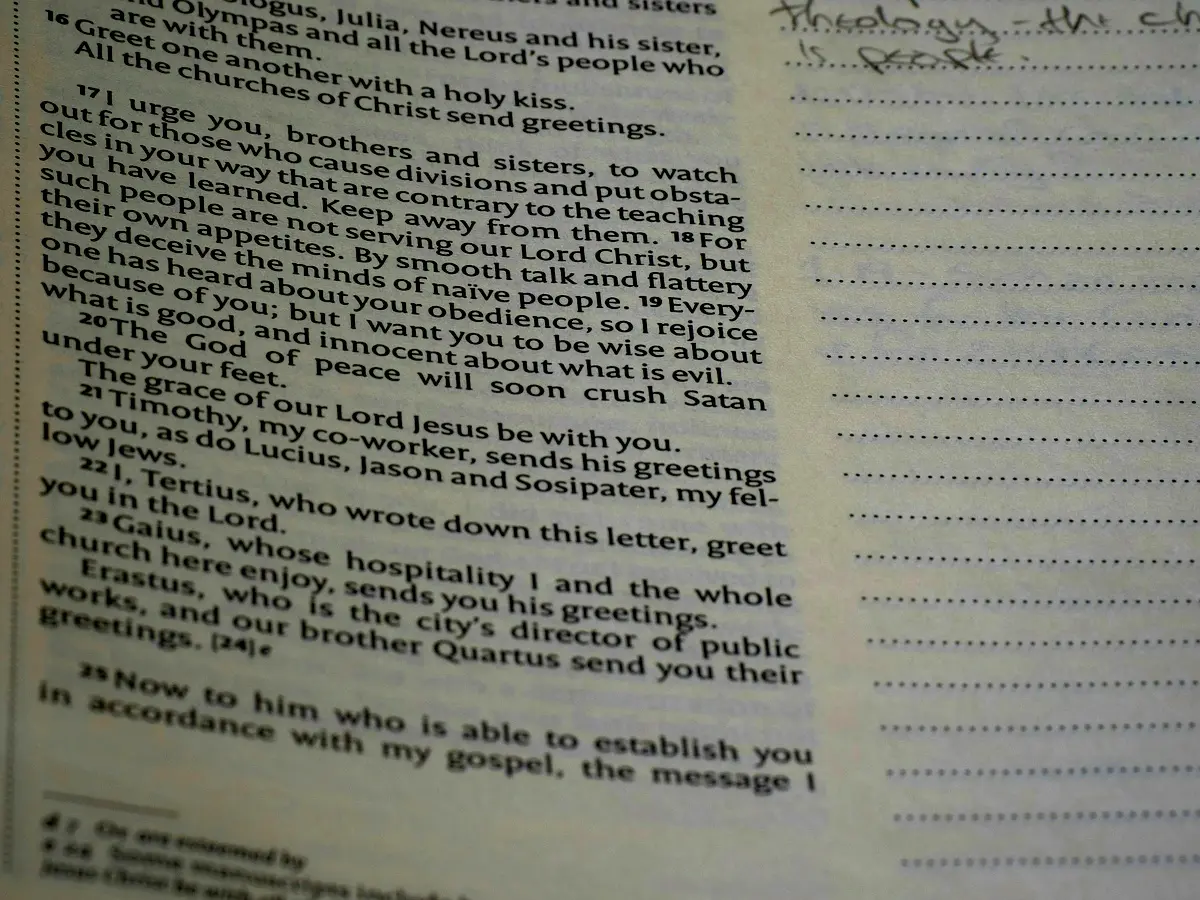
On est donc face à un sujet riche à étudier et au cœur de la réflexion de J. Starobinski qui estime que : « c’est la reconnaissance de l’œuvre comme relation différentielle et polémique avec la littérature antérieure ou avec la société environnante qui permet de sceller une authentique relation critique par laquelle l’œuvre devient sujet autant qu’objet de la conscience »127
D’ailleurs, le thème de la guerre d’Algérie semble assez récurant chez les écrivains contemporains tels que Laurent Mauvignier et son roman Des Hommes, Kaouther Adimi et son roman Nos Richesses et Jérôme Ferrari avec le roman Où j’ai laissé mon âme.
125 Roland Barthes, Le Plaisir du texte, Éditions du Seuil, Coll « « Tel Quel » », 1973, p.26.
126 Papa Samba Diop, Alain Vuillemin (dir), Les littératures en langue française, France, PUR, 2015, p.115.
127 J. Starobinski, La Relation critique, L’ŒIL vivant II, Paris, Gallimard, 1967, p. 22.
De même, Alice Zeniter exploite cet intérêt pour nous offrir ce roman qui met en lumière une saga familiale, mène une enquête de réhabilitation et de mettre des mots sur les silences de l’Histoire. Plus fondamentalement, une histoire individuelle d’une personne qui voudrait partager ses douleurs léguées et ses maux intimes et tenaces, que l’auteure nous confie dans un aveu dès la première page du roman : « Depuis quelques années, Naima expérimente un nouveau type de détresse : celui qui vient désormais de façon systématique avec les gueules de bois. »128
Ce passage, pour ceux qui connaissent la vie d’Alice Zeniter, se lit comme une confession d’une personne héritière des silences liés à ses origines et qui se résout à entamer une enquête pour faire parler les mutismes obstinés du passé.129
Certes, rien ne pourrait trahir le « elle », qui représente Naima et derrière lequel se dissimule le narrateur, ni affirmer avec certitude qu’il s’agit de l’histoire d’Alice Zeniter : l’absence des pronoms de la première personne et des prénoms, complexités de focalisations, l’indécision des actes et l’indétermination des espaces pourraient éradiquer toute illusion autobiographique.
En effet, l’écrivaine elle-même dénie tout rapport avec Naima la narratrice lorsqu’elle est interrogée sur sa possible projection auctoriale dans le cadre de l’émission « la Grande Librairie » sur France 5 : « Je mets Naima à distance et en même temps c’est vrai qu’elle me sert à traverser toute une histoire, elle me sert un peu à faire passer dans les coulisses de l’écriture du roman, à traverser les phases de la recherche […] c’est un peu mon cheval de Troie »130
Difficile de trouver une meilleure explication pour définir le rôle de Naima, le personnage par lequel l’écrivaine mène l’enquête et traverse les épreuves. Il faut souligner aussi que cette enquête effectuée par Naima est passée tout d’abord par des documentations, des entretiens avec témoignages à l’appui tout en étant basée sur des bribes des souvenirs familiaux, pour lesquels Alice Zeniter accorde toute primauté au profit des voix polyphoniques et antérieures et au détriment de sa propre voix, vu que ce sont ses aïeuls qui enduraient les expériences de la guerre et l’exil, tandis que l’écrivaine n’a d’appui que sa propre fiction pour rapprocher cette vérité.
128 Alice Zeniter, L’Art de Perdre [2017], France, J’ai Lu, 2019, p. 07.
129 Entrée libre, Zeniter l’art d’écrire, in Youtube, en ligne https://www.youtube.com/watch?v=SgBVCwckS4o&t=94s (consulté le 20/07/2020 à 02:54h)
130 La Grande Librairie, Algérie – France, destins croisés, in Youtube, en ligne https://www.youtube.com/watch?v=XXEAH4eyTlg (consulté le 22/07/2020 à 14:30h)
Dès le premier chapitre, l’auteure annonce son intention de réinventer une réalité en soi, alors le récit n’aurait pas pu fortuitement commencer par l’histoire occultée d’Ali, c’est ainsi que l’auteure voudrait dire qu’il est impossible d’exhumer l’Histoire sans passer par la mémoire, et que son récit n’est qu’un agencement et une narrativisation de la mémoire qui la contraint à opter pour une démarche arbitraire et faire succéder les événements selon ses propres souvenirs :
« c’est pour cela que cette partie de l’histoire, pour Naima comme pour moi, ressemble à une série d’images vieillottes[…] entrecoupées de proverbes, comme des vignettes cadeaux de l’Algérie qu’un vieil homme aurait cachées çà là dans ses rares discours, que ses enfants auraient répétées en modifiant quelques mots et que l’imagination des petits-enfants aurait ensuite étendues, agrandies, et redessinées pour qu’elles parviennent à former un pays et l’histoire d’une famille. »131
Outre le « moi », rarement présent dans le roman, et qui pourrait trahir la subjectivité, on distingue une sorte d’autojustification de la part de l’auteure qui assume la responsabilité de raconter l’Histoire, légitimant son investigation de vérité par les non-dits et les béances de la mémoire des autres, c’est ce qu’elle a avoué littéralement : « C’est pour cela aussi que la fiction tout comme les recherches sont nécessaires, parce qu’elles sont tout ce qui reste pour combler les silences transmis entre les vignettes d’une génération à l’autre »132
En outre, Alice Zeniter se justifie en mêlant sa voix avec les voix des marginalisés de l’Histoire, et prétend parler au nom du « nous » incluant tous ceux de sa communauté qui se sentent lésés, en abordant l’Histoire par la mémoire collective et en s’accordant avec les idées préconçues dans la société.
Qui plus est, les souvenirs et la mémoire familiale léguée marque l’écriture dans L’Art de Perdre d’une dimension autobiographique assez distincte, vu la similitude de parcours remarquable entre Alice Zeniter et Naima le personnage principal, on cite le plus pertinent du point de vue de l’auteure à savoir les souffrances des non-dits : « L’ellipse de ma narration, c’est aussi celle que fait Ali, c’est celle que connaîtront Hamid puis Naima lorsqu’ils voudront remonter les souvenirs : de la guerre on ne dira jamais que ces deux mots, « la guerre », pour remplir deux années »133
131 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p. 23.
132 Ibid.
133 Ibid, p.21.
C’est de l’aveu de l’auteure que le fait de retracer l’Histoire de la guerre et de l’immigration sont relevées d’emblée de l’indicible et de l’inouï, car finalement c’est une expérience très atroce et cruelle qui s’oppose même à la loi de bienséance. Et c’est par là que se constitue le défi pour l’auteure, l’écrivaine se voit contrainte de dire son expérience et ne se laisse pas dévorer par l’oubli de l’Histoire, elle s’engage à écrire et élucider l’absurdité de son expérience, c’est un triomphe de
l’écriture et du sens, mais c’est encore un exaucement de voix de l’intérieur qui la harcèle : «Ce ne sont pas les trépassés qui viennent nous hanter, mais les lacunes laissées en nous par les secrets des autres. »134
Alice Zeniter dote le personnage Naima des traits marquant de sa vie et de son histoire familiale, tels que la naissance d’un père algérien ayant vécu la guerre d’Algérie, l’immigration, les amies comme sol et Élise qu’elle a cité dans le remerciement du roman, le camp de Rivesaltes, la mort de son oncle pendant la décennie noire et tant d’autres similarités ; et elle faisait de même avec les traits saillants de son caractère tels que l’admiration du cinéma et de la photographie et l’esprit
de recherche. Cependant, elle l’a privé du « Je » et d’être son double, refusant d’aborder son œuvre comme un roman autobiographique basé sur des faits autoréférentiels : « Je ne savais pas si je voulais raconter à la première ou la troisième personne, c’est en avançant dans l’écriture que j’ai eu envie qu’elle soit un personnage, et moi, ne nous voilons pas la face, je suis l’écrivaine, je suis le maître des marionnettes, ce n’est pas la même chose.
Je vais revendiquer que ceci est ma place et que celle-là est la sienne. »135, et elle affirme aussi clairement : « je suis parti d’éléments de l’histoire familiale, mais comme elle était extrêmement trouée il a fallu que je fasse beaucoup de recherches et puis une mise en fiction, donc ça n’est pas autobiographique, ça n’est pas autobiographique, c’est une forme hybride.
»136 Délibérément, Alice Zeniter met Naima à distance pour pouvoir parler librement de son sujet, on pourrait en déduire que l’auteure ne voudrait pas s’attacher étroitement à l’éthique et à la transmission aveugle sur sa propre responsabilité, et laisser place à la fiction et à l’esthétique
134 Nicolas Abraham, L’écorce et le noyau, Algérie – France, destins croisés, in Youtube, en ligne https://www.youtube.com/watch?v=XXEAH4eyTlg (consulté le 22/07/2020 à 16:10h)
135 Claire Devarrieux, entretien avec Alice Zeniter, in Libération, en ligne https://next.liberation.fr/livres/2017/09/01/entretien-avec-alice-zeniter-enfant-j-ignorais-pourquoi-on-n-allait-pas-en-algerie_1593592 (consulté le 19/07/2020 à 1:15h)
136 France 3 Normandie, « Son Goncourt des lycéens en poche, l’Alençonnaise Alice Zeniter rentre « à la maison » » in Youtube, en ligne https://www.youtube.com/watch?v=DkxiLjc6uNs (consulté le 22/07/2020 à 15:35h)
qui pourrait combler les failles de mémoire et d’Histoire officielle mystifiante, comme le confirme la citation suivante :
« La troisième personne produit un effet comparable à ce que peut éprouver quelqu’un qui, s’étant exprimé au sein de la complémentarité imaginaire je-tu, entend ses propos rapportés auprès d’un tiers. Ces mots, ainsi représentés à la place de l’autre, risquent de paraitre étrangers, impersonnels. L’image qu’il se donnait de lui-même se voit entamée puisque le « je » est, en quelque sorte, mort pour celui qui est désormais porteur de sa parole. »137
Alors Naima en dépit de tout ce qu’elle tient de sa créatrice, demeure cependant la dépersonnalisation même d’Alice Zeniter dans le roman, c’est Naima qui l’épargne de tout soupçon, Naima c’est un acte de précaution qui permet à l’auteure de traiter l’Histoire aisément et par de multiples trajectoires loin de l’autoréférence et des accusations.
En somme, si Naima et son histoire font de près ou de loin écho à Alice Zeniter, cela ne constitue pas le seul point de réflexion, ce qui est important pour l’écrivaine c’est de se retrouver par l’écriture, de refuser de sombrer dans l’oubli et de trouver un point de départ pour chercher le soi par la littérature :
« Ainsi, si la fiction nous interroge au plus proche de notre vie immédiate, le récit historique vient nous chercher dans notre vie collective. Chacun de nous possède donc une »identité narrative », construite au croisement de l’histoire et de la fiction, une identité faite de nos actes déjà posés, de ceux que nous voulons accomplir, inscrits dans les lignés auxquelles nous appartenons, au nom des convictions héritées. Une identité que nous affinons, expliquons et rationnalisons à l’aide de tous les récits, fictionnels ou historiques, auxquels nous avons accédé. »138
137 Llewellyn Brown, Nom et tressage : L’Acacia de Claude Simone, p. 35. In, Persée, en ligne https://www.persee.fr/doc/litt_00474800_2001_num_123_3_1718#:~:text=La%20troisi%C3%A8me%20persone
%20produit%20un,risquent%20de%20para%C3%AEtre%20%C3%A9trangers%2C%20impersonnels. (consulté le 25/07/2020 à 03 :12h)
138 Odile Riondet, Paul Ricœur : le texte, le récit et l’Histoire, in BBF, en ligne https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2008-02-0006-001 (consulté le 25/072020 à 1:20h)
________________________
125 Roland Barthes, Le Plaisir du texte, Éditions du Seuil, Coll « « Tel Quel » », 1973, p.26. ↑
126 Papa Samba Diop, Alain Vuillemin (dir), Les littératures en langue française, France, PUR, 2015, p.115. ↑
127 J. Starobinski, La Relation critique, L’ŒIL vivant II, Paris, Gallimard, 1967, p. 22. ↑
128 Alice Zeniter, L’Art de Perdre [2017], France, J’ai Lu, 2019, p. 07. ↑
129 Entrée libre, Zeniter l’art d’écrire, in Youtube, en ligne https://www.youtube.com/watch?v=SgBVCwckS4o&t=94s (consulté le 20/07/2020 à 02:54h) ↑
130 La Grande Librairie, Algérie – France, destins croisés, in Youtube, en ligne https://www.youtube.com/watch?v=XXEAH4eyTlg (consulté le 22/07/2020 à 14:30h) ↑
131 Alice Zeniter, L’Art de Perdre, op.cit, p. 23. ↑
134 Nicolas Abraham, L’écorce et le noyau, Algérie – France, destins croisés, in Youtube, en ligne https://www.youtube.com/watch?v=XXEAH4eyTlg (consulté le 22/07/2020 à 16:10h) ↑
135 Claire Devarrieux, entretien avec Alice Zeniter, in Libération, en ligne https://next.liberation.fr/livres/2017/09/01/entretien-avec-alice-zeniter-enfant-j-ignorais-pourquoi-on-n-allait-pas-en-algerie_1593592 (consulté le 19/07/2020 à 1:15h) ↑
136 France 3 Normandie, « Son Goncourt des lycéens en poche, l’Alençonnaise Alice Zeniter rentre « à la maison » » in Youtube, en ligne https://www.youtube.com/watch?v=DkxiLjc6uNs (consulté le 22/07/2020 à 15:35h) ↑
137 Llewellyn Brown, Nom et tressage : L’Acacia de Claude Simone, p. 35. In, Persée, en ligne https://www.persee.fr/doc/litt_00474800_2001_num_123_3_1718#:~:text=La%20troisi%C3%A8me%20persone ↑
138 Odile Riondet, Paul Ricœur : le texte, le récit et l’Histoire, in BBF, en ligne https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2008-02-0006-001 (consulté le 25/072020 à 1:20h) ↑
Questions Fréquemment Posées
Comment Alice Zeniter aborde-t-elle la relation entre fiction et histoire dans L’Art de Perdre ?
Alice Zeniter utilise la fiction pour combler les lacunes historiques et offrir une perspective alternative sur les événements, en mettant en lumière une saga familiale et en menant une enquête de réhabilitation.
Quelle est la dimension autobiographique dans L’Art de Perdre ?
La dimension autobiographique se manifeste à travers le personnage de Naima, qui cherche à exhumer l’Histoire enfouie et partage ses douleurs léguées, bien que l’auteure dénie tout rapport direct avec ce personnage.
Quels thèmes principaux sont explorés dans L’Art de Perdre ?
Les thèmes principaux incluent la guerre d’Algérie, l’immigration, les origines familiales et la crise identitaire, qui traversent le roman du début à la fin.