Les meilleures pratiques linguistiques révèlent que le français, en tant que langue véhiculaire, joue un rôle crucial dans la communication des étudiants subsahariens à Constantine. Cette étude met en lumière des dynamiques linguistiques fascinantes, essentielles pour comprendre l’intégration culturelle dans un contexte universitaire diversifié.
Le registre de langues le plus fréquent
Le registre de langue ou encore niveaux de langue renvoie aux différentes manières d’exprimer un même message au sein d’une communauté linguistique donnée. En effet ces différentes manières peuvent varier chez un même locuteur ou bien d’un locuteur à un autre selon la situation de communication. Cependant il existe plusieurs types de registre de langues, nous proposons ci-joint la classification des registres selon Françoise Gadet32 :
- Soutenu : recherché, soigné, cultivé, élaboré, contrôlé, tendu ;
- Standard : standardisé, courant, commun, neutralisé, usuel ;
- Familier : relâché, spontané, ordinaire ;
- Populaire : vulgaire, argotique.
Nous sommes référés aux caractéristiques de ces différents registres et dans notre corpus nous avons remarqué que le plus fréquent est le registre familier dont les caractéristiques sont :
- De nombreuses abréviations ;
- Forme interrogative directe simple et sans inversion du sujet ;
- Un vocabulaire relâché ;
- Remplacement de « nous » par le pronom sujet « on » ;
- La suppression de « ne » dans les locutions négatives ;
- L’utilisation abusive du présent de l’indicatif ;
- Une prononciation plus rapide et moins soignée ;
- Une syntaxe simplifiée et souvent approximative : des phrases courtes, parfois inachevées, ou au contraire, interminables; des phrases nominales, souvent asyntaxiques.
La plupart des caractéristiques énumérées ci-dessus sont attestées chez nos enquêtés, plus précisément dans leurs productions orales que nous avons soumis à l’analyse.
Dans les extraits suivants par exemple nous remarquons la fréquence des interrogations directes, sans inversion du sujet :
Extrait de l’enregistrement N°3 :
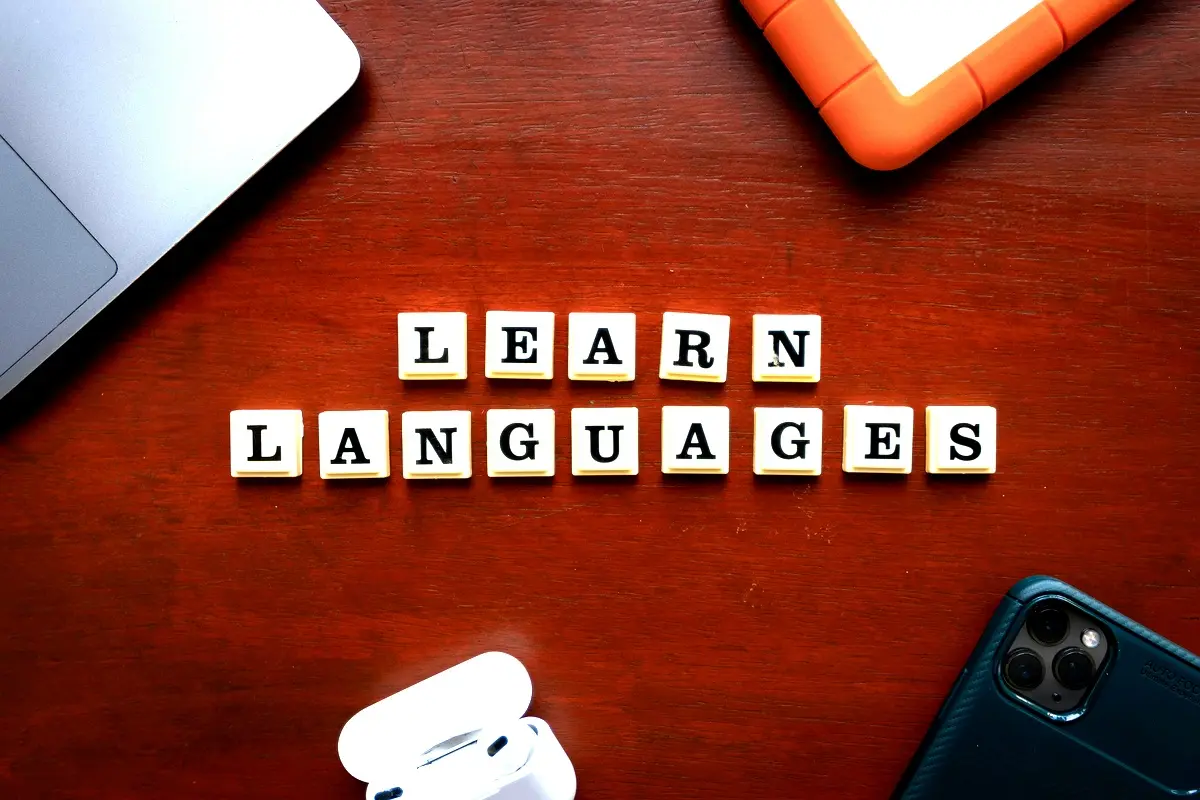
I2 : tu peux arranger ça non
Extrait de l’enregistrement N°4 :
32 GADET Françoise, 2003, La Variation sociale en français, Paris, Orphrys, P.99.
I1: euh tu as tu as déjà déposé le mémoire ou bien
I2: non non non j’ (ne) ai pas encore fini il me reste les parties dédicaces et xxx
I1: et tu vas déposer quand
I1: tu veux prier
Nous constatons dans l’extrait ci-dessous l’utilisation d’un vocabulaire relâché. Extrait de l’enregistrement N°5 :
I4: il fait comme ça /./ aujourd’hui /./ il filmait comme ça /./ il fait ça là /../ je le taquinais quoi ah mais toi tu (ne) t’habilles pas bien mais prouve que tu es avec moi oh :: je le taquinais /../ ah le gars a sorti iPhone avec trois oreilles ah j’ai vu ça (rire) y’a pas match
Dans les extraits suivant nous soulignons le remplacement de « nous » par le pronom sujet « On » :
Extrait de l’enregistrement N°6 :
I3: vous faites la même chose
I2: oui on fait la même chose
Extrait de l’enregistrement N°7 :
I3: parce que genre c’est très risqué au fait /./ genre /./ nous par exemple on (ne) sera pas en contact direct avec les patients /./ mais /./ c’est nous on doit contrôler genre le sous dosa / le sous dosage le sur dosage /../ donc si tu fais une erreur là /
Extrait de l’enregistrement N°8 :
I2: moi-même je (ne) sais pas (rire) /./ c’est casque ou bien on doit acheter /./ mais ce qui est sûr on doit acheter marteau (rire)
Nous avons également souligné dans la quasi-totalité des enregistrements la suppression de « ne » dans les locutions négatives que nous avons pris soin de mettre entre parenthèses et en gras comme nous l’avons souligné dans le protocole de transcription. À titre d’exemple nous pouvons citer :
Extrait de l’enregistrement N°8 :
I1: tu sais que même le coupecoupe /./ on (ne) vend pas ça comme ça hein /./ et la scie on ne nous vend pas ça /./ on vous demande /../ on te regarde /./ bizarrement /./ on te regarde bizarrement et après on te demande tu vas faire quoi avec /./ mais j’en ai besoin je (ne) vais pas me suicider est-ce que je suis suicidaire /./ eh /../ si j’ai envie de me suicider je pars je me jette et puis c’est bon > /
Extrait de l’enregistrement N°4 :
I2: non non non j’ (ne) ai pas encore fini il me reste les parties dédicaces et xxx
I1: on est dans la même faculté /./ mais eux ::: ils (ne) font pas le truc de mémoire là
/../ mais chez nous y’a ça
I1: [ wallay ] (du zarma ou songhaï) je (ne) sais /./ je (ne) sais pas
Extrait de l’enregistrement N°3 :
I2: tu vas ici là en haut la tu (ne) vas pas toucher
Conclusion partielle
Pour conclure ce chapitre, nous pouvons déduire que les résultats obtenus par le biais des enregistrements appuient ceux relevés dans le questionnaire. En effet l’analyse des enregistrements et celle du questionnaire prouvent l’usage quotidien de la langue française chez les locuteurs subsahariens au sein des résidences de l’Université Salah Boubnider.
Cependant même si à travers l’analyse qualitative nous avons constaté l’existence de plusieurs langues en présence, nous tenons effectivement à souligner que la langue française occupe une importante position dans les communications quotidiennes de nos enquêtés, c’est la langue la plus utilisée par cette communauté à côté de laquelle nous pouvons rajouter également l’anglais.
La langue française domine les échanges linguistiques malgré le plurilinguisme qui se manifeste dans cet espace et l’attachement de ces locuteurs à leur langue d’origine.
Conclusion générale
Dans cette étude nous avons analysé l’usage de la langue française chez les étudiants subsahariens dans les résidences de l’université Salah Boubnider, une communauté principalement plurilingue. Pour cela, nous avons en premier lieu administré sur trente-cinq locuteurs appartenant à des profils différents un questionnaire. Ajouté à ce dernier, nous avons également effectué quelques enregistrements afin d’avoir un aperçu sur les langues en présences avec le français chez notre public et de confirmer leurs propos évoqués au départ dans le questionnaire.
En effet, les principaux résultats montrent que la langue française est la langue la plus parlée et la plus entendue par ces locuteurs subsahariens dans leurs résidences respectives. À cet effet, l’usage de cette langue se fait quotidiennement par ces locuteurs, que ce soit entre eux et même avec leurs hôtes algériens, même si dans l’analyse qualitative nous avons souligné la présence d’autres langues par le biais de leurs productions orales que nous avons enregistrées.
Cela n’est d’ailleurs pas un secret, étant donné qu’aucune langue ne peut échapper au phénomène de contact de langues dans ce monde.
En définitive, les résultats obtenus par le biais des enregistrements corroborent ceux recueillis par questionnaire, cela explique le fait que l’analyse quantitative et l’analyse qualitative sont complémentaires.
Suite aux résultats, nous avons découvert effectivement que la langue française est la langue la plus parlée et la plus entendue dans ces résidences. La totalité de nos enquêtés ont affirmé comprendre la langue française, même si au cours de notre analyse nous avons constaté que les uns la connaissaient bien avant parce que c’est leur langue officielle et les autres l’ont découverte ici en Algérie où elle est leur langue d’étude.
Cette minorité regroupant généralement les subsahariens non francophones une fois ici en Algérie passe une année de langue durant laquelle elle apprend la langue française. C’est par le cas ici à Constantine où ces subsahariens non francophones sont orientés vers le centre d’enseignement intensif des langues (CEIL).
Cependant le français sert de langue véhiculaire pour cette communauté entre eux, avec leurs hôtes algériens dont les langues leurs sont généralement étrangères et particulièrement avec les administrations de leurs résidences respectives.
En effet la fonction première d’une langue étant d’assurer l’unité quand il y a des bouleversements, la langue française remplit cette fonction au sein des résidences de l’Université Salah Boubnider. Celle-ci unit ces locuteurs venus des quatre coins de l’Afrique subsaharienne et possédant des cultures et langues différentes.
La valorisation de la française par ces locuteurs d’un côté et le manque d’alternative de l’autre sont à l’origine de l’implantation du français comme langue véhiculaire. Notre public est à majorité constitué de francophones.
Avec la représentativité de notre échantillon limité à trente-cinq questionné par questionnaire et l’enregistrement des productions orales de huit locuteurs, nous tenons à souligner que notre enquête ne peut être généralisée sur l’ensemble de la communauté subsaharienne à Constantine en particulier et en Algérie en général. C’est dans ce sens que nous souhaitons que d’autres recherches plus approfondies seraient entreprises sur la communauté estudiantine subsaharienne en Algérie comme par exemple : Quelles sont les pratiques langagières de la communauté estudiantine subsaharienne en Algérie ? Ou même sur les phénomènes linguistiques auxquels ils font recours dans leurs interactions quotidiennes.
________________________
32 Définition donnée par l’article 62 de la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai 2001. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quel est le registre de langue le plus fréquent parmi les étudiants subsahariens?
Le registre de langue le plus fréquent est le registre familier, qui se caractérise par de nombreuses abréviations, un vocabulaire relâché et une syntaxe simplifiée.
Comment le français est-il perçu par les étudiants subsahariens en Algérie?
Le français est perçu comme un outil de communication essentiel dans un contexte de diversité culturelle, et c’est la langue la plus utilisée parmi les étudiants subsahariens.
Quelles méthodes ont été utilisées pour l’enquête sur l’usage du français?
Les méthodes d’enquête incluent des questionnaires et des enregistrements pour une analyse approfondie des données.
