Les meilleures pratiques en communication révèlent des mécanismes de défense insoupçonnés dans le contexte congolais. Cette recherche innovante, alliant psychologie interculturelle et méthodologies mixtes, offre des perspectives cruciales pour comprendre les dynamiques de communication interculturelle.
- Conduite
- Notion de conduite
Transposé de la chimie, de la biologie et de la physiologie, le concept de conduite fut utilisé en psychologie animale dès la fin du XVIIIe siècle. Mais indépendamment de l’utilisation du terme, on peut affirmer que la tendance à objectiver les faits psychologiques dans le cadre des sciences naturelles ne put se consolider qu’à partir des théorisations darwiniennes autour de l’adaptation des organismes au milieu et de la continuité évolutive entre les animaux et l’homme.
Vers la fin du XIXe siècle, le concept a fait l’objet d’étude de la psychologie scientifique avec les travaux de Théodule Ribot et Pierre Janet123, une contribution française. Ce qui a fait émerger une nouvelle discipline, la psychologie de la conduite.
Pour ces auteurs, l’objet de la psychologie réside non pas dans le comportement, mais dans la « conduite », concept qui inclut non seulement les phénomènes élémentaires, comme les réflexes ou les instincts, mais également les phénomènes supérieurs dont les croyances, les jugements et les langages, dans lesquels intervient la « conscience ».
D’une observation fine et profonde de nombreux malades mentaux, Pierre Janet a dégagé une théorie du fonctionnement psychique, celle de la psychologie des conduites. Il distingue des niveaux hiérarchiques de conduite : les conduites de niveau inférieur (conduites instinctives) sont sous la dépendance des conduites de niveau supérieur qui font intervenir les principes moraux ou la raison et apparaissent lors de la « dissolution » de ces derniers.
L’actualisation de tel ou tel type de conduite dépend de la force psychologique de l’individu à un moment donné, c’est-à-dire de la quantité d’énergie psychique dont il dispose.
La réalisation de telle ou telle conduite dépend également de la tension psychologique, qui est l’aspect qualitatif de l’énergie psychique. La combinaison de la force et de la tension psychologiques explique l’apparition des phénomènes pathologiques. Si la tension reste au même niveau, alors que la force diminue, apparaissent les états de tristesse et d’effort. Par contre, si la tension diminue, les fonctions supérieures d’adaptation au réel sont submergées, comme dans le délire.
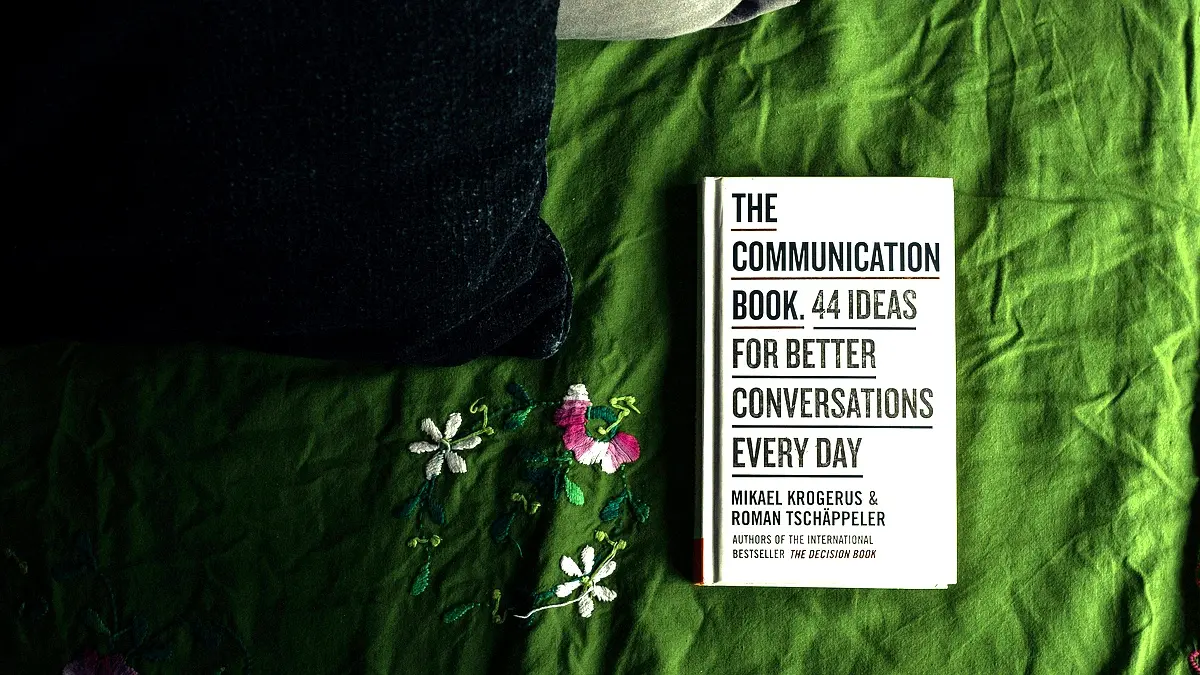
On peut retenir, en psychologie, qu’on entend par le mot « conduite » non seulement les actes élémentaires analogues à ceux des animaux, mais aussi les actes les plus complexes caractérisés par le rôle qu’y joue le langage.
La conduite, c’est un ensemble d’actes organisés qui ont un sens et qui poursuivent une finalité. Elle implique une attitude psychologique consciente ou inconsciente. Elle se caractérise par les éléments ci-après124 :
- l’inconscient, c’est-à-dire que les fins poursuivies par un sujet peuvent être inconscientes dans ce sens que l’homme ne peut pas toujours dire pourquoi il agit comme ça ou les buts poursuivis ;
- la signification que l’on donne à une situation quand on voit quelque chose, dépend de notre environnement culturel et social ainsi que son histoire personnelle. La signification que l’on donne à une situation conditionne sa manière d’être et de réagir ;
- l’utilité, les conduites sont des tentatives d’adaptation de l’individu à son milieu.
Parmi les éléments déclenchant la conduite, on peut citer : l’intentionnalité, la perception et la motivation. Mais ici nous allons nous intéresser principalement autour de deux premiers éléments.
- Intentionnalité, élément de conduite
L’intentionnalité permet à l’individu d’agir et de justifier ses actes. Elle se met une valeur positive ou négative en fonction de l’intensité de la motivation. La notion d’intentionnalité fut introduite par Franz Brentano (1838-1917), dans sa Psychologie du point de vue empirique125. Mais c’est avec le philosophe Edmund Husserl (1859-1938) qu’elle acquiert sa véritable portée philosophique. Husserl met pour la première fois en avant sa conception de l’intentionnalité dans ses Recherches logiques.
Le concept d’intentionnalité, pour Edmund Husserl126, signifie que la conscience humaine est toujours la conscience de quelque chose. Dans sa structure essentielle, la conscience est une corrélation entre un acte intentionnel (qu’il désigne par « noèse ») et un objet intentionné (« noème »). Le phénomène (c’est-à-dire la chose, telle qu’elle se donne à la conscience) n’est donc pas « à l’extérieur » de la conscience, de telle sorte que celle-ci en aurait seulement une représentation psychique.
Le phénomène est au contraire constitutif de l’expérience vécue, car le caractère de relation intentionnelle appartient à son essence même. Il n’y a pas deux choses dans la conscience, à savoir, d’une part, le vécu d’un sujet et, d’autre part, son objet, car « c’est une seule chose qui est présente, le vécu intentionnel, dont le caractère descriptif essentiel est précisément l’intention relative à l’objet.
Sujet et objet s’appartiennent dans la relation intentionnelle. Il est, par conséquent, inexact de dire que mon expérience du monde ne me fournit qu’une « représentation » de celui-ci, car j’ai conscience des choses mêmes. « Les phénomènes eux-mêmes ne nous apparaissent pas, ils sont vécus »127.
Et, Edmund Husserl souligne que « les objets intentionnés se constituent comme ce qu’ils sont et valent pour nous »128. En d’autres termes, pour la conscience humaine, le phénomène n’a d’être qu’en son être-perçu. Il ne s’agit jamais de l’être-en-soi, mais toujours de l’être tel qu’il se présente à nous.
- Perception, comme élément de conduite
La perception nous pousse à agir ; elle est organisée en un ensemble cohérent par notre cerveau et donc également par l’expérience que nous acquérons au cours de la vie. Elle dépend de notre histoire affective, sociale et culturelle de nos capacités cognitives. Elle permet au sujet de comprendre les informations provenant de l’environnement social où il évolue. Elle se constitue autour de trois niveaux :
- l’information : on va chercher les informations, la cohérence des informations ;
- la représentation : elle constitue une tentative d’interprétation et de maîtrise de notre environnement social. Elle a toujours un impact sur les conduites individuelles et elles conditionnent la nature de nos réactions. Les valeurs morales et culturelles orientent cette construction, représentation sociale ;
- l’attitude : orientation générale sur un sujet qui est positif ou négatif.
Émile Durkheim129 introduit en 1898 l’idée de représentation collective et fixe à la psychologie sociale la tâche d’étudier les représentations sociales. Michel Foucault130, dans une perspective épistémologique et d’archéologie du savoir, introduit, quant à lui, le concept d’épistémè : il s’agit d’une conception du monde qui rassemble différents paradigmes ou représentations mentales individuelles, relatives à la pratique du monde, l’histoire, la cosmologie, … L’auteur pense que nous entrons dans une ère nouvelle qu’il appelle hypermodernité.
De son côté Denise Jodelet131 affirme que le concept de représentation sociale désigne une forme de connaissance spécifique, le savoir de sens commun, dont les contenus manifestent l’opération de processus génératifs et fonctionnels socialement marqués. Plus largement, il désigne une forme de pensée sociale. Les représentations sociales sont des modalités de pensée pratique orientées vers la communication, la compréhension et la maîtrise de l’environnement social, matériel et idéal.
En tant que telles, elles présentent des caractères spécifiques au plan de l’organisation des contenus, des opérations mentales et de la logique. Le marquage social des contenus ou des processus de représentation est à référer aux conditions et aux contextes dans lesquels émergent les représentations, aux communications par lesquelles elles circulent, aux fonctions qu’elles servent dans l’interaction avec le monde et les autres.
Pour Gustave-Nicolas Fischer132, la représentation sociale est un processus, un statut cognitif, permettant d’appréhender les aspects de la vie ordinaire par un recadrage de nos propres conduites à l’intérieur des interactions sociales.
129DURKHEIM, E., « Représentations individuelles et représentations collectives », in Revue de métaphysique et de morale, 1898, Vol. 6, pp. 273-302
130FOUCAULT, M., Les Mots et les Choses : Une archéologie des sciences humaines, Paris, Gallimard, 1966, pp. 1-400.
131JODELET, D., « Représentations sociales : Phénomènes, concepts et théorie », in MOSCOVICI, S.,
Psychologie sociale, Paris, PUF, 1984, pp. 357-378.
132FISCHER, G.-N., Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 1987, p. 118.
Dans son vaste champ de recherche articulé autour des représentations sociales repris dans « le domaine de la psychologie sociale »133, Serge Moscovici démontre le rôle des représentations sociales dans l’institution d’une réalité consensuelle, leur fonction sociocognitive dans l’intégration de la nouveauté, l’orientation des communications et des conduites. Il montre également que les représentations sociales peuvent être étudiées globalement comme des contenus dont les dimensions (informations, valeurs, opinions…) sont coordonnées par un principe organisateur (attitude, normes…) ou de manière focalisée comme structures de savoir organisant l’ensemble des significations relatives à l’objet concerné.
Cette deuxième approche de Serge Moscovici, structure des représentations sociales, est en parallèle avec le concept d’organisateur central élaboré par Solomon Asch134 en 1954 lors de ses recherches sur la formation des impressions et Jean-Claude Abric135 dans sa recherche sur l’existence d’un noyau central, élément stable et partagé, et d’éléments périphériques susceptibles de variations. Dans l’expérience qui lui permit d’avancer cette théorie, Jean-Claude Abric mit à jour en exemple, les éléments nucléaires de la représentation sociale de l’Artisan autour de cinq éléments que sont : « travailleur manuel », « amour du métier », « travail personnalisé », « travail de qualité » et « apprenti », lesquels sont dits non négociables du fait qu’ils constituent les éléments indispensables qu’un objet social doit comporter pour appartenir à cette représentation.
C’est dans cette même optique que Claudine Herzlich136 apporte sa contribution en soulignant que le fait de travailler sur une représentation, consiste à observer comment un ensemble de valeurs, de normes sociales et de modèles culturels est pensé et vécu par les individus d’une société ainsi qu’à étudier comment s’élabore, se structure logiquement et psychologiquement l’image des objets sociaux.
Tout compte fait, la représentation sociale peut être comprise comme une forme des connaissances socialement élaborées et partagées ayant une visée pratique et concurrente à la construction d’une réalité. Ainsi donc, vouloir mener une étude dans ce domaine, c’est étudier les personnes d’une société et leur expression de vie sociale dans toutes ses dimensions.
Il faut savoir que les représentations sociales constituent un processus permettant aux personnes de reconstruire la réalité. La personne humaine confrontée au quotidien par une multiplicité d’informations essaie de les transformer, de les intégrer et de se les réapproprier de telle sorte qu’elles puissent entrer en communication et agir dans la société.
Le point essentiel des représentations sociales consiste à rendre concret son exercice mental, c’est-à-dire à donner des formes palpables aux notions par expérience de la vie concrète. Telle, par exemple, la notion d’égalité entre homme et femme. Egalement, l’appartenance à un groupe social est-elle déterminante dans la mesure où, que l’on soit instruit ou pas, homme ou femme, travailleur ou pas, on adopte un savoir commun ou une attitude commune.
________________________
123 Janet, P., Les mécanismes de l’esprit, Paris, Alcan, 1903.
124 Janet, P., Les mécanismes de l’esprit, Paris, Alcan, 1903.
125 BRENTANO, F., Psychologie d’un point de vue empirique, Paris, Vrin, 2008, pp. 1-144.
126 HUSSERL, E., Recherches logiques, tome 2, volume 2 : Recherches pour la phénoménologie et la théorie de la connaissance, Paris, PUF, 1962, pp. 174-175.
127 Ibid, p. 149.
128 HUSSERL, E., Recherches logiques, tome 2, volume 1 : Recherches pour la phénoménologie et la théorie de la connaissance, Paris, PUF, 1961, p. 193.
129 DURKHEIM, E., « Représentations individuelles et représentations collectives », in Revue de métaphysique et de morale, 1898, Vol. 6, pp. 273-302.
130 FOUCAULT, M., Les Mots et les Choses : Une archéologie des sciences humaines, Paris, Gallimard, 1966, pp. 1-400.
131 JODELET, D., « Représentations sociales : Phénomènes, concepts et théorie », in MOSCOVICI, S., Psychologie sociale, Paris, PUF, 1984, pp. 357-378.
132 FISCHER, G.-N., Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 1987, p. 118.
133 MOSCOVICI, S., « Le domaine de la psychologie sociale : Introduction », in MOSCOVICI, S. (Ed), La psychologie sociale, Paris, PUF, 1984, pp. 5-22.
134 SOLOMON-ASH, Effects of group pressure on the modification and distortion of judgments, in GUETZKOW, H., Groups, leadership and men, Pittsburgh, Carnegie, 1954, pp177-190.
135 ABRIC, J.-C., « L’artisan et l’artisanat : Analyse du contenu et de la structure d’une représentation sociale », in Bulletin de psychologie, Vol. 27, n°366, 1984, pp. 861-876.
136 HERZLICH, C., Analyse d’une représentation sociale, Paris, Morton, 1969, p. 52.
des formes palpables aux notions par expérience de la vie concrète. Telle, par exemple, la notion d’égalité entre homme et femme. Egalement, l’appartenance à un groupe social est-elle déterminante dans la mesure où, que l’on soit instruit ou pas, homme ou femme, travailleur ou pas, on adopte un savoir commun ou une attitude commune.
Questions Fréquemment Posées
Qu’est-ce que la conduite en psychologie?
La conduite est un ensemble d’actes organisés qui ont un sens et qui poursuivent une finalité, impliquant une attitude psychologique consciente ou inconsciente.
Quel est le rôle de l’intentionnalité dans la conduite?
L’intentionnalité permet à l’individu d’agir et de justifier ses actes, avec une valeur positive ou négative en fonction de l’intensité de la motivation.
Comment la signification d’une situation influence-t-elle la conduite?
La signification que l’on donne à une situation dépend de notre environnement culturel et social ainsi que de notre histoire personnelle, conditionnant ainsi notre manière d’être et de réagir.