Les mécanismes de défense en communication révèlent des réactions psychologiques fascinantes face à l’interculturel. En explorant ces dynamiques au Congo, cette étude offre des perspectives inédites sur la gestion du stress relationnel, essentielle pour comprendre les interactions humaines dans un contexte diversifié.
Section 3 :
Mécanismes de défense socioculturelle
La communication interculturelle nous impose une rencontre avec autrui, or psychologiquement la présence d’autrui est toujours source de tension et de stress, menace contre l’intégrité psychique ou physique. En effet, de nombreuses recherches en psychologie sociale ont montré que ce contact entraînait certaines réactions spécifiques assez constantes chez les interlocuteurs, appelées mécanismes de défense par Sigmund Freud, dont les travaux ont été repris et perpétués par sa disciple Anna Freud271, ou mécanismes socio cognitifs face à l’altérité par Willem Doise272. Ici le terme mécanisme ne signifie rien d’autre que les réactions produites par les individus pour se défendre.
271 FREUD, A., Le Moi et les mécanismes de défense, Paris, PUF, 2001, pp. 1-162.
272 DOISE W., Expériences entre groupes, Paris, Mouton, 1979, pp. 1-326.
- Notions des mécanismes de défense
Notre résilience, notre capacité à faire face aux tensions, aux conflits, aux dangers perçus à l’intérieur de nous ou dans le monde extérieur mobilise deux types d’opérations mentales : les mécanismes de défense et les processus de coping.
Henri Chabrol273 définit les mécanismes de défense comme des processus mentaux automatiques, qui s’activent en dehors du contrôle de la volonté et dont l’action demeure inconsciente, le sujet pouvant au mieux percevoir le résultat de leurs interventions et s’en étonner éventuellement. Tandis que les processus de coping, mot traduit en français par stratégies d’adaptation ou processus de maîtrise, sont des opérations mentales volontaires par lesquelles le sujet choisit délibérément une réponse à un problème interne et/ou externe.
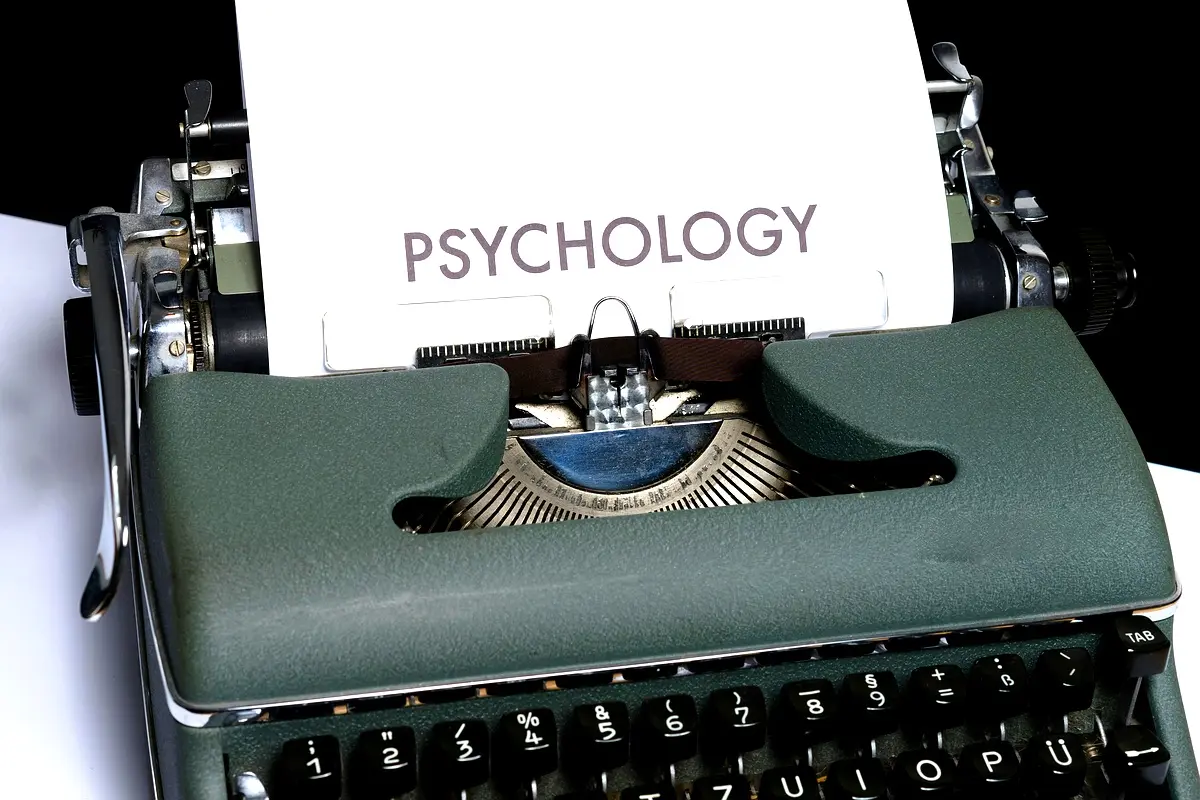
Les mécanismes de défense ont été d’abord décrits par Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, vers 1874. Ce grand psychiatre allemand fut en effet le premier à identifier ces moyens que nous développons pour nous prémunir contre la souffrance. En ce temps, les mécanismes de défense étaient utilisés uniquement dans la psychanalyse afin de décrire et d’expliquer certains comportements anormaux des grands malades (psychoses) qui en souffraient.
Les mécanismes de défense sont des « processus de défense élaborés par le Moi sous la pression du Surmoi et de la réalité extérieure qui permettent de lutter contre l’angoisse »274. Ainsi, l’esprit humain dans sa fécondité élabore ces moyens qui lui permettent de continuer à fonctionner malgré les difficultés et les embûches de la vie en société.
Les manifestations de ces mécanismes de défense accompagnent les vies. Ils sont créés par les conflits qui émaillent les relations sociales ou familiales, par les difficultés existentielles liées à l’évolution humaine vers la maturité, par les adversités relatives au travail ou aux études. Les inquiétudes intérieures, le sentiment d’inadéquation personnelle, le manque de confiance en soi-même ou dans les autres, le sentiment de culpabilité face à son agir comptent parmi les principaux révélateurs des mécanismes de défense.
Margot Phaneuf275 affirme que certains mécanismes de défense ont une fonction plutôt adaptative, ils sont alors identifiés comme des mécanismes « matures ». Ils sont utilisés par des personnes bien portantes, dans des situations normales, alors que d’autres, à vocation plus strictement défensive, sont qualifiés « d’immatures » et sont caractéristiques de niveaux plus élevés de détresse. En revanche, d’autres sont efficaces à contrôler l’anxiété et à préserver la
273 CHABROL, H., « Les mécanismes de défense », in Recherche en soins infirmiers, n°82, 2009, p. 32.
274 GIFFARD, D. (dir.), « Mécanismes de défense », document téléchargé le 04 décembre 2012, URL : http://psychiatriinfirmiere.free.fr
275 PHANEUF, M, op.cit, p. 4.
personne de la souffrance et du mal-être, mais d’autres demeurent insuffisants et doivent alors être utilisés de manière répétitive et même compulsive. Ils deviennent alors nuisibles. Lorsqu’ils aident la personne à s’adapter à des situations difficiles, à tolérer un contexte pénible, ils sont bénéfiques. Mais lorsqu’ils obnubilent le champ de la conscience, coupent la personne de la réalité, nuisent à son fonctionnement et à ses relations humaines, ils sont alors pernicieux.
Quant au nombre de mécanismes de défense existants, il n’existe pas de consensus sur le nombre de mécanismes de défense qui est très variable selon les auteurs. L’affirmation de Roy Schafer276 est toujours actuelle : « Il ne peut y avoir de listes « exactes » ou « complètes » de mécanismes de défense, mais seulement des listes variant dans leur exhaustivité, dans leur consistance théorique interne et dans leur utilité pour ordonner l’observation clinique et les données de la recherche ».
Etant donné que le champ de la psychologie est particulièrement étendu, il est hors de question d’entrer ici dans le détail de différents mécanismes existants ; notre objectif consiste essentiellement à proposer une liste référentielle des mécanismes les plus connus qui se produisent verbalement ou non verbalement lors des échanges des individus appartenant à des cultures différentes. De ce fait, il est question de passer en revue les mécanismes psychiques de base, les mécanismes de défense de situations duelles des rôles sociaux couramment appelés
« mécanismes situationnels », les « mécanismes discriminatoires » et les mécanismes liés à l’ethnicité couramment appelés « mécanismes ethniques ».
- Mécanismes psychiques de base
Les mécanismes psychologiques ont particulièrement été mis en évidence par l’approche freudienne, notamment dans l’étude de l’inconscient277. Ils visent au maintien de l’équilibre interne de l’individu ou du groupe. Si un élément de la situation menace de bouleverser cet équilibre interne (portant sur les croyances, les attitudes, les opinions), des mécanismes apparaissent pour tenter de restaurer le système antérieur d’opinions ou d’attitudes. Les mécanismes psychiques de base peuvent prendre différentes formes, notamment la projection (par assimilation et attribution causale), le déplacement, l’interprétation subjective (rationalisation), la perception et la mémoire sélectives et la formation réactionnelle.
Les mécanismes projectifs visent à attribuer à autrui des pensées ou des sentiments qui sont en fait éprouvés par le sujet lui-même. Pour Estelle M. Morin278, la projection désigne le processus par lequel un sujet situe dans le monde extérieur des pensées, des affects, des conceptions, des désirs, etc., qui lui appartiennent effectivement, mais dont il croit à l’existence extérieure, objective, comme un aspect du monde. Dans un sens plus étroit, c’est aussi l’opération par laquelle le sujet rejette une pulsion qu’il ne peut accepter pour lui-même et la localise dans une autre personne, ce qui lui permet de la méconnaître pour lui-même. Ils peuvent prendre deux formes principales : l’assimilation de la pensée d’autrui à la sienne et l’attribution à l’autre des opinions.
- l’assimilation de la pensée d’autrui à la sienne, par exemple prêter à l’autre ses propres sentiments, comme s’ils étaient semblables aux siens. Il s’agit d’un des principaux obstacles à la communication, reposant sur l’illusion d’une coïncidence entre l’autre et moi ;
- l’attribution à l’autre des opinions ou des sentiments susceptibles de justifier ses propres opinions ou sentiments à son égard, ce que d’autres auteurs appellent projection. Par exemple, être hostile à quelqu’un et lui attribuer des actions, des comportements qui prouvent cette hostilité envers moi. Ce mécanisme constitue un système d’interprétation des comportements d’autrui, permettant à l’individu de conforter son propre cadre de référence.
Le déplacement consiste à modifier les données de la situation réelle en attribuant à un autre objet les motifs du déséquilibre. Il correspond également à ceci « l’affect associé à une représentation mentale dangereuse se détache de celle-ci pour s’investir sur une autre représentation moins dangereuse afin de se défouler »279.
Aussi bien, c’est « le mécanisme par lequel un contenu psychologique, une pensée ou une émotion se détache de son objet pour s’investir sur des objets substitutifs moins pénibles pour le sujet. Ce déplacement peut se faire dans le temps, par exemple un être qui présente une absence totale d’émotion à la mort d’un proche et qui va avoir une crise de larme à un autre moment, dans l’espace (déplacement d’un objet ou une situation : phobie), sur le corps (symptôme de conversion somatique, fréquent chez les sujets à structure hystérique), sur des contenus psychiques (névroses obsessionnelles), dans le rêve où une énergie symbolique est mise à la place d’une difficulté psychique »280.
L’interprétation défensive consiste à transformer les éléments perçus pour les remettre en conformité avec le système de référence de l’individu, autrement dit elle consiste à « donner à une information une signification différente de son sens réel, mais qui est conforme à ce que l’on voudrait qu’elle soit »281, par exemple la rationalisation. La rationalisation désigne « le procédé par lequel le sujet cherche à donner une explication cohérente, logique, acceptable,
279 GIFFARD, D., op.cit, p. 1.
280 SAMYN, I., « La résolution des conflits et les mécanismes de défense », document téléchargé le 04 décembre 2012, URL : http://isabellesamyn.e-monsite.com/pages/psychanalyse/la-resolution-des-conflits-et-les-mecanismes-de-defense.html.
281 GRONIER, G., “Communication”, p. 1, document téléchargé le 04 décembre 2012, URL : http://www.guillaumegronier.com/cv…/Communication_Gronier.pdf.
morale à une attitude, un sentiment dont il ne perçoit pas les véritables motifs. Cela permet d’expliquer un fonctionnement ou un comportement autrement qu’en recourant à l’affectif, autorisant ainsi une satisfaction pulsionnelle culpabilisante. Le Surmoi cherche des appuis moraux, politiques ou religieux pour renforcer les défenses du Moi. On parle aussi d’intellectualisation, dont le but est de maîtriser en mettant à distance les affects. C’est jouer avec les mots et les idées pour mettre de côté les pulsions »282.
La perception et la mémoire sélectives consistent à ne retenir que les éléments qui sont en conformité avec le système de référence de l’individu considéré. C’est « la tendance à déformer les idées contraires aux nôtres pour les mettre en accord avec notre point de vue et tendance à n’en retenir que ce qui s’harmonise avec nos propres idées et les valeurs propres au groupe (respect des valeurs collectives) »283.
Charles Langelet284 identifie dans ce mécanisme deux dimensions : la vigilance perceptuelle et la défense perceptuelle. La vigilance perceptuelle, c’est le processus par lequel on évite l’information inutile et on choisit l’information pertinente pour ses besoins. Tandis que la défense perceptuelle désigne le processus par lequel on choisit l’information compatible avec ses besoins et ses prédispositions et on rejette l’information contraire.
Ici, on se protège contre l’information ambiguë et conflictuelle, car elle crée de la dissonance cognitive.
Et, la formation réactionnelle, c’est un « mécanisme utilisé par la personne qui manifeste extérieurement une manière d’être opposée à ce qu’elle est ou ressent. Par exemple, la personne qui se dévalorise facilement et manque de confiance en elle-même peut, par formation réactionnelle, manifester une superbe assurance et même se vanter de certaines qualités »285. Et pour Giffard286, la formation réactionnelle est une attitude qui s’oppose à un désir refoulé et qui se constitue en réaction contre celui-ci. C’est donc d’abord un refoulement, puis un contre-investissement dans un élément conscient de force égale.
________________________
271 FREUD, A., Le Moi et les mécanismes de défense, Paris, PUF, 2001, pp. 1-162. ↑
272 DOISE W., Expériences entre groupes, Paris, Mouton, 1979, pp. 1-326. ↑
273 CHABROL, H., « Les mécanismes de défense », in Recherche en soins infirmiers, n°82, 2009, p. 32. ↑
274 GIFFARD, D. (dir.), « Mécanismes de défense », document téléchargé le 04 décembre 2012, URL : http://psychiatriinfirmiere.free.fr ↑
275 PHANEUF, M, op.cit, p. 4. ↑
276 SCHAFER, R., op.cit, p. 161. ↑
277 FREUD, S. cité par FREUD, A., op.cit, pp. 1-162. ↑
278 MORIN, E.M., Psychologies au travail, Montréal, Gaëtan Morin, 1996, pp. 252-256. ↑
279 GIFFARD, D., op.cit, p. 1. ↑
280 SAMYN, I., « La résolution des conflits et les mécanismes de défense », document téléchargé le 04 décembre 2012, URL : http://isabellesamyn.e-monsite.com/pages/psychanalyse/la-resolution-des-conflits-et-les-mecanismes-de-defense.html. ↑
281 GRONIER, G., “Communication”, p. 1, document téléchargé le 04 décembre 2012, URL : http://www.guillaumegronier.com/cv…/Communication_Gronier.pdf. ↑
282 GIFFARD, D., op.cit, p. 1. ↑
283 GIFFARD, D., op.cit, p. 1. ↑
284 LANGELET, C., op.cit, p. 1. ↑
285 GIFFARD, D., op.cit, p. 1. ↑
286 GIFFARD, D., op.cit, p. 1. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quels sont les mécanismes de défense en communication interculturelle?
Les mécanismes de défense sont des réactions produites par les individus pour se défendre face à la présence d’autrui, souvent source de tension et de stress.
Comment les mécanismes de défense influencent-ils la communication au Congo?
Les mécanismes de défense influencent la communication au Congo en permettant aux individus de lutter contre l’angoisse et de continuer à fonctionner malgré les difficultés sociales.
Quelle est la différence entre mécanismes de défense et processus de coping?
Les mécanismes de défense sont des processus mentaux automatiques et inconscients, tandis que les processus de coping sont des opérations mentales volontaires par lesquelles le sujet choisit délibérément une réponse à un problème.