L’innovation technologique en communication transforme radicalement les échanges interculturels, révélant des mécanismes de défense insoupçonnés. Cette recherche met en lumière des approches psychologiques novatrices, essentielles pour comprendre les dynamiques sociales au Congo et leurs implications sur la communication interculturelle.
Chapitre II : FACTEURS EXPLICATIFS DE LA COMMUNICATION INTERCULTURELLE ET MECANISMES DE DEFENSE
La compréhension et la maîtrise de la communication interculturelle au sens d’une pratique sociale spécifique ou au sens d’une dimension spécifique inhérente à toutes les pratiques de communication humaine présupposent la prise en compte et l’explication du concept d’acteur social engagé dans les échanges interpersonnels, des facteurs intervenant lors de ces échanges, ainsi que des mécanismes de défense produits par ces acteurs.
Signalons tout de même que le concept « d’acteur social » constitue la variable intermédiaire de notre étude.
Section 1 :
Acteur social (sujet communicant)
Le recours au concept d’acteur social est une façon commode de désigner les participants à un processus d’action, notamment en communication. Mais sa conception et son utilisation a varié selon les domaines et les pratiques.
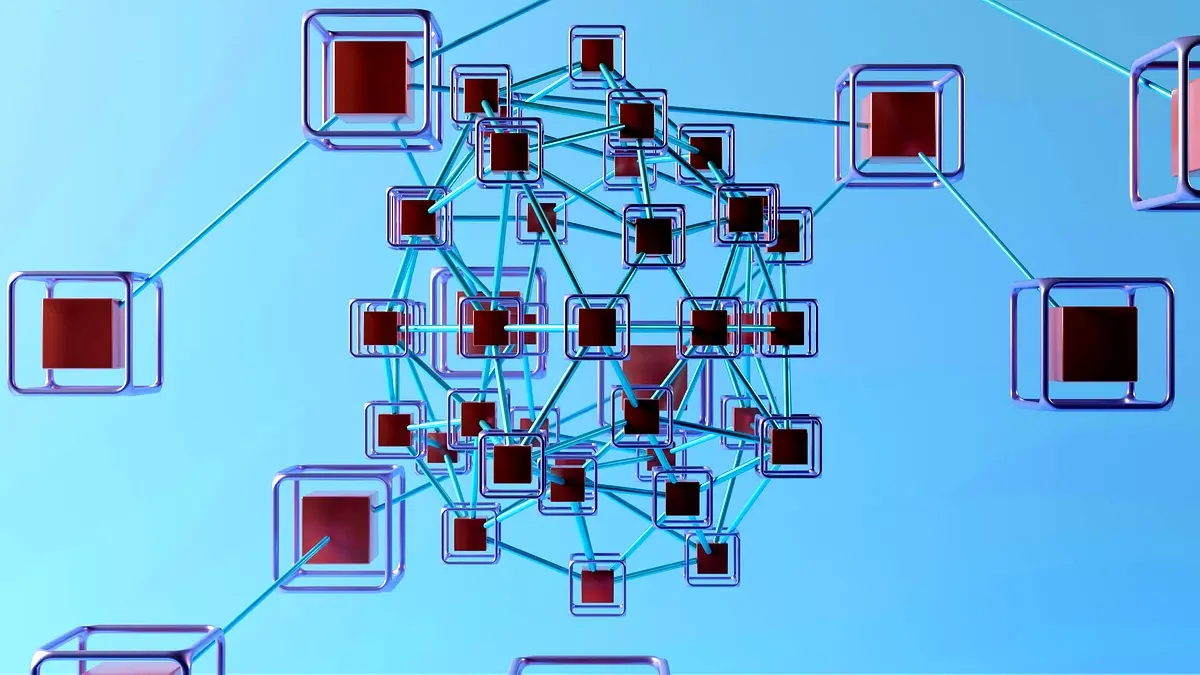
Pour Gilles Sénécal204, l’archéologie du concept nous fait remonter aux travaux de la sociologie fonctionnaliste et des organisations. Du point de vue fonctionnaliste, on distingue plusieurs figures de l’acteur social : théâtral, stratégique ou réseau, l’acteur représentant des organismes de la société civile, des institutions politiques ou des groupes plus ou moins formels de revendication.
Il peut même n’être qu’un individu décidé à faire connaître son point de vue et à agir. Ainsi, ces acteurs de toute nature accaparent des fonctions et des rôles sociaux en bénéficiant d’une capacité d’action tout en étant soumis à des contraintes lorsqu’ils déploient des modes d’action et d’organisation particuliers.
Du point de vue organisationnel, surtout avec les courants récents des théories de planification, la notion d’acteur social se confond à celles d’agent, d’intervenant, de représentant, de porte-parole et même de participant à un mouvement social. Elle désigne, en fait, à ceux et celles qui cherchent à construire et à orienter une situation, laquelle peut être circonscrite à différentes échelles, comme celle de la société entière (pour aborder le changement social) celle de la métropole, celle de la communauté locale, voire celle des réseaux sociaux de quartier.
En fait, la situation peut être territorialisée et engagée, par exemple, dans la défense d’un quartier ou d’un lieu particulier, notamment pour défendre l’accessibilité à un espace public ou à une institution localisée. Il arrive qu’elle ne se réfère à aucun espace en particulier, du moins directement, comme la lutte pour l’égalité sociale ou la lutte des femmes.
Selon le courant de la sociologie interactionniste205, tout phénomène peut-être appréhendé comme le résultat d’actions, de croyance, et de comportements individuels ; ainsi l’acteur n’est pas toujours contraint aux normes et règles, il est aussi doué d’intentionnalité, libre et rationnel. Pour atteindre ses fins, l’acteur met donc en place des stratégies.
Face au contrôle social et à ses contraintes, une zone d’incertitude existe, marge permettant à l’acteur de construire sa vie. Cette capacité de l’acteur est limitée par l’organisation des ressources disponibles, des contraintes, etc.
Cette zone d’incertitude est fonction de la place que l’individu occupe au sein de la société et de l’individu lui-même. Cette capacité dépend aussi des potentialités du contexte des moyens de communication, des réseaux de solidarité, du respect des règlements en vigueur.
A cet effet, tout acteur possède une marge de pouvoir qui repose sur l’existence des stratégies personnelles, créant ainsi de l’imprévisible. Le pouvoir de l’acteur dépend des fonctions proportionnelles de la zone d’incertitude qu’il contrôle. Les règles visent à maîtriser ses imprévisibilités.
D’après le courant de la sémiotique de la culture représenté par Peter Stockinger206, le concept d’acteur est défini comme un agent qui possède un système cognitif et axiologique (de valeurs) de référence commune. Un tel système est composé, entre autres, par des traditions et expériences communes, des valeurs partagées et considérées comme plus ou moins fondamentales, une doxe (des évidences), mais aussi des connaissances formalisées et fonctionnelles (des techniques, des méthodes, …), un imaginaire (des possibilia) et un espace critique, des références à une transcendance, etc.
Loin d’être réduit à l’identité de toute personne, membre d’une troupe théâtrale, le concept « acteur » désigne plutôt dans notre contexte un individu qui (ré) agit en situation de communication face aux « autres culturels »207. Dans modèle orchestral proposés par des scientifiques comme Théodore M. Newcomb208, George Gerbner209, Matilda et John Riley210, l’acteur est représenté par des personnes impliquées dans le processus de communication, comme l’Emetteur et le Récepteur.
L’acteur est donc plus proche d’action que de jeu théâtral. A ce sujet, William Shakespeare211 le souligne dans sa comédie romantique « As You Like it » traduit en français « Comme il vous plaira ». Le monde entier est donc un théâtre où tous, hommes et femmes, ne sont que des acteurs.
Chacun y joue successivement les différents rôles.
A cet effet, Frederick Wacheux212 a dénombré trois rôles des acteurs sociaux :
- les acteurs produisent et reproduisent les faits sociaux dans une construction du temps et de l’espace qu’ils maîtrisent plus ou moins et qu’ils conscientisent imparfaitement ;
- la rationalité limitée et les théories implicites des acteurs entrent, de fait, dans l’analyse à partir de ce qui est considéré comme important pour eux ;
- les acteurs ont naturellement une connaissance immédiate de leur signification (savants ordinaires) et qu’ils ne comprennent pas souvent l’intérêt d’être engagé dans une démarche de recherche (primat de la praxis).
________________________
205 ABS, « Facteurs et acteurs du changement social. Quelques courants de la sociologie, la question du changement social », document téléchargé le 01 avril 2013, URL : http://ww.abs.com ↑
206 STONCKINGER, P., Sémiotique de la culture et communication interculturelle, Séminaire de DREA-OIPP, Paris, ESCoM, 2006, p. 23. ↑
207 Expression « autres culturels » signifie des personnes venants d’un autre milieu culturel que soi. ↑
208 NEWCOMB, T.M., op.cit, pp. 393-404. ↑
209 FISKE, J. (edit.), op.cit, pp. 24-28. ↑
210 RILEY, M. and RILEY, J., op.cit, pp. 537-578. ↑
211 SHAKESPEARE, W., As You Like it, Comédie romantique, Londres, 1923, 4ième paragraphe. ↑
Questions Fréquemment Posées
Qu’est-ce qu’un acteur social dans la communication interculturelle?
Le concept d’acteur social désigne les participants à un processus d’action, notamment en communication, et peut inclure des individus, des groupes ou des institutions engagés dans des échanges interpersonnels.
Comment les mécanismes de défense influencent-ils la communication interculturelle?
Les mécanismes de défense sont produits par les acteurs sociaux lors des échanges, influençant ainsi la compréhension et la maîtrise de la communication interculturelle.
Quelle est l’importance de la zone d’incertitude pour l’acteur social?
La zone d’incertitude permet à l’acteur de construire sa vie malgré les contraintes sociales, et sa capacité dépend de sa place dans la société et des ressources disponibles.