Les incertitudes juridiques des investissements sont souvent sous-estimées dans le contexte des États parties à l’OHADA. Cet article révèle comment l’imprécision des actes uniformes peut compromettre l’attractivité des investissements directs étrangers, soulevant des enjeux cruciaux pour la croissance économique de la région.
CHAPITRE II : L’IMPRECISION DES ACTES UNIFORMES, SOURCE D’INSECURITE JURIDIQUE DES IDE
Les Actes uniformes sont la forme juridique imaginée par le Traité, pour établir des « règles communes, simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies respectives [l’économie des Etats parties]… »[47]. Un ensemble normatif est susceptible de contribuer à la sécurité juridique, s’il est à la fois complet, précis et cohérent.
Même si l’OHADA met incontestablement en place des dispositifs pour attirer l’investissement étranger, elle peut cependant être cause de bien des incertitudes pour l’investisseur en raison des maladresses ou de l’inadéquation de certains Actes uniformes.
Nous nous attarderons sur deux actes uniformes. Il s’agit de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général (AUDCG) et de l’Acte uniforme relatif au droit des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécutions (AUPSRVE). En effet ces deux textes ont trait à l’implantation de l’investisseur dans le pays hôte et à l’exploitation de l’activité.
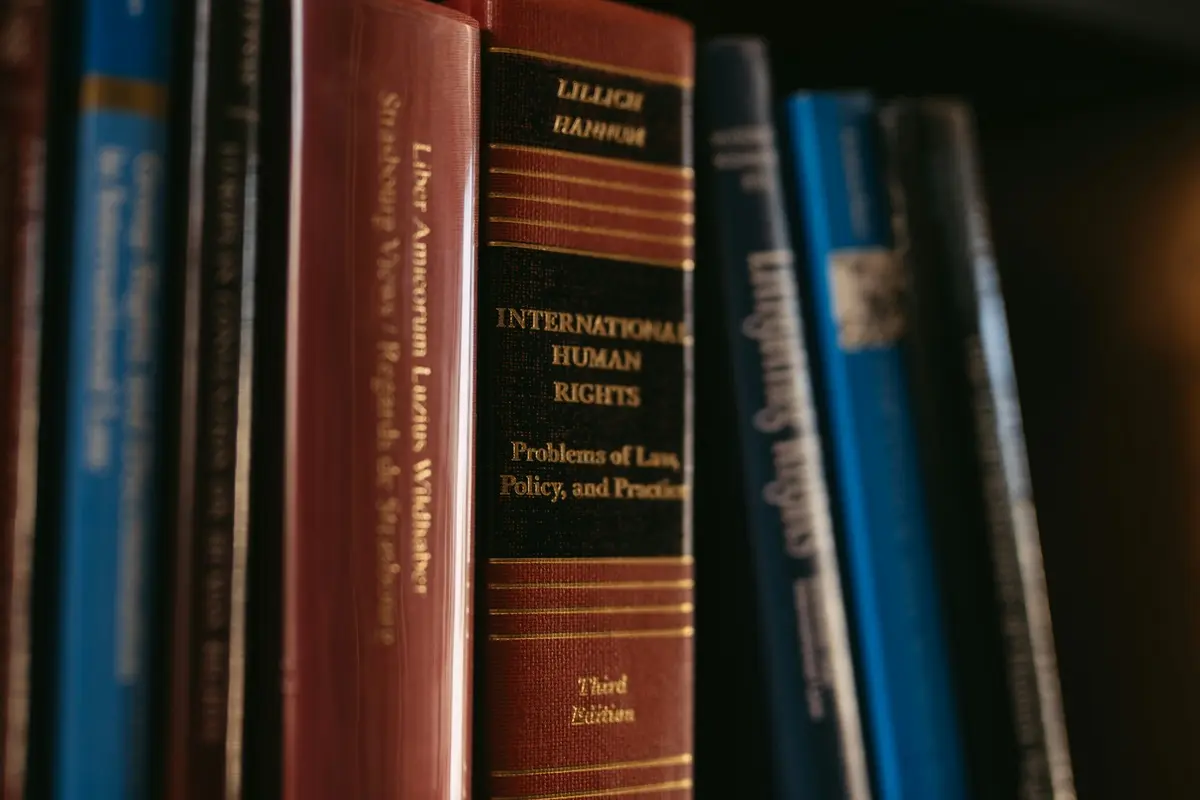
Section I :
L’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général (AUDCG)
Plus de deux décennies après l’adoption du Traité OHADA par les Etats africains de la zone franc, et l’entrée en vigueur des premiers Actes uniformes, la doctrine et la pratique de cette organisation font état d’un bilan mitigé. Sans vouloir aborder l’ensemble des lacunes de l’AUDCG, la présente section s’attarde notamment sur certaines de ses dispositions qui ont fait l’objet de débats et controverses comme celles relatives au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM).
Paragraphe I : Le principe d’immatriculation au RCCM
En octobre 1993, lors de l’adoption du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires, le constat général et unanime était que le Registre du commerce était devenu obsolète du fait qu’il ne jouait plus son rôle dans la sécurisation des affaires. L’Acte uniforme relatif au Droit Commercial Général adopté le 17 avril 1997 a institué le RCCM, officialisant ainsi dans son titre la double fonction d’immatriculation des commerçants et d’inscription de certaines sûretés mobilières ainsi que du crédit-bail pour toutes les personnes immatriculées ou non[48]. Le souci des États parties à l’OHADA étant de créer un espace juridique et économique commun, ils ont voulu faciliter la collecte et la diffusion d’informations par les RCCM de chaque pays.
« Dans le régime de l’OHADA, chaque État doit maintenir à jour un Fichier National consolidé à partir des divers points d’enregistrement sur le territoire de l’État concerné, tout en conservant la compétence exclusive sur son territoire, de procéder aux immatriculations, aux déclarations d’activités et aux inscriptions au RCCM »[49].
Le véritable handicap du RCCM tient au fait qu’il soit, sur l’ensemble de l’espace OHADA, caractérisé par l’inaccessibilité de ses données par les acteurs du secteur privé et public, une gestion lourde encore effectuée sur support papier, des données peu fiables qui ne sont pas mises à jour régulièrement et une méconnaissance générale des opérateurs économiques sur son utilité informationnelle.
« A cause de cet état de chose la distance continue d’être un obstacle pour les investisseurs situés dans d’autres espaces économiques ou entre deux investisseurs situés dans des pays différents mais membres de l’OHADA. L’investisseur désirant souscrire l’émission d’actions ou d’obligations va buter contre l’inaccessibilité de celle-ci alors qu’une mise en marche effective de ces fichiers aurait permis à un investisseurs situé aux Etats-Unis d’Amérique de placer des capitaux par l’achat de titres après avoir obtenu des renseignements fiables sur le site et ayant reçu une copie des documents y afférent »[50].
L’autre problème relatif au RCCM tient au fait que celui-ci soit tenu par le greffe de la juridiction compétente ou l’organe compétent dans l’Etat partie[51]. Il y’a par conséquent autant de RCCM que de ressorts de juridictions commerciales (une dizaine au Niger, quelques deux cents au Cameroun…).
Par ailleurs, l’insuffisance des informations fournies par le RCCM constitue aussi une autre lacune. En effet, les informations fournies par le RCCM se limitent aux renseignements sur la société, son fonctionnement et sa fin de vie. Comment prétendre informer les investisseurs si l’on ne prévoit point la possibilité de publier des informations détaillées liées aux titres auprès d’une bourse de valeur ?
« Il aurait été nécessaire d’envisager une rubrique consacrée aux tires sociaux émis ou à émettre par la société, la précision sur leur montant nominal minimum et autres informations, même si ce montant peut varier au gré de l’offre et de la demande comme dans les systèmes d’économie libérale, ainsi le RCCM constituerait un système d’information complet car en le consultant on saura directement si la société est cotée quelles sont les titres qu’elle vend »[52].
Aussi, « les inscriptions des sûretés réelles mobilières, vecteurs essentiels dans la sécurisation des transactions commerciales et bancaires, sont actuellement peu fiables et non consultables en temps réel. Or, le RCCM se doit d’être la première source d‘information commerciale, économique et juridique de l’espace OHADA. Il devrait être un référentiel permettant de disposer d’information d’ordre statutaire et signalétique et d’obtenir des bilans d’entreprises, des informations sur les dirigeants et activités des entreprises, compris sur leurs engagements financiers à travers les sûretés mobilières, les privilèges, les
crédits-bails, ainsi que toute décision judiciaire les concernant, notamment les décisions de faillites, de dissolutions, ventes, etc. »[53]. Tous, ces dysfonctionnements créent une brèche dans la sécurité juridique. Pour y remédier, il faudrait privilégier l’informatisation du RCCM.
Paragraphe II : L’informatisation du RCCM et la protection des données à caractère personnel
Avec les registres classiques, les personnes physiques déchues de la qualité de commerçant dans une zone donnée de l’espace OHADA, parviennent à s’immatriculer dans une autre localité dudit espace pour y exercer leur activité.
L’informatisation du RCCM, pourrait permettre une interconnexion entre les différents fichiers de telle sorte qu’il sera juste question de saisir les informations personnelles du commerçant dans la base de données pour vérifier l’aptitude de ce dernier à exercer l’activité commerciale.
L’informatisation permettrait aussi d’éviter les risques de détérioration et de perte des informations personnelles des commerçants détenus sur papier, lesquelles informations sont difficilement reconstituables lorsqu’elles sont sur support papier. Toutefois, il convient de noter que la dématérialisation des informations personnelles des individus par l’informatisation du RCCM appelle à l’observation de certaines règles notamment celle relative à la protection des données à caractère personnelles[54]. Mais quel est le lien entre l’informatisation du RCCM et la protection des données à caractère personnels ?
Le RCCM contient toutes les informations sur le commerçant personne physique, lesquelles informations sont des données à caractère personnel. Alors, comment informatiser efficacement le RCCM afin de protéger au mieux les informations de ces commerçants ?
A notre avis, le processus d’informatisation du RCCM ne pourrait connaitre un véritable succès que par l’adoption par tous les Etats d’une législation spécifique sur la protection des données personnelles. Néanmoins, en dépit d’une adoption par les Etats partie de l’OHADA d’une disposition spécifique relative à la protection des données, il serait souhaitable pour le législateur OHADA d’adopter un Acte Uniforme sur les Technologies de l’Information et de la Communication qui inclurait non seulement un dispositif légal sur les données personnelles mais aussi, des règles relatives à la cybercriminalité car prévenant toutes attaques du système d’information du RCCM.
Le principe d’immatriculation au RCCM n’est pas le seul point d’achoppement que l’on peut citer. En effet, le principe d’immunité des personnes morales de droit public ainsi que l’exécution provisoire, encadrés par l’AUPSRVE, sont aussi des lacunes du droit communautaire.
Section II :
L’Acte uniforme relatif au droit des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécutions (AUPSRVE)
A défaut d’exécution volontaire ou dans l’hypothèse d’échec de la procédure simplifiée de recouvrement de créance, le créancier dispose de moyens de contrainte légaux pour se faire payer. Il s’agit des voies d’exécution. En effet, le législateur OHADA a créé un Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution qui a constitué une profonde réforme de la procédure civile en matière de recouvrement et des voies d’exécution influant ainsi sur les procédures judiciaires dans l’ensemble des Etats membres.
Cet Acte uniforme présente une particularité par rapport aux autres Actes puisqu’il abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les Etats Parties ; Et ce, à la différence des autres Actes uniformes qui, dans leurs dispositions finales, se bornent à abroger les dispositions contraires applicables dans les Etats Parties. Ainsi, en abrogeant toutes les dispositions internes, qu’elles soient ou non contraires, les rédacteurs de cet Acte uniforme ont voulu un ensemble cohérent renfermant toutes les règles ayant vocation à s’appliquer aux matières qu’il concerne, à savoir les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution.
Le droit OHADA reconnaît à travers l’AUPSRVE un droit à l’exécution forcée au profit du créancier, contrebalancé par la reconnaissance d’un principe général de protection du débiteur s’accompagnant de la préservation des droits des tiers. Cependant, plusieurs difficultés d’application peuvent constituer une entrave au bon déroulement de la procédure de recouvrement des créances. Alors quelles sont les principales lacunes que nous pouvons relever dans ces dispositions relatives aux voies d’exécution ?
Paragraphe I : Le principe d’immunité des personnes morales de droit public
L’immunité d’exécution est à distinguer de l’immunité de juridiction. Tandis que la première intervient en aval de la décision de justice, la seconde intervient en amont et empêche la personne qui en bénéfice d’être jugé. L’immunité d’exécution porte sur la personne destinataire de la mesure d’exécution forcée. Autrement dit, l’immunité d’exécution[58] est le privilège personnel reconnu à un débiteur, notamment l’Etat et ses démembrements, qui le soustrait à toute mesure d’exécution forcée.
Cette dernière est l’exception à la faculté de contrainte que le créancier a sur son débiteur défaillant. L’immunité d’exécution est un sérieux obstacle au recouvrement des créances dans l’espace OHADA. En effet, elle permet à une catégorie de personnes d’échapper aux mesures d’exécution forcée. Cependant, le législateur OHADA ne s’est pas prononcé de façon explicite quant à l’identification précise des bénéficiaires légaux de l’immunité d’exécution.
Celui-ci semble renvoyer à la loi nationale pour fixer la liste des personnes concernées par cette immunité. Par exemple, au Sénégal, l’article 194 al.1 du Code des Obligations Civiles et Commerciales (COCC), prévoit qu’il n’y a pas d’exécution forcée ni de mesures conservatoires contre l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics.
Beaucoup de décisions se réfèrent d’ailleurs expressément à ces lois internes. Ainsi, au Cameroun, une juridiction a fait application de la loi camerounaise n° 99/016 du 22 déc. 1999 portant Statut général des Etablissements publics[59]. De même, en Côte d’Ivoire, il a été fait référence à la loi nationale, la loi n° 08-338 du 02 juillet 1998[60].
Or, la CCJA semble avoir une autre lecture de cet article 30. Selon elle, en énonçant dans son alinéa 1er, le principe selon lequel il ne peut y avoir d’exécution forcée, ni de mesures conservatoires contre les personnes qui bénéficient de l’immunité d’exécution et en envisageant dans son alinéa 2 la possibilité d’opposer la compensation aux personnes morales de droit public et aux entreprises publiques, l’article 30 pose le principe général de l’immunité d’exécution au profit de ces personnes[61].
L’arrêt rendue par la CCJA dans l’affaire dite Togo Télécom[62] renseigne à suffisance sur la position de la CCJA. Par une interprétation extensive des alinéas 1 et 2 de l’article 30 de l’AUPSRVE, la haute juridiction assurait l’immunité d’exécution toutes les entreprises publiques quelle qu’en soit la forme ou la mission.
Cette solution fut confirmée en 2014 par l’arrêt rendu dans l’affaire dite Port autonome de Lomé[63]. En effet dans un arrêt du 13 mars 2014, la CCJA avait estimé que les entreprises publiques, dont le port autonome de Lomé, bénéficient de l’immunité d’exécution en vertu de l’article 30 alinéa 1 de l’AUPSRVE même si des dispositions nationales les soumettaient aux règles de droit privé.
En réalité, cet arrêt dévoile toute la véhémence de la CCJA dans sa volonté de soustraire les entreprises publiques au régime de droit privé. En l’espèce elle avait reconnu l’immunité d’exécution à l’entreprise togolaise alors même que la décision frappée d’appel l’avait seulement condamnée à payer diverses sommes assortie d’une exécution provisoire.
Les créanciers n’étaient pas encore en possession de titre exécutoire. Seule une ordonnance de sursis à exécution était sollicitée parallèlement à l’instance d’appel devant le président de la juridiction de second degré. Le fait donc pour les conseils de la société Togo port d’avoir excipé prématurément de l’immunité d’exécuté n’avait pas empêché la CCJA de réitérer sa position en faveur d’une interprétation extensive de l’article 30 de l’AU susvisé.
Deux années plus tard, des critères d’identification des entités bénéficiaires de l’immunité d’exécution furent dégagés par la Cour dans par la Cour dans l’affaire dite Fonds d’Entretien Routier (FER) pour réitérer sa position sur l’immunité d’exécution des personnes publiques[64].
Par son arrêt n° 03/2018 du 26 avril 2018[65], la CCJA a opéré un revirement de sa jurisprudence en matière d’immunité d’exécution. La cour avait procédé dans cette affaire à une nouvelle lecture de ces dispositions en ces termes : « … qu’en l’espèce, il est établi que le débiteur poursuivi est une société anonyme dont le capital social est détenu à parts égales par des personnes privées et par l’Etat du Congo et ses démembrements ; qu’une telle société étant d’économie mixte, et demeure
une entité de droit privé soumise comme telle aux voies d’exécution sur ses biens propres ; qu’en lui accordant l’immunité d’exécution prescrite à l’article 30 susmentionné, la Cour de Kinshasa/Gombe a fait une mauvaise application de la loi et expose sa décision à la cassation ; qu’il echet de casser l’arrêt déféré et d’évoquer.
A travers cette solution, la CCJA s’est référée à la forme privée de l’entreprise pour l’application des voies d’exécution. Elle venait de tenir en compte de cette réalité de l’entreprenariat public : la société d’économie mixte.
En faisant l’économie de ces décisions, on relève une instabilité de la jurisprudence de la CCJA sur la détermination des entités bénéficiaires de l’immunité d’exécution[66]. Pour éviter toutes divergences, il pourrait être judicieux de préciser le champ de l’immunité d’exécution accordée aux personnes morales de droit public. Dans le cadre de la réforme le législateur OHADA pourrait envisager d’attribuer une immunité d’exécution en fonction de l’activité (mission de service public) et non d’un critère purement organique.
Ainsi donc lorsque les activités de la personne publique relèvent du droit privé, l’immunité d’exécution ne devrait pas s’appliquer. Cette question va essentiellement concerner les établissements industriels et commerciaux (EPIC) dont les activités ne relèvent pas du droit privé mais des services publics marchands. L’immunité d’exécution des Etats parties à l’OHADA servirait l’attractivité de leurs économies si elle se limitait sur des biens ou des catégories de biens utilisés ou destinés à être utilisés à des fins publiques.
Il s’agit là d’une mesure de revalorisation du droit de créance qui fait de l’Etat commerçant un justiciable comme tous les autres.
Tandis que la plupart des droits nationaux des pays membres de l’OHADA prévoient le sursis à exécution provisoire, l’OHADA en disposé autrement.
Paragraphe II : Les défenses à exécution
L’article 32 de l’Acte uniforme en matière de voies d’exécution pose la délicate question du sort des défenses à l’exécution provisoire telles qu’organisées en droit interne de certains Etats parties.
Dans l’arrêt du 11 Octobre 2001 dit EPOUX KARNIB[67], la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) décidait que l’article 32 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution interdit les défenses à l’exécution provisoire lorsque celles-ci tendent à suspendre une exécution forcée déjà entamée. A contrario, l’on pourrait comprendre que les défenses à l’exécution provisoire telles que régies par le droit interne de chaque Etat partie demeurent applicables lorsqu’elles visent non pas à suspendre une exécution forcée déjà engagée, mais plutôt à empêcher qu’une telle exécution commence[68]. Or, le principe énoncé à l’article 32 est celui d’une exécution forcée sans obstacle.
A notre avis, il conviendrait de « sécuriser » la restitution des fonds perçus par le créancier « provisoire » qui se serait précipité à diligenter une exécution provisoire. En effet, l’article 32 n’interdit pas au juge des référés saisi d’une défense à exécution provisoire de prendre toute mesure utile compatible qui lui serait faite à titre reconventionnel par le défendeur, puisque le droit commun est toujours applicable dès lors qu’une disposition expresse ne l’interdit pas.
Dès lors qu’il ne suspend pas la poursuite de l’exécution provisoire expressément autorisée par cet article, il peut, en vertu des pouvoirs que lui confère l’urgence ou la nécessité de parer à un péril imminent (comme le risque de ne pas obtenir la restitution des sommes versées), prendre la mesure utile pour éviter l’impossible restitution, par exemple, en ordonnant la mise sous séquestre des sommes réclamées dans l’attente d’une décision définitive.
Cette mesure de séquestre, qui n’est en effet que conservatoire, présente l’avantage de respecter le droit du débiteur condamné provisoirement à un procès équitable reconnu comme un droit supérieur par les articles 3 et 7 de la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples. En effet, l’interprétation de l’article 32 retenue par la CCJA depuis l’arrêt de principe de 2001 est de nature à conduire à une iniquité irréparable pour le débiteur au cas où le créancier qui a fait exécuter le titre
provisoire se trouverait dans l’impossibilité de lui restituer ce qu’il a perçu indûment.
Les objectifs visés par l’amélioration de l’acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement de créances et des voies d’exécution sont la recherche d’une plus grande efficacité et de célérité dans le fonctionnement de la justice commerciale. La réforme qui pourra améliorer cet acte uniforme aura pour vocation d’offrir aux opérateurs économiques un environnement propre à promouvoir les investissements privés tant nationaux qu’étrangers à travers une plus grande confiance dans l’appareil judiciaire. Elle assurera ainsi à l’OHADA l’image d’un espace économique au sein duquel les juridictions garantissent la sécurité des transactions commerciales. Cette initiative servira de levier et de vecteur de développement économique.
Conclusion du chapitre II :
« L’OHADA s’est dotée de lois appelées « Actes uniformes » pour faciliter les échanges, encourager l’investissement des entreprises domestiques et internationales mais aussi garantir la sécurité juridique et judiciaire. Cet objectif de sécurité juridique et judiciaire est indispensable pour drainer des flux importants d’investissement et faire de l’espace OHADA une cible de premier choix pour les investisseurs étrangers »[68].
Ce chapitre nous a permis de présenter les dysfonctionnement et les obstacles qui constituent une pierre d’achoppement sur le chemin de l’effectivité pleine et entière du droit OHADA. En effet, l’on note la présence de lacunes au sein principalement de deux actes uniformes : l’AUDCG/GIE et l’AUPRSVE. Ces lacunes constituent une entrave à la sécurité juridique visée par le législateur communautaire. Le législateur OHADA devrait donc songer à améliorer ces actes uniformes pour une meilleure sécurité juridique des IDE.
Conclusion de la première partie :
L’environnement créé par le droit des affaires OHADA donne aux investisseurs une lisibilité quant au droit applicable à leurs opérations. Ils peuvent ainsi anticiper les risques inhérents à leurs activités. Le droit de l’OHADA garantit donc une certaine prévisibilité du règlement des conflits qui, jadis, faisait défaut. L’ensemble de l’œuvre législative de l’OHADA vise à rassurer les investisseurs. Toutefois les lacunes de quelques actes uniformes devront être comblées par le législateur OHADA afin d’assurer au mieux la sécurité juridique des IDE.
Les promoteurs du droit des affaires ne se sont pas limités à l’élaboration de normes juridiques. Ils ont eu également comme souci de donner des garanties judiciaires quant à leur application. L’uniformisation du droit entamée par l’OHADA resterait théorique si les normes qu’elle édicte étaient diversement appliquées et interprétées dans les Etats membres. L’unification juridique devait nécessairement s’accompagner d’une unification judiciaire pour garantir aux opérateurs économiques le principe de l’égalité de traitement. Ainsi donc, dans la seconde partie il s’agira pour nous de d’aborder le volet de la sécurité judiciaire des investissements.
________________________
47. Voir articles 34 et 35 de l’Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant sur le droit commercial général. ↑
48. Coco KAYUDI MISAMU, op.cit., p.7. ↑
49. Ibid. ↑
50. Article 36 de l’AUDCG. ↑
51. Marlize Elodie NGINDJO TSAPI, L’information de l’acquéreur des titres sociaux dans l’espace OHADA, Mémoire de maitrise en droit, Université de Dschang, 2009, p.17. ↑
54. Article 30 alinéa 1 de l’AUVE. ↑
58. Ibid. ↑
64. CCJA, 19 juin 2003, arrêts n°012/2003, n°013/2003 et n°014/2003. ↑
65. France KERE, Les problématiques juridiques liées à l’implantation des sociétés étrangères dans l’espace OHADA, Thèse en préparation à Bordeaux, dans le cadre de l’Ecole doctorale en droit, en partenariat avec l’Institut de recherche en droit des affaires et patrimoine depuis le 31-10-2016. ↑
66. Yves GUYON, « Conclusion », in Petites affiches : le quotidien juridique, n° 205, 13 octobre 2004, p.59. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quels sont les enjeux des actes uniformes dans l’OHADA pour les investissements étrangers?
Les Actes uniformes sont conçus pour établir des règles communes, simples, modernes et adaptées aux économies des États parties, mais peuvent aussi causer des incertitudes pour l’investisseur en raison de certaines maladresses ou de l’inadéquation de certains Actes uniformes.
Comment le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) affecte-t-il les investissements en OHADA?
Le RCCM est caractérisé par l’inaccessibilité de ses données, une gestion lourde sur support papier, des données peu fiables et une méconnaissance générale de son utilité, ce qui constitue un handicap pour les investisseurs.
Pourquoi la sécurité juridique est-elle importante pour les investissements directs étrangers (IDE) en OHADA?
La sécurité juridique est cruciale car elle permet d’attirer les investissements directs étrangers, qui sont un vecteur de croissance économique, en assurant un cadre juridique fiable et accessible.