Les implications politiques de la communication révèlent des mécanismes de défense insoupçonnés dans le contexte congolais. Cette recherche innovante, alliant psychologie interculturelle et méthodologies variées, offre un cadre théorique essentiel pour comprendre les dynamiques socioculturelles contemporaines.
- Principes du constructivisme scientifique
Le constructivisme scientifique est un positionnement épistémologique (un paradigme scientifique). Il fait un certain nombre de postulats sur la connaissance et les conditions d’élaboration de cette connaissance.
Dans son ouvrage intitulé Etude des communications : Approche par la modélisation des relations, Alex Mucchielli357 a dénombré quatre principes dits faibles et quatre autres dits forts.
Les principes dits faibles se retrouvent dans toutes les recherches scientifiques. Ils ne parviennent pas seulement au seul constructivisme. Il s’agit de :
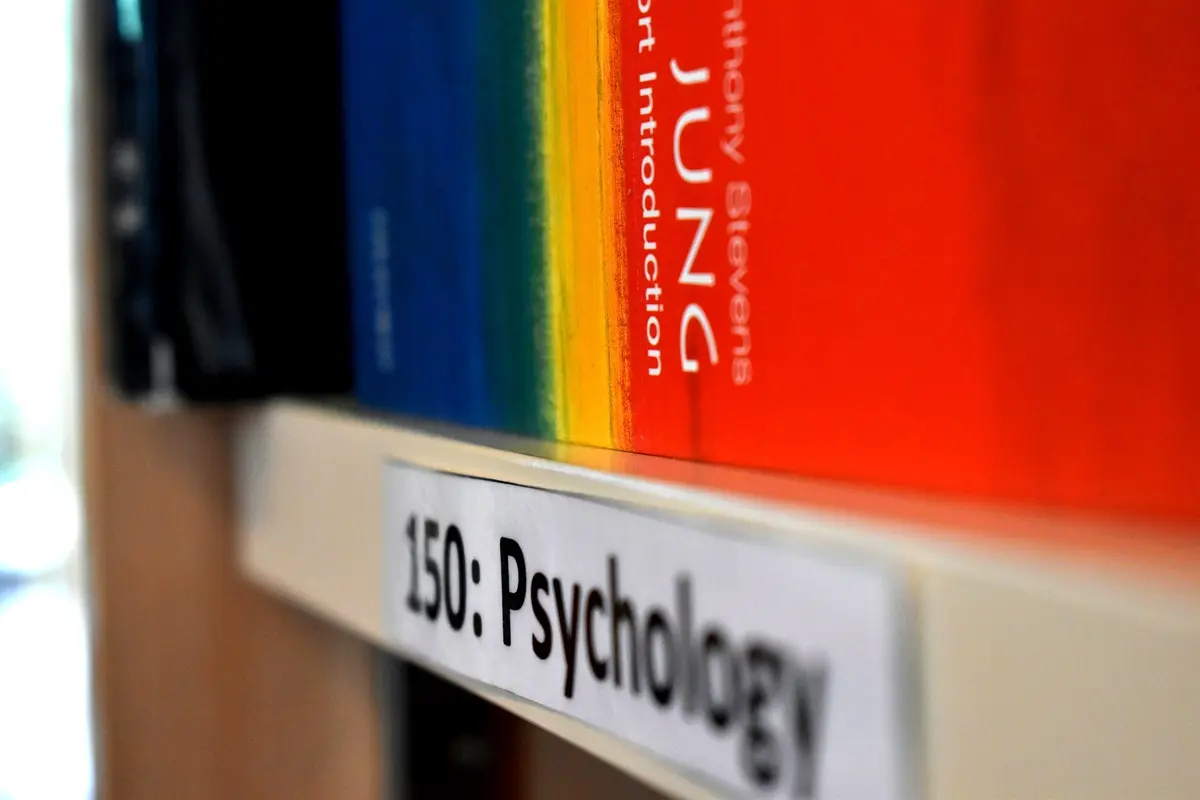
356 VYGOTSKI, L.S., op.cit, pp. 45 et 111.
357 MUCCHIELLI, A., Etude des communications : Approche par la modélisation des relations, Paris, Armand Colin, 2004, pp. 96-10.
- le principe de la construction de la connaissance qui stipule que la connaissance n’est pas un donné mais une construction ;
- le principe de la connaissance inachevée, c’est-à-dire la connaissance scientifique ne peut prétendre être parfaite ;
- le principe de la convenance de la connaissance plausible, c’est-à-dire la connaissance n’est que relative à ce qui convient pour l’action ;
- le principe de la recherche de la connaissance et de la reliance, c’est-à-dire la connaissance n’est que relative à ce qui convient pour l’action.
Les principes dits « forts », qui concernent particulièrement notre travail, ils marquent spécifiquement une recherche constructiviste et qu’ils ont des exigences difficiles à remplir dans les théories et méthodes utilisées pour une étude en communication. Ils sont donc assez discriminants pour l’évaluation du « constructivisme » d’un point de vue ou d’une recherche faite. Il s’agit des principes suivants : téléologique, de l’expérimentation de la connaissance, de l’interaction et de la récursivité de la connaissance.
- Le principe téléologique, c’est-à-dire on ne peut pas séparer la connaissance construite des finalités attachées à l’action de connaître ;
La recherche constructiviste doit avoir une finalité forte de trouver la consonance à travers des mises en relation de divers phénomènes. Dans ce cas précis, la recherche doit concilier complètement la communication avec l’action qu’elle se propose d’unifier certaines conceptions des théories de la communication avec certaines théories de l’action c’est-à-dire la communication ne soit considérée que comme une variante de l’action et réciproquement.
Cette conception se rapproche de l’agir communicationnel d’Habermas358, dont la communication généralisée recouvre « l’activité orientée vers le succès » et « l’activité orientée vers l’intercompréhension. Ces objectifs peuvent être atteints de deux manières : d’une façon directe et instrumentale, par l’intervention directe dans la situation (action ou ordre donné, donc communication) et d’une façon indirecte à l’aide d’une activité par une influence qui peut être aussi une action (gratification, effort fait).
Quant à l’activité orientée vers l’intercompréhension, son télos (orientation d’esprit) est fondamentalement orienté vers l’entente et il est évidemment réalisé essentiellement à l’aide des communications, c’est-à-dire à l’aide des échanges de parole.
358 HABERMAS, J., op.cit, pp. 1-332.
- Le principe de l’expérimentation de la connaissance, c’est-à-dire la connaissance est totalement liée à l’activité expérimentée et donc vécue du sujet ;
La construction des connaissances afférentes à cette conception doit être d’une confrontation du chercheur avec ses objets construits. Ces construits sont élaborés à partir des macro-concepts que le chercheur doit avoir comme outils de travail. Edgard Morin359 appelle
« macro-concepts » des amalgames cohérents, mais flous, de notions analogiques dans lesquelles le chercheur peut puiser pour trouver un point de départ à sa construction. Partant d’une notion floue, il va s’efforcer de la préciser, jusqu’à en élaborer, pour la situation précise qu’il étudie, une définition satisfaisante.
En ce qui nous concerne la « théorie générale de la communication » que nous avons présentée, il existe dans cette théorie lâche un macro-concept « communication interculturelle
» et des concepts spécifiques, comme l’interculturel, la communication généralisée, la contextualité situationnelle et le mécanisme de défense.
Et, ce genre de recherches nécessite des méthodologies qualitatives (enquête par interviews et observations) caractérisées par leur souplesse. Les techniques d’analyse, elles aussi sont souples. Les grilles et les règles d’analyse sont modulables à l’intérieur d’une orientation globale.
- Le principe de l’interaction, c’est-à-dire la connaissance est le fruit d’une interaction du sujet connaissant et de l’objet de connaissance ;
L’interaction est comprise ici différemment de l’expérimentation précédente, laquelle nécessite une interaction intellectuelle avec les objets d’étude. L’interaction est la mise en relation des objets du monde à connaître entre eux pour faire surgir les significations. Ceci peut se faire grâce au recours aux processus de contextualisation et à la conjonction avec le paradigme compréhensif.
En ce qui concerne les « processus de contextualisation (primaire et communicationnel) », le cadre théorique global sur lequel le chercheur doit s’appuyer doit être constitué, entre autres choses, de travaux de mise en relation d’un phénomène avec des éléments sélectionnés de son environnement global. C’est de cette confrontation qu’émergent les significations donnant le sens du phénomène communicationnel.
Pour ce qui est du « paradigme compréhensif », la recherche doit permettre d’affirmer l’interdépendance de l’acteur et du monde ainsi que la construction du monde des objets par
359 MORIN, E., « Messie, mais non », Conclusion au colloque de Cerisy sur l’Argument pour une méthode, Paris, Seuil, 1990, p. 256.
les acteurs humains. Ce paradigme se fixe trois principes. Le premier affirme que le monde de l’homme n’est pas un monde objectif qu’il est un monde subjectif par sa sensibilité (postulat constructiviste-subjectif). Le deuxième stipule que ce qui est intéressant dans l’étude des phénomènes produits par les hommes, c’est leur lecture en compréhension et leur sens final qui leur sont donnés par les impliqués (postulat du primat de la lecture en compréhension donnant accès aux significations). Le troisième stiulent que l’accès aux significations données par les acteurs impliqués est possible grâce aux phénomènes d’empathie et de validation par l’échange (postulat de l’empathie et de la validation interhumaine possible).
L’approche compréhensive doit donc viser à constituer le monde des significations de l’action et des pensées pour les acteurs considérés.
- Le principe de la récursivité de la connaissance, c’est-à-dire la connaissance établie et le processus de connaissance qui l’établit se structurent réciproquement ;
La construction scientifique doit fonctionner comme l’intelligence humaine, c’est-à-dire s’adapter sans cesse à la construction faite. Les méthodes d’élaboration des résultats scientifiques doivent être flexibles et être reliées aux construits obtenus. Ceci fixe le genre de méthodologie de recueil et d’analyse à utiliser. Dans ce cas, les méthodes qualitatives comme il a été signalé, conviennent puisqu’elles sont fondées sur l’intuition et l’adaptation intelligente à ce que l’on découvre.
L’activité de recherche, dans le constructivisme que nous adoptons, s’apparente donc à l’activité d’analyse qualitative. Cette activité est un acte aux multiples dimensions s’insérant à l’intérieur d’un univers interprétatif dont plusieurs éléments relèvent du théorique dans son sens large. Cet univers est constitué de référents très divers actualisés en cours d’analyse à un rythme, à une ampleur et selon des modalités très difficilement prévisibles.
De plus, l’activité de recherche et le contexte interprétatif sont des éléments qui s’élaborent et se déterminent mutuellement dans une équation simultanée que le chercheur essaie de résoudre afin de définir la nature des événements que nous allons analyser. Les ressources de compréhension que nous utilisons sont essentiellement constituées par des éléments de contextualité qui indiquent le contexte à prendre en compte et des savoirs d’arrière-plan puisés dans le cadre théorique global de la communication interculturelle.
En somme, ces principes qui guideront notre démarche voulu constructiviste, et peuvent être résumés en trois postulats épistémologiques ci-après selon Frédérick Wacheux 360:
360 WACHEUX, F., « Compréhension, explication et action du chercheur dans une situation sociale complexe », in ROUSSEL, P. et WACHEUX, F. (dir), Management des ressources humaines : Méthodes de recherche en sciences humaines et sociales, Bruxelles, De Boeck, 2005, pp. 10-11.
- la réalité est construite et non donnée. Toute situation sociale est en perpétuel devenir par les actes, les faits et l’attribution de sens par les acteurs. Les invariants ne sont que la forme idéelle de l’instantanéité. Il est donc fondamental de comprendre les processus pour analyser la structuration d’une situation ;
- la théorisation n’est pas une finalité mais un moyen. Les concepts permettent un encodage provisoire des situations ou des propositions d’expérience. Celles-ci peuvent être ad hoc sur un contexte local, de moyenne portée sur des contextes parents dans l’attente d’une traduction ;
- le chercheur est un médiateur entre une réalité complexe abstraite et une théorisation dédiée à l’interprétation ou à la constitution de connaissances. Il a donc pour mission de confronter les faits et les concepts pour proposer une explication qui fait sens pour les acteurs et la communauté scientifique.
Section 4 :
Souci d’un cadre théorique à construire (modèle de notre recherche)
Les connaissances que nous comptons construire ont une relation avec les significations que prennent les phénomènes dans un monde inter-humain. Ce ne serait pas des significations construites directement par les acteurs, ce sont des significations qui seront construites à notre niveau à partir du tableau panoramique. Cette construction est facilitée lorsque l’on se réfère à un cadre théorique qui doit être large et souple.
Ce cadre théorique a au départ des référents théoriques (modèles de communication déjà existants en SIC) et conceptuels (développés dans les deux premiers chapitres). Ce cadre doit avoir une boîte à outils constituée de concepts extensibles se référant aux réseaux conceptuels à un ensemble théorique large des sciences de la communication et de la psychologie interculturelle.
Cette boîte à outils est constituée donc d’un concept général dit macro-concept, c’est-à-dire la « communication interculturelle » et de quatre concepts spécifiques, à savoir l’interculturel, la communication généralisée, la contextualité situationnelle et le mécanisme de défense. En dehors de ces outils, la boîte elle-même aura une orientation d’usage, elle sera faite pour analyser les problèmes de communication interculturelle qui se posent dans les milieux sociaux.
Ainsi donc, notre cadre de référence théorique soutenant à la fois l’étude de la dynamique des rapports entre les acteurs et de la contribution de ces rapports à la production des mécanismes de défense socioculturelle devra également servir pour l’identification des modes de communication véhiculant ces mécanismes. Rappelons que le champ théorique qui a servi de soubassement pour la construction de ce cadre de référence de la recherche est celui de la « communication interculturelle » dans une perspective psychologique.
Alex Mucchielli et Claire Noy361 ont relevé deux critiques qui peuvent être formulées à l’endroit de ce cadre de référence de recherche. La première critique porte sur l’utilisation de la boîte à outils. Des spécialistes pourront reprendre le travail fait avec les outils et montrer ses imperfections (critique méthodologique). La seconde, porte sur l’utilité des résultats obtenus. Il s’agit de répondre à cette question, à quels types de problèmes et à quels types d’acteurs convient la connaissance plausible à découvrir ? (critique utilitariste-pragmatique)
Enfin, notre démarche scientifique a un soubassement psychologique parce que les mécanismes de défense sont des aspects en construction dans un processus de communication interculturelle. Leur compréhension nécessite aussi un paradigme constructiviste qui va donc nous permettre de mettre en place un modèle de recherche approprié, appelé « cadre de référence théorique » par Alex Mucchielli et Claire Noy362, « perspective sociologique générale » par Didier Demazière et Claude Dubar363 et « adhésions interprétatives » par Thmos
A. Schwandt364. A cet effet, le paragraphe qui suit nous décrit la construction de ce modèle (cadre de référence théorique) en termes de modélisation.
________________________
357 MUCCHIELLI, A., Etude des communications : Approche par la modélisation des relations, Paris, Armand Colin, 2004, pp. 96-10. ↑
358 HABERMAS, J., op.cit, pp. 1-332. ↑
359 MORIN, E., « Messie, mais non », Conclusion au colloque de Cerisy sur l’Argument pour une méthode, Paris, Seuil, 1990, p. 256. ↑
360 WACHEUX, F., « Compréhension, explication et action du chercheur dans une situation sociale complexe », in ROUSSEL, P. et WACHEUX, F. (dir), Management des ressources humaines : Méthodes de recherche en sciences humaines et sociales, Bruxelles, De Boeck, 2005, pp. 10-11. ↑
361 MUCCHIELLI, A., Etude des communications : Approche par la modélisation des relations, Paris, Armand Colin, 2004, pp. 96-10. ↑
362 MUCCHIELLI, A., Etude des communications : Approche par la modélisation des relations, Paris, Armand Colin, 2004, pp. 96-10. ↑
363 DEMAZIÈRE, D. et DUBAR, C., op.cit, pp. 1-332. ↑
364 SCHWANDT, T.A., op.cit, pp. 1-332. ↑
Questions Fréquemment Posées
Quels sont les principes faibles du constructivisme scientifique?
Les principes faibles du constructivisme scientifique incluent la construction de la connaissance, la connaissance inachevée, la convenance de la connaissance plausible, et la recherche de la connaissance et de la reliance.
Qu’est-ce que le principe téléologique dans le constructivisme scientifique?
Le principe téléologique stipule qu’on ne peut pas séparer la connaissance construite des finalités attachées à l’action de connaître.
Comment la connaissance est-elle liée à l’expérimentation selon le constructivisme?
La connaissance est totalement liée à l’activité expérimentée et vécue du sujet, nécessitant une confrontation du chercheur avec ses objets construits.