L’identité des cacos en Haïti révèle une dimension méconnue de l’occupation américaine (1915-1920) à travers des photographies saisissantes. Cette recherche démontre comment ces images transcendent leur fonction documentaire, offrant un éclairage nouveau sur les représentations sociopolitiques de l’époque.
Conclusion
Pratiquement, ce mémoire aura atteint l’objectif de départ de valoriser la manière dont la photographie documentaire montre une image « inédite » de l’identité des cacos durant l’occupation états-unienne d’Haïti (1915 – 1920). On pourrait souhaiter uniquement que le choix des exemples, l’orientation théorique et la structure des analyses auront convaincu le lecteur du fondement d’accorder la prévalence au message photographique. En rétrospective, ces photographies devraient faire figure de monuments, de lieux de mémoire construits, et de documents « véridiques » de l’époque. Donc, ils rappellent à la mémoire.
Lors de la réflexion, il était convenu de faire allusion au concept retenu de Roland Barthes à savoir le message photographique. A noter que, c’est un message sans code, et continu. Il peut y avoir transparence et opacité par le dispositif photographique qui devient à son tour agent qui laisse des traces pour un éventuel récepteur.
Cette approche sémiologique a été maintenue dans le mémoire. Par exemple, à chacune des analyses, la description des traits formels a tenu compte des effets de profondeur à l’intérieur de la composition, de l’expansion en hors-champ, sur le plan du cadrage. Par ailleurs, il a été augmenté que ces traits positionnent différemment le récepteur et orientent son interprétation du contenu.
En fait, l’étude du corpus a pris quelque distance au modèle de Barthes au profit de l’orientation théorique et méthodologique beaucoup plus réaliste qui accorde un grand rôle au décodeur du dispositif, au fonctionnement de l’image.
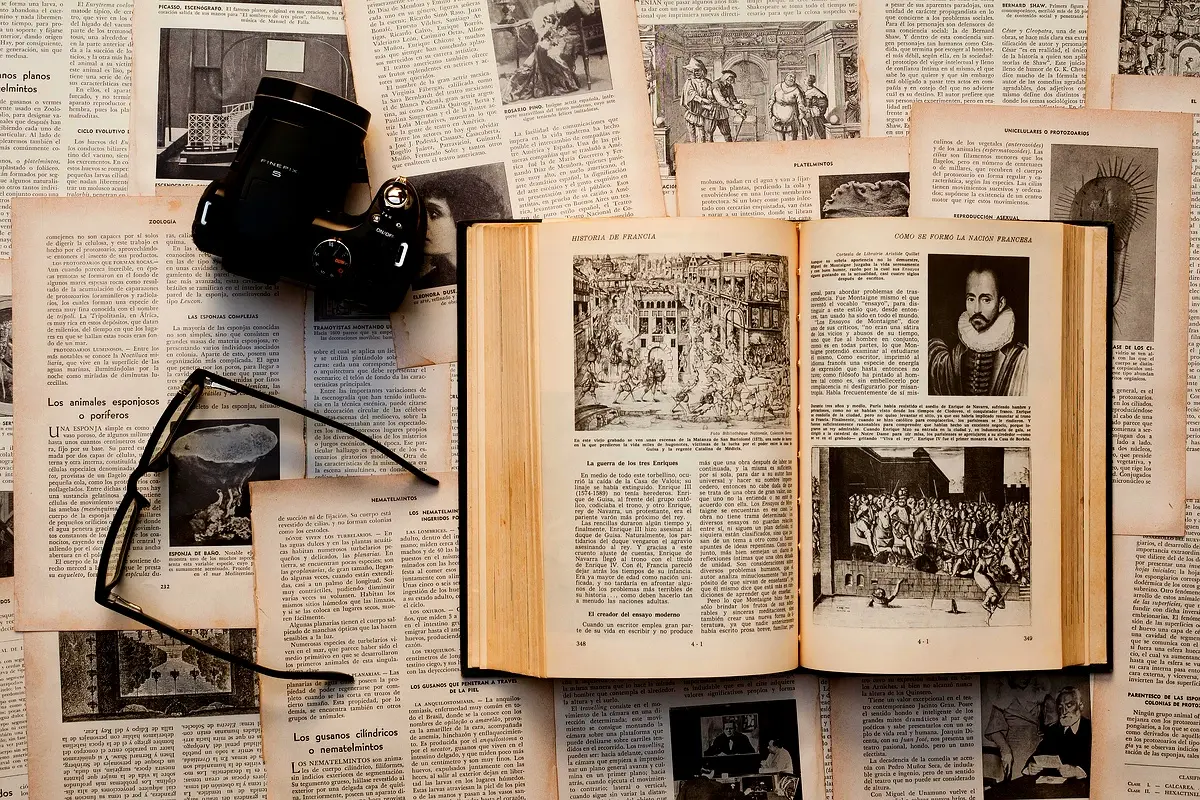
Effectivement, considérer les codes iconographiques des vêtements et l’attitude des personnages comme marques de l’identité révolutionnaire oblige à une certaine réappropriation des conventions sociales au moment de la prise photographique. Ces codes ont donc été à titre de références factuelles, mais de signifiants mobiles. La façon dont ils sont insérés aux analyses n’a rien à voir avec une histoire des uniformes de l’armée et celles des révolutionnaires en Haïti.
Leur rappel avait pour but de mettre en relief certains moments de mutation de l’identité des protagonistes de la résistance armée que les photographes eux-mêmes ont forcément représentés. Ceci nous ramène au dynamique non finie ponctuellement prise en charge par le photographique.
Il va de soi que, malgré les subterfuges de mise en forme, les photographies du corpus ont une valeur historicisante en vertu des sources qui en assurent la diffusion. Plusieurs ont déjà acquis le statut officiel de témoins de leur époque. Ainsi qualifiées, elles risquent de demeurer comme exemple authentiques et privilégiés non seulement des évènements particuliers représentés, mais de la mentalité de toute une nation pour une période donnée.
C’est effectivement une telle extension que ce mémoire a tenté de contrer de quatre manières qui touche tout autant la forme que le contenu des images : d’abord, en insistant sur le caractère ponctuel de chaque représentation, ensuite, en retenant les codes vestimentaire et posturaux comme point de changement ni positif ni négatif de l’identité des Gendarmes et des cacos, puis, en soumettant le contenu au plan d’expression, enfin, en désamorçant les stratégies photographiques et la facticité des apparences.
La méthode avait pour fin de pointer l’ambivalence persistante entre la véracité apparente de la figuration et la discrétion relative du discours photographique.
On l’a vu, certaines photographies donnent l’impression d’avoir été prises sur le vif, d’autres font état d’une mise en scène calculée. Dans tous les cas, elles montrent un présent déjà révolu.
Complémentairement des constats sur la photographie documentaire, notre étude aura donc permis d’identifier certains pièges de la réception des référents vestimentaires. D’une part, le passage du temps fait en sorte que les concepts théoriques qui y sont associés tendent à donner une extension aléatoire au photographique initial.
D’autre part, le recul historique engendre la conception d’un « présent » étendu et propre à l’ensemble d’un quinquennal, ce qui impute à l’image des données inexistantes lors de la prise photographique. Afin de se rapprocher de l’énonciation du photographe, il faut distinguer l’esprit du temps auquel les vêtements renvoient a posteriori et leur rôle à généraliser à outrance le propos ponctuel du photographe.
Il reste beaucoup à faire et à dire sur le corpus ou des corpus semblables. D’autres exemples pourraient être ajoutés à chacun des blocs thématiques afin de couvrir toutes les quinquennaux, ou possiblement plus pertinent, d’autres types de situations pourraient être inclus à la problématique générale en compléments des trois thèmes étudiés (Gendarmerie, Evènement politique, assassinat), entre autres, les Marines et les vigilants, les cacos, les réunions de chaque groupe en particulier, les réunions entre les deux groupes, les échanges de tirs ; la photographie documentaire ne peut- être qu’un aide-mémoire, un souvenir des mouvements sociopolitique, un rappel des lieux de mémoire, et non la mémoire d’une époque ; elle fait figure de fragment réformateur d’un tout arbitrairement découpé par le photographe.
Questions Fréquemment Posées
Comment la photographie documentaire redéfinit-elle l’identité des cacos en Haïti ?
Ce mémoire valorise la manière dont la photographie documentaire montre une image inédite de l’identité des cacos durant l’occupation états-unienne d’Haïti.
Quels sont les principaux éléments analysés dans les photographies documentaires de l’occupation américaine d’Haïti ?
L’analyse se concentre particulièrement sur les codes vestimentaires et les postures des personnages pour comprendre les représentations sociopolitiques de l’époque.
Quel est le rôle du message photographique selon Roland Barthes dans l’étude ?
Le message photographique est considéré comme un message sans code, et continu, qui peut avoir transparence et opacité par le dispositif photographique.
Comment les photographies du corpus sont-elles perçues historiquement ?
Les photographies ont une valeur historicisante et plusieurs ont acquis le statut officiel de témoins de leur époque, représentant authentiquement les événements et la mentalité d’une nation.